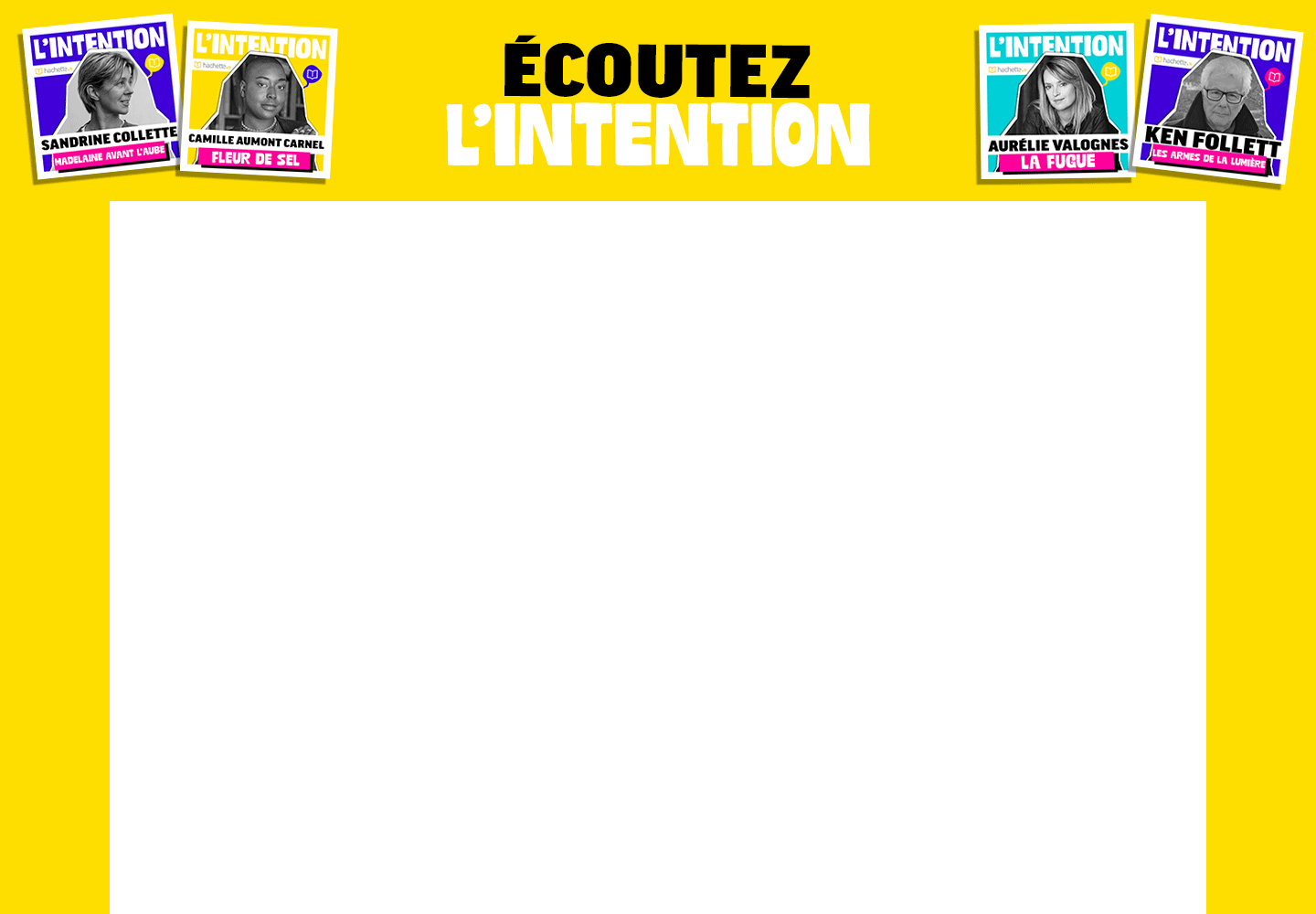sommaire
- • Carole Martinez : "Pour écrire, on n’a besoin de rien"
- La chanson de la fillette Chardon
Carole Martinez aime les contes, elle en a vécu un. Le parcours de son premier roman, Le cœur cousu, relève de la mythologie du monde du livre. Il était une fois une quadragénaire sans entregent, professeure de français dans un collège de la proche banlieue parisienne. Elle prend une année sabbatique pour écrire l’histoire qu’elle a en tête depuis quatorze ans et dépose chez Gallimard, en 2005, les 300 premières pages d’un manuscrit inachevé, intitulé La traversée. Quelques semaines plus tard, l’un des membres du comité de lecture, Jean-Marie Laclavetine, la rappelle en demandant la suite. Le roman complété de ses cent dernières pages paraît en février 2007 dans la tant désirée collection blanche, tiré à 3 500 exemplaires, et puis… plus rien. Pas un écho dans la presse, pas un entrefilet.
Trois mois passent jusqu’à ce que quelques lecteurs, quelques libraires, une poignée de critiques (quatre, se souvient précisément l’intéressée) s’enthousiasment en chaîne pour cette épopée inspirée de la vie d’une arrière-arrière-grand-mère andalouse, jouée et perdue par son mari, fuyant de l’Espagne vers l’Algérie. Les premiers prix tombent : Ouest France-Etonnants voyageurs, Emmanuel-Roblès, Renaudot des Lycéens à l’automne suivant… Le cœur cousu réapparaît sur les tables des librairies. Huit ans plus tard, ses ventes totalisent 40 000 exemplaires en grand format, 320 000 en "Folio".
Après Du domaine des Murmures, deuxième roman paru en 2011 et d’emblée chaleureusement accueilli, revoilà Carole Martinez, désormais écrivaine à plein-temps, arpentant sa Terre qui penche, chaussée de ses santiags de sept lieux.
Pour Le cœur cousu, j’étais totalement inconsciente. Je ne connaissais personne dans le milieu de l’édition, je ne savais pas qu’autant de livres sortaient en même temps que le mien, que le temps d’exposition des nouveautés était si court. Pour moi, c’était déjà un exploit que mon roman soit en librairie. Le stress est venu dès cette prise de conscience de la fragilité d’un livre, de l’impuissance de l’auteur à partir du moment où le livre est figé. Quant à Du domaine des Murmures, c’était ma première expérience de rentrée littéraire. J’étais inquiète car tout le monde me disait que j’étais attendue. Moi, j’entendais : "attendue au tournant". J’ignorais à quelle sauce j’allais être mangée. Et cette fois-ci, c’est encore le doute… Quand on est trouillarde, on le reste.
Au tout début du projet, j’étais inspirée par l’histoire de Barbe-Bleue. Je voulais donner voix à six femmes mortes en les faisant vivre à différentes époques, leur faire raconter leur vie à la septième, contemporaine. J’ai travaillé cette dernière femme sur 240 pages avant de faire murmurer le premier des fantômes, Esclarmonde, jeune recluse. Elle ne devait parler que sur 30 pages, mais j’ai été prise par mon personnage, je n’ai pas réussi à le contenir. Je lui ai offert le roman et j’ai décidé de me lancer dans quelque chose de plus ambitieux qui formerait en plusieurs livres une sorte d’histoire romancée des femmes à travers les âges, c’est-à-dire à la fois à travers les siècles et les âges de la vie. Embrasser ainsi les différentes voies qu’ont pu prendre les femmes pour tenter de conquérir leur autonomie et résister.
Le premier du cycle, Du domaine des Murmures, fait entendre la voix d’une jeune fille du XIIe siècle qui se retire volontairement du monde pour échapper à un mariage arrangé. Dans La terre qui penche, la voix est dédoublée : c’est à la fois celle d’une petite fille morte à 12 ans et de la très vieille âme qu’elle est devenue par-delà la mort. Une enfant qui trouve dans la poésie et l’éducation la force de métamorphoser sa vie. Le prochain se passera au XVIe siècle, pendant la Renaissance qui est loin d’avoir été une période positive, une renaissance pour les femmes ; et le dernier devrait mêler toutes les autres se racontant à la contemporaine. Il devrait donc y avoir deux autres volumes. Mais dans l’immédiat, je veux m’éloigner de la Loue le temps d’un autre roman que j’ai en tête.
J’ai choisi une terre sans la connaître. J’ai fait un choix en bibliothèque, j’ai trouvé mon paysage dans des guides de varappe. J’ai commencé à me documenter, à lire les contes et les légendes qui étaient associés à la vallée de la Loue, la Vouivre, la Dame verte. J’ai appris aussi que Courbet avait peint les sources de la Loue en même temps que L’origine du monde, et que, pour lui, il y avait un lien entre ces deux tableaux. Je n’ai pas vérifié si c’était vrai, c’est une correspondance magnifique que j’ai voulu garder en tête, intacte. Et cette rivière, ses courbes, son nom, ont quelque chose de tellement féminin.
Depuis, j’ai été invitée par des lecteurs dans la région. Je me suis baignée dans la Loue. Des archéologues m’ont fait visiter les ruines de mon château ainsi que, face à lui, l’emplacement d’un autre, énorme, qui a mystérieusement disparu sans laisser de traces vers 1360-1361. Ils cherchent encore le site qui s’appelait, comme dans mon roman, Hautefeuille. Hautefeuille face à Hautepierre, ce côté shifumi, le jeu de mains "feuille-pierre-ciseaux", m’amusait. J’ai donc pu utiliser tout ce que j’avais appris de la région, et c’est maintenant un paysage très présent en moi.
Oh oui… je suis même de plus en plus lente. Je ne sais pas si j’assumerais d’écrire quelque chose tous les deux ans. Encore une fois, je n’aime pas le moment de la sortie du livre, j’ai toujours la crainte de ne pas être capable d’en parler, et d’ailleurs je ne veux pas tout dire de mes histoires. En revanche, j’aime le temps de l’écriture où l’on est tranquille. Du coup, je veux qu’il dure. C’est si doux d’être avec ses personnages. On abandonne et on découvre toute une partie de soi. Je comprends mieux les écrivains qui ont des héros récurrents : on s’attache.
Je ne peux écrire qu’en miroir. Ne parler du contemporain qu’indirectement, en transposant les choses. On peut, je crois, faire des parallèles entre aujourd’hui et ce XIVe siècle qui a été une époque terrible avec la guerre de Cent Ans, les pestes qui ont décimé la population, les désordres climatiques et économiques qui ont occasionné des famines, mais je ne veux pas jouer les Cassandre.
Il me semble que les contes de fées comme ceux de Grimm ou de Perrault que j’ai toujours aimés sont encore très actuels. On continue de les étudier au collège, mais c’est comme si, à l’âge adulte, on devait se dévêtir de leur influence. Je trouve dommage de se couper de ce qui représente l’imaginaire humain. J’aime les contes parce qu’ils sont modestes, universels, vivants, issus de la tradition orale et donc modelables à l’infini. Raconter des récits personnels, intimes, me gêne : j’ai peur de voler, de froisser, de blesser.
Il a incontestablement retardé le moment de me mettre à écrire. Enseigner est un métier qui m’a passionné et accaparé. D’ailleurs, j’appelle mes personnages comme mes élèves, "les occupants". Mais j’ai gardé le contact avec le milieu scolaire car, grâce aux prix qui m’ont été attribués par des jurys de lycéens, j’y suis très souvent invitée. Et j’adore parler avec des adolescents, tenter de leur donner l’envie d’écrire, de leur transmettre cette force-là. Pour écrire, on n’a besoin de rien et on ne s’ennuie jamais. Beaucoup ont honte d’avouer cette pratique. Et je comprends ce sentiment de ne pas se sentir légitime quand on veut écrire de la fiction. Je l’ai même parfois rencontré chez de grands profs de fac.
Pas du tout. Tout l’enjeu consiste à guetter et attendre la montée du désir. Puis c’est une invasion progressive. A toutes les étapes, je raconte beaucoup, à n’importe qui, même si j’ai des oreilles privilégiées : mon mari, mes enfants, mon frère, quelques copines. Je pose la question à tout le monde : "Je peux te raconter ?" J’écris d’ailleurs à voix haute, parfois un casque sur la tête avec de la musique. J’ai besoin de passer par la parole. C’était déjà comme ça pour mes rédactions quand j’étais petite. Fin 2013, mon éditeur m’a proposé de faire une lecture en public des 24 premières pages de La terre qui penche, les seules déjà écrites alors : ce genre d’exercice est très précieux pour moi.
Puis, au fur et à mesure que la fin du roman approche, l’écriture envahit le quotidien. Pour terminer La terre qui penche, je me suis isolée dans une maison au milieu de la campagne pendant un mois et demi où j’ai écrit et vécu avec Blanche, mon personnage, quasiment 24 heures sur 24.
C’est mon père noël. Il m’a notamment fait prendre conscience qu’Esclarmonde avait pris toute la place dans Du domaine des Murmures, même s’il ne m’a pas demandé d’éclater mon projet en plusieurs romans. La lettre répond à un échange que nous avons eu quand je lui ai envoyé mon manuscrit il y a quelques mois. Il m’a fait remarquer qu’il y avait un anachronisme, que je citais des chansons du XIXe siècle. Je le savais très bien, mais il a fallu que je me justifie. J’assume ce choix. Les chansons, comme les contes, sont des créations populaires, simples et poétiques, avec une transmission orale, tradition dont je suis issue, car ma grand-mère était une formidable conteuse. Elles viennent du très profond de notre histoire, n’ont souvent pas d’auteurs, peuvent avoir des dizaines de versions et nous arrivent d’on ne sait où, adaptées, déformées, retravaillées… "Je me plie à tes arguments", m’a répondu Jean-Marie Laclavetine. Publier cette lettre me permet de faire entrer le lecteur dans la relation auteur-éditeur.
Je suis une grosse lectrice de BD. J’ai accepté la carte blanche que m’a donnée Casterman et je me suis lancée dans cette série sur l’occulte à travers les siècles, dont l’idée m’est venue en lisant le catalogue de L’Europe des esprits, une exposition sur l’influence de l’occulte sur les sciences et les arts. Par exemple, pour le tome 2, je me suis penchée sur la fascination inattendue de Pierre et Marie Curie pour le spiritisme, et j’ai trouvé ça fabuleux. Il y aura quatre tomes, et le prochain s’intéresse à Victor Hugo à Jersey. L’écriture de scénarios a d’autres contraintes. Il est plus difficile de se glisser dans les trous, comme je cherche à la faire dans l’écriture des romans, quand j’imagine la vie de femmes du passé, anonymes, qui n’ont laissé que peu de traces, que je fais le portrait de ces "fantômes entrevus dans les failles de l’Histoire", comme dirait Duby.
J’ai tenté trois fois le concours d’entrée à la Fémis et à la quatrième j’ai été reçue en session spéciale pour adapter la première partie du Cœur cousu. Quelques cinéastes se sont montrés intéressés. Plusieurs comédiennes ont aimé Du domaine des Murmures. Il faudrait peut-être que j’essaie d’écrire Le cœur cousu, qui est une saga, dans le format des séries TV que j’adore. Mais je suis tellement lente…
(1) Bouche d’ombre : vol. 1, Lou 1985 (2014), et vol. 2, Lucie 1900 (2015). Dessins Maud Begon.
sommaire
- • Carole Martinez : "Pour écrire, on n’a besoin de rien"
- La chanson de la fillette Chardon
La chanson de la fillette Chardon
20 août > Roman France > La terre qui penche imagine à six siècles de distance une conversation de fantômes entre une enfant du XIVe siècle et sa vieille âme.

Pour la conteuse Carole Martinez qui sait les écouter, les rivières, à la fois archaïques et contemporaines, charrient en traversant le temps, des légendes ancestrales et abritent au mitan de leurs lits les secrets sédimentés de leurs riverains. Ainsi la Loue qui au milieu d’un apocalyptique XIVe siècle creusait sa vallée dans un pays de coteaux, traversait cette Terre qui penche que les vignerons devaient remonter sur leur dos après les orages. La "Loue enchanteresse", aux humeurs changeantes, courant au pied du château-forteresse du domaine des Murmures, et qui connaît la véritable histoire de Blanche, morte en 1361 à 12 ans, l’héroïne de ce troisième roman dédiée aux femmes de jadis.
Blanche est rousse, plus petite que les filles de son âge. Elle a un frère aîné et une sœur jumelle. Sa mère est morte, frappée par "La Grande Mort", l’un des fléaux de ces temps. La fillette rêve de s’instruire mais son seigneur de père, qui la dresse à la soumission à coups de badines, refuse "par peur que le diable ne s’insinue". C’est une petite rebelle qui s’entraîne à broder en cachette son nom sur sa chemise. "Mon Oiselot, ma Minute, mon Eau-vive, mon Chardon", la surnomme la nourrice, qu’elle va devoir quitter pour suivre son père au-delà des frontières de leur monde, en pays comtois où elle a été échangée contre une alliance entre châtelains. Là, on lui donne un précepteur en attendant les épousailles avec son promis, le fils du seigneur, Aymon, un jeune garçon fou et plein de grâce. Plus tard, elle possédera un grand cheval couleur terre appelé Bouc, du nom d’un écuyer qui ressemble à un ogre. Elle rencontrera Colin "le palefrenier aux yeux sombres", Eloi l’apprenti charpentier et "une géante vêtue de vert" hantant la grève aux Fées.
La terre qui penche est un dialogue entre deux fantômes qui n’en font qu’un : la fillette du XIVe siècle se raconte à "la vieille âme", son esprit, vieux de six siècles. "Tout contre toi, moi la "vieillarde", j’écoute mon enfance causer. Je t’écoute conjuguer jadis au présent et je m’émerveille." Mais la vieillesse ne sait pas comment l’enfance a pris fin.
A ces femmes-ombres tirées de leurs tombe anonymes, Carole Martinez offre sa prose enluminée et sa poésie gaillarde pour réanimer les vieilles croyances, la mémoire de la rivière, la mystique païenne de ses berges. Et chante une geste ardente en hommage à la fillette Chardon.
Véronique Rossignol
sommaire
- • Carole Martinez : "Pour écrire, on n’a besoin de rien"
- La chanson de la fillette Chardon