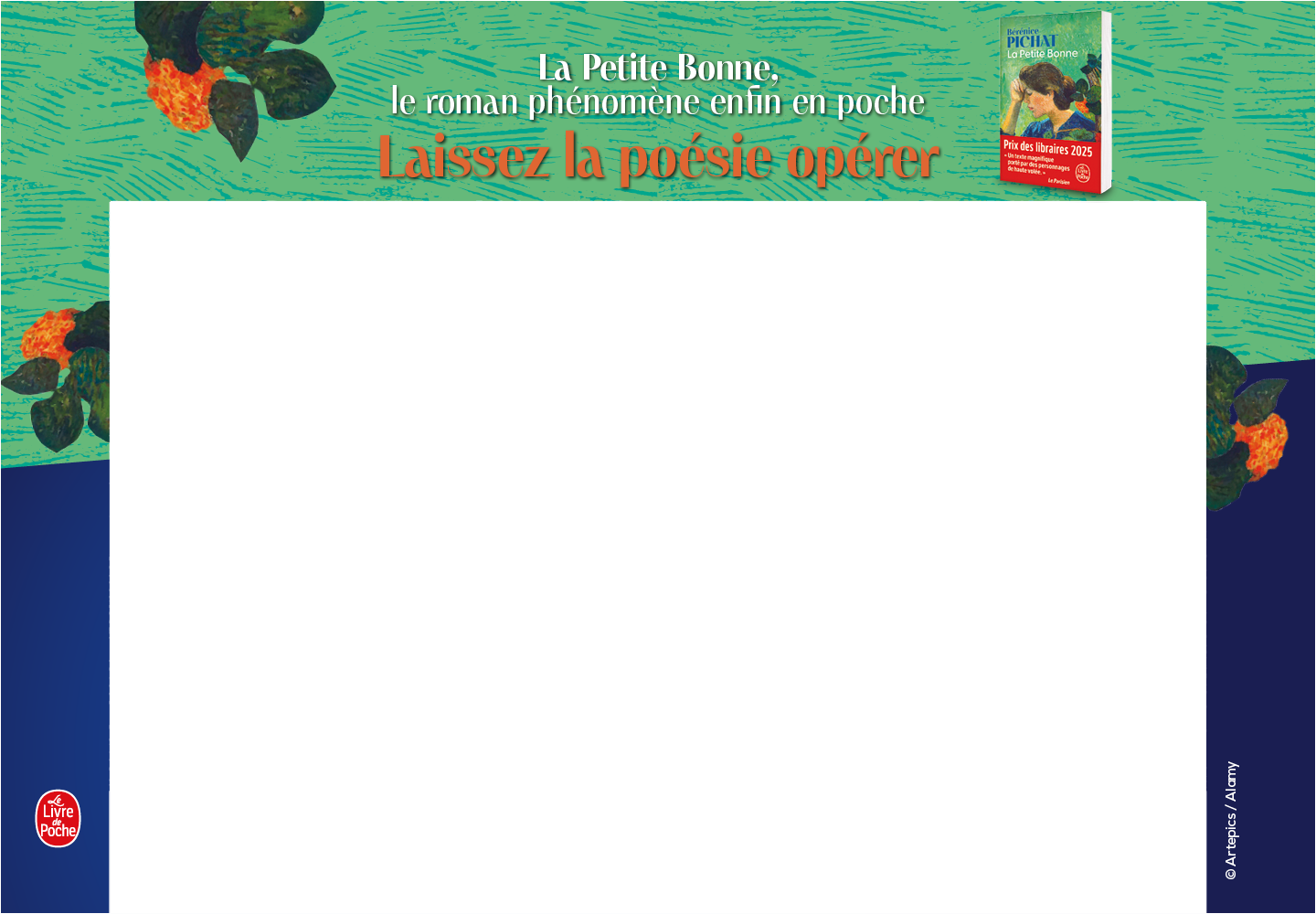Depuis la parution en langue arabe, en 2002, de son roman L’immeuble Yacoubian, hymne polyphonique à la diversité (passée) culturelle, linguistique et confessionnelle de sa ville, Le Caire, et best-seller dans le monde entier (voir ci-dessous), Alaa El Aswany, né en 1957, est une véritable star internationale. Tout en conservant sa modestie, sa gentillesse, et en continuant d’exercer son métier de dentiste, afin de rester proche du peuple. Une réelle empathie qui explique aussi son engagement, au premier rang, parmi les militants de la révolution du 25 janvier 2011, place Tahrir, laquelle a provoqué la chute du dictateur Hosni Moubarak. Considéré par les uns comme une conscience morale, contesté par d’autres, voire menacé, El Aswany est un écrivain qui met sa notoriété au service de sa cause - la liberté, la démocratie, la laïcité, le progrès - et de son pays en souffrance, l’Egypte. Au moment où la situation politique y est de plus en plus tendue et l’inquiète, il attend avec impatience la parution en France de son dernier roman, Automobile Club d’Egypte. Pour Livres Hebdo, depuis Le Caire, Alaa El Aswany se confie, parle de politique, de littérature - et de la France, à qui l’unit un lien privilégié.
Livres Hebdo - Pourquoi avoir situé Automobile Club d’Egypte dans le passé et non dans l’Egypte contemporaine ? Est-ce une façon de vous éloigner d’une actualité trop prégnante ?
Alaa El Aswany - Je dirais plutôt le contraire ! En littérature, le passé peut mener au présent. Dans chaque roman, deux niveaux se superposent. Le now element, comme disent les Anglo-Saxons, le contexte politique et social d’une époque. Et le human element, l’élément humain. Prenez La comédie humaine, par exemple. Balzac y a dépeint la situation d’une bourgeoisie française du XIXe siècle qui n’existe plus aujourd’hui. Mais c’est l’élément humain qui lui donne sa force éternelle. Moi, je traite de la fin des années 1940 au Caire, mais toutes les questions humaines qui ont conduit à la révolution actuelle sont déjà dans le roman : les serviteurs traités comme des esclaves par les riches, les classes dominantes, la naissance d’une conscience de classe révolutionnaire chez certains…
L’Automobile Club n’est-il pas l’un des symboles de l’Egypte d’antan, celle de l’avant-Nasser ?
Je me suis servi de cette époque pour poser des questions. La (bonne) littérature pose des questions, elle ne trouve pas les réponses ! L’Egypte d’avant Nasser ressemblait beaucoup à celle d’aujourd’hui : un pays très riche et très divers, culturellement parlant, avec un régime, la monarchie, qui ne pouvait plus durer. Tout comme l’ancien régime, qui se prolonge aujourd’hui, ne peut plus continuer. Il n’y a aucune différence entre Moubarak et les Frères musulmans, ce sont tous des fascistes. Morsi, c’est un Moubarak barbu ! L’Egypte ouverte, cosmopolite, c’est la vraie culture égyptienne, celle que la révolution de 2011 a pour but de restaurer.
Votre livre est construit de façon complexe, avec plusieurs récits qui s’interpénètrent, et même l’histoire de la création de la firme automobile allemande Benz. Pourquoi ?
Le roman, c’est une vie sur le papier, plus profonde, plus belle, plus significative que la vie réelle, quotidienne. Comme romancier, pour recréer cette vie, j’ai besoin de plusieurs points de vue, de plusieurs voix. C’est un challenge. Il y a quinze ou même dix ans, j’aurais été incapable d’écrire un roman pareil.
Vous avez progressé ?
Techniquement, c’est sûr !
Cet univers de l’automobile vous est-il familier, ou avez-vous dû faire des recherches ?
Les deux. L’histoire de Karl et Bertha Benz, qui mêle éléments documentés et fiction, c’est un peu un prologue, qui aide le lecteur à sentir le roman. Quant à l’automobile, elle est entrée très tôt dans l’histoire de l’Egypte. La première voiture, française, est arrivée ici en 1890. L’automobile est vite devenue populaire au Caire, et les Egyptiens ont compris qu’elle pouvait aider le business. L’Automobile Club, créé sur le modèle britannique - l’Egypte était encore une colonie anglaise -, faisait se côtoyer deux mondes, deux sociétés, deux classes : les serviteurs, des Noirs amenés d’Assouan ou de Nubie, et les membres du club, des Européens pour la plupart. Mais les serviteurs locaux vont vite se mettre à travailler pour le palais royal.
L’Automobile Club existe-t-il toujours aujourd’hui ?
Le bâtiment, oui, en plein centre, non loin de la place Tahrir et de l’immeuble Yacoubian ! Mon père, écrivain et avocat, était l’avocat de l’ACE. Enfant, j’avais l’habitude de l’y accompagner. Cette histoire, pour moi, c’est un tiroir plein de souvenirs et de sentiments.
Où vous avez décidé de puiser la matière de votre roman ?
Dans un processus d’écriture, les choses les plus importantes, on ne peut pas les expliquer. Mes projets de romans remontent tous à vingt ou quinze ans en arrière. Je les porte en moi, jusqu’à ce que se produise un déclic : c’est ce roman-là que je dois alors écrire, pas un autre.
Quelle est la situation actuelle en Egypte, telle que vous la vivez ? Avez-vous toujours une activité politique, et sous quelle forme ?
La révolution continue ! L’Egypte est en train de se débarrasser du wahabisme, doctrine venue des pays du Golfe à grand renfort de milliards. Le peuple a refusé l’expérience de l’islam politique, qui ne marche pas, et son joug sur la culture. L’Egypte revient à sa culture propre. Le 30 juin dernier, et ce n’était pas un coup d’Etat comme l’a dit l’Occident, une vague révolutionnaire a destitué Morsi, et l’armée a rejoint le peuple. Mais nous avons deux combats à mener. Contre le terrorisme des Frères musulmans, qui assassinent des gens, notamment des soldats, des chrétiens, s’en prennent aux églises. Contre l’ancien régime de Moubarak, dont les structures n’ont pas été détruites, et qui veut revenir au pouvoir. J’ai appelé à descendre dans la rue le 30 juin, je soutiens le mouvement. Quant aux militaires, ils ne doivent pas exister sur la scène politique. Je m’inquiète des lois que le gouvernement du général al-Sissi est en train de prendre, pour limiter les manifestations, imposer les tribunaux militaires… Je ne peux cautionner de telles choses. Je ne suis pas un politicien, mais un écrivain qui défend les valeurs humaines, en publiant des livres et des articles, en manifestant. Je n’appartiens à aucun parti. Je joue seulement mon rôle, comme un Sartre ou un Camus en leur temps - et sans me comparer à eux, bien sûr. On ne peut pas être écrivain sans être révolutionnaire. Chaque mardi, j’écris une chronique en arabe pour le quotidien El Masry El Youm, diffusé en Egypte, au Liban, au Soudan, au Maroc… Elle est ensuite traduite en anglais, et diffusée dans la presse internationale. Mon agent, Andrew Wylie, vient de me négocier un contrat avec le New York Times, en tant que contributing writer, une fois par mois.
Et en français ?
Nous y pensons. Ma chronique va être traduite et proposée à la presse française.
D’où vous vient cet amour pour la France et sa langue, que vous parlez parfaitement ?
De 4 ans à 18 ans, j’ai appris le français en même temps que l’arabe, au Lycée français du Caire. Quand j’y repense, quelle chance d’avoir reçu cette éducation, avec un programme de littérature française très efficace. On étudiait tous vos grands classiques, dont un, en particulier, m’a beaucoup influencé : La Bruyère, avec ses Caractères. Il m’a appris qu’on peut dessiner un personnage, un visage, avec des mots ! Au lycée, vivaient ensemble des jeunes, musulmans, chrétiens, coptes, catholiques ou maronites, et même quelques juifs. On était à la fin des années 1960, après Mai 68, et les profs étaient libéraux, tolérants. Quelques-uns même n’étaient pas croyants. Moi, je suis né musulman, et je suis croyant à ma façon : à mes yeux, toutes les religions sont les mêmes, les dieux incarnent des valeurs humaines (liberté, justice…) et les religions devraient être une manière de les défendre, ces valeurs, pas de les combattre.
Comment fonctionne la vie littéraire en Egypte ? Vos livres sont-ils publiés librement et accessibles à tous ?
Après vingt ans de frustration, je dirais que la révolution en Egypte a commencé par la littérature. On a regagné des lecteurs, et peut-être mon Immeuble Yacoubian a-t-il joué un petit rôle dans ce phénomène, dès 2002. En tout cas, les jeunes révolutionnaires lisent, même si nous manquons de librairies et si les livres sont trop chers. Moi, je suis publié chez Dar el Shourouk, le plus grand éditeur privé du monde arabe. Automobile Club d’Egypte, sorti en avril dernier, s’est déjà vendu à 60 000 exemplaires, ce qui est considérable pour un pays de 85 millions d’habitants, dont 20 millions dans les grandes villes. Chicago, paru en 2007, s’est vendu à 140 000 exemplaires en un an.
Le succès a-t-il changé votre vie ?
Ma vie a été changée, pas moi ! Traduit dans le monde entier, je voyage bien sûr beaucoup. Mais je suis toujours, deux jours par semaine à mon cabinet, un dentiste qui écoute, qui discute, qui aide. On ne peut pas être romancier sans aimer les gens. Mon métier m’est indispensable pour écrire mes livres.
Votre engagement politique vous met-il en danger, en Egypte ou ailleurs ?
Je suis habitué. Dès le début de la révolution, mon nom a figuré sur quatre listes noires. J’ai des ennemis des deux côtés ! J’essaie de faire un peu attention. Mais je ne bénéficie d’aucune protection policière. Ce sont les jeunes révolutionnaires qui me protègent. Mais en octobre dernier, à Paris, j’ai été pris à partie et attaqué à l’Institut du monde arabe, où je devais faire un débat littéraire avec mon traducteur, Gilles Gauthier, par des barbus en bande organisée qui ne m’avaient pas lu et m’ont accusé de vouloir vendre des voitures ! Le président de l’Ima, Jack Lang, était navré et m’a manifesté son soutien, mais apparemment ses services n’avaient pas anticipé le problème… A Marseille, en revanche, où je suis allé après, tout s’est très bien passé. Mes livres sont de gros succès dans toute l’Europe, surtout en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni.
Vous intéressez-vous aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux qui jouent aujourd’hui un rôle majeur dans l’activisme politique ?
J’ai un compte sur Facebook et un million de followers sur Twitter ! Jusqu’en 1998, j’écrivais à la main, privilégiant l’intimité du papier, du stylo. Puis je suis passé à l’ordinateur, qui m’aide à écrire d’une manière plus précise. En 2010, je me trouvais aux Etats-Unis. Moubarak a envoyé à Facebook une délégation, afin de contrôler le réseau en Egypte. Ça a échoué. Mais il avait compris le danger que la liberté d’expression représentait pour son régime. Toutes les dictatures sont les mêmes.
Propos recueillis par J.-C. P.