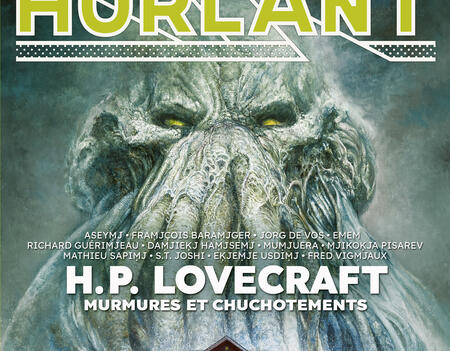Sinistré », « morose », « en chute libre »… les épithètes négatives ne manquent pas quand il s’agit de décrire l’état actuel du marché du livre universitaire. Unanimes sur les symptômes, les acteurs le sont aussi sur leur origine principale : la quasi-disparition de la prescription. « Même si on observe un regain d’activité depuis cet été, nous sommes confrontés à une baisse régulière de la prescription, déplore, chez Dunod, la directrice marketing et communication, Florence Martin. Avant, on en bénéficiait sur une cinquantaine de titres dans un amphi. Maintenant, c’est beaucoup plus atomisé. Elle est peu suivie et les professeurs sont de plus en plus réticents pour recommander des ouvrages. » Pour Alain Panaget, directeur de la librairie Sauramps, à Montpellier, la chute de la prescription est une « évidence » qui repose sur des éléments concrets : « A travers les rapports que nous entretenons avec les quelques étudiants qui fréquentent encore la librairie, ou via le corps enseignant, il est clair que la prescription est abandonnée en tant qu’élément constitutif de l’enseignement. Il ne s’agit pas de stigmatiser une profession, mais le livre a moins de valeur pour beaucoup de professeurs, tandis que certains sont simplement lassés de prescrire des livres à des étudiants qui ne lisent pas. »
Best-sellers
Les éditions de l’EHESS publient justement Devenir chercheur, qui retrace le parcours du doctorant, depuis son enquête jusqu’à l’écriture de la thèse et sa publication. Cet ouvrage sur « la place du chercheur dans la société » redonnera-t-il le goût de la lecture aux jeunes professeurs ?
Car, quand elle est assurée par les enseignants, la prescription garantit les ventes. Chez Dunod, les Mercator, Communicator et autres Strategor (dont la 6e édition est parue à la rentrée) sont des best-sellers parce qu’ils sont prescrits. A La Découverte, des titres récurrents comme L’économie mondiale et L’économie française se maintiennent, avec 5 000 à 6 000 exemplaires en moyenne tous les ans parce que «ces ouvrages sont connus et continuent de bénéficier d’un noyau dur de prescription », assure le P-DG, François Gèze. En revanche, la maison éprouve davantage de difficultés avec les livres prescrits de manière aléatoire. Sans parler des ouvrages non prescrits «qui ont besoin de beaucoup de temps pour s’installer ».
Dans ce contexte de fort recul de la prescription et de tassement des ventes, les éditeurs universitaires font d’abord preuve de prudence quant à leurs nouvelles publications. Armand Colin s’appuie sur la profondeur de son catalogue et réduit sa production d’ouvrages de recherche. «Nous avons connu une petite inflation de titres moins connectés à notre environnement universitaire et prépas concours ces dernières années, nous y avons mis un frein, explique Stéphane Bureau, directeur délégué à l’édition. Le secteur de la recherche est un complément nécessaire, il permet de repérer des talents, de rester au fait de l’évolution de la connaissance et des publications, mais ce n’est pas un axe de développement. Par ailleurs, le fonds se tient bien et représente plus de la moitié de notre chiffre d’affaires. » Directeur général d’Ellipses, Brieuc Bénézet se dit aussi « très vigilant sur les parutions » car « le marché est difficile, avec peu de prescription et peu de pression du résultat, hormis en médecine et en droit ». Ellipses concentre son programme de nouveautés sur des secteurs porteurs comme les prépas, les sciences ou l’internat de médecine. Même discours chez Olivier Jaoui, directeur général de Foucher : « Depuis le début de l’année, nous avons publié plusieurs titres couvrant les concours infirmiers et de la fonction publique, mais les libraires ne suivent pas toujours. Le réassort est bon, mais ne rattrape que partiellement la faiblesse des mises en place. Les libraires font attention à leurs stocks. » Olivier Jaoui craint « des mises en place encore plus faibles à la rentrée, notamment dans les grosses librairies de centre-ville. Nous avons donc été prudents car il n’y a pas de réforme importante en universitaire cette année, rappelle-t-il. Nous ne lançons pas de nouvelles collections, nous n’essayons pas des choses qui seraient surtout de la pompe à office et encombreraient les rayons. Nous restons sur nos points forts qui sont les collections existantes avec quelques nouveautés dans ces collections et des mises à jour. »
Dans un contexte où « les professeurs conseillent davantage, mais imposent moins qu’avant », selon Cécile Colonna, P-DG de Bréal, plus que la prescription, « c’est aussi le bouche-à-oreille entre étudiants qui produit ses effets », observe-t-elle. L’éditeur, dont 70 % de l’activité devrait cette année reposer sur le segment plus porteur des prépas, a légèrement réduit sa production. «Le marché est plus important en prépa qu’à l’université, c’est évident. En fac, on ne vend bien que quand il y a un enjeu, comme pour le Capes ou l’agrégation. Nous nous focalisons donc sur ces thématiques. Dans les niveaux de licence, les ventes sont beaucoup plus diffuses pour les manuels », poursuit Cécile Colonna.
expérimenter le bilinguisme
Hors prescription, les livres de langue continuent cependant à trouver des acheteurs. «Les ouvrages de vocabulaire, de grammaire, fonctionnent très bien, confirme Brieuc Bénézet pour Ellipses. Les étudiants ne s’en tiennent pas à la prescription pour acheter des livres. » Ce sentiment est partagé par Julie Pelpel-Moulian, chez Hachette Supérieur : « Nous enregistrons une croissance sur ce marché, les langues sont un secteur fort chez nous. » A destination des écoles de commerce, Dunod a expérimenté le bilinguisme en publiant deux livres de cas dans la collection « Management sup », l’un en français et l’autre en anglais. « Nous avons développé la version anglaise, intitulée Marketing : 10 case studies. Les cas sont aussi disponibles à l’unité en version numérique, explique Florence Martin. C’est un test, on verra quelle version se vend le mieux. Les enseignants ne sont pas très habitués. Feront-ils acheter un seul cas à leurs étudiants ? Un cas est vendu à 3,90 euros. Le livre avec les 10 cas coûte 27 euros. »
Malgré les difficultés, les éditeurs ne restent donc pas inactifs. La Documentation française a harmonisé sa collection phare « Formation administration concours » (« Fac »). « Nous avions jusqu’à présent un grand format “Fac? et un petit format (ancien “Fac Mémo?, mais qui n’a plus de dénomination officielle depuis cette année). Nous leur avons donné la même couverture », explique Véronique Isambert, responsable du département commercial de La Documentation française. Armand Colin redesssine de son côté les couvertures de ses « Cursus » (la maquette intérieure ne bouge pas). « C’est un axe important pour nous, accompagné d’une vague de nouveautés et de nouvelles éditions dans toutes les matières », annonce Stéphane Bureau. Cette collection est transversale, nous aurons des nouveautés en sciences politiques, en droit, en histoire, en géographie, comme chaque année, mais en insistant un peu plus en raison de ces nouvelles couvertures. »
Hachette Supérieur continue de son côté la refonte de ses « Carré histoire ». «C’est un gros travail de valorisation du fonds. Nous avons la chance d’être reconnus par les professeurs », se félicite Julie Pelpel-Moulian, responsable éditoriale. L’essentiel des nouveautés arrivera en début d’année prochaine. Hachette a tout de même publié Géographie de l’Europe dans la collection « HU géographie ». «Ce titre vise les étudiants plutôt acheteurs, comme en classes prépas, et il a un côté incontournable pour les étudiants de la discipline », poursuit Julie Pelpel-Moulian.
Alors que les sciences humaines forment le domaine qui souffre le plus de la chute de la prescription, les éditeurs continuent d’explorer de nouveaux champs. Le lancement l’an dernier par Armand Colin de « I.com », une collection vouée aux métiers de la communication et de la publicité, a permis à l’éditeur de prendre ses marques sur un nouveau marché et d’engranger des résultats « très satisfaisants ». « Cela montre la nécessité pour un éditeur comme nous, qui a longtemps raisonné par disciplines académiques, de proposer des ouvrages pluridisciplinaires, analyse Stéphane Bureau. Le succès d’Analyser les discours institutionnels, par exemple, alors que le thème semble déconnecté d’un enseignement en particulier, fait apparaître que nous avons touché le public de la communication, des études littéraires, du journalisme et des IEP. »
Armand Colin va donc poursuivre dans cette voie en s’adressant à des publics toujours plus hybrides. Aujourd’hui, « I.com » comprend une petite dizaine de titres parus ou à paraître rédigés par un double éventail d’auteurs : ceux qui viennent des études littéraires et ceux qui sont issus de la communication. Chez Ellipses, Brieuc Bénézet confirme le lancement de la nouvelle collection « Hermès philosophie ». Trois titres ont été publiés dans l’été, et un quatrième à la rentrée. « Cette collection présente les ouvrages de fond, les cours de référence, sur les grands auteurs et les grands domaines de la pensée philosophique », précise Brieuc Bénézet.
Le marketing à la rescousse
Pour renforcer leurs liens avec les étudiants, les éditeurs déploient à la rentrée une large palette d’opérations marketing. Dunod poursuit et étend le jeu-concours inauguré il y a deux ans, qui propose aux étudiants de mettre en scène un ouvrage de l’éditeur par le biais d’une photo ou d’une vidéo. «Nous avons reçu l’an dernier dix-sept vidéos valables et une quarantaine de photos », indique la directrice marketing et communication, Florence Martin, qui précise que le jeu sera cette année encore sur Facebook, mais aussi sur une application mobile de l’éditeur. Le jury sera pour la première fois parrainé par un professionnel de la photo et de la vidéo. « Cela apporte une caution au jeu, souligne Florence Martin. Le gagnant de l’an dernier nous a demandé une attestation de sa victoire, avec l’idée qu’elle l’aiderait à postuler dans certaines écoles. »
Armand Colin propose de son côté 10 euros en Chèques Lire à partir de 25 euros d’achat de ses ouvrages. L’opération est relayée dans les universités et les classes préparatoires, mais aussi par des affichages et de la visibilité dans les vitrines des librairies. Des animateurs sont enfin déployés dans quelques points de vente pour présenter les collections Armand Colin. Dalloz réitère son opération « 1 DVD offert » pour 59,90 euros d’achat. « C’est du soutien à la librairie, souligne Hélène Hoch, directrice éditoriale universitaire. Cette année, nous proposons la saison 1 de la série Braquo. » Même Wolters Kluwer France, surtout présent dans l’édition juridique professionnelle, développe des actions en direction des étudiants : « Nous organisons un concours de plaidoirie avec notre Revue Lamy de la concurrence et avec l’Autorité de la concurrence, explique Bernadette Neyrolles, directrice de l’Infocentre éditions, du pôle droit et réglementation de l’éditeur. Les étudiants qui participent à ce concours constituent une équipe de deux ou trois personnes. La meilleure équipe remporte des monographies. »
Dunod travaille aussi avec les fédérations étudiantes. « Elles fédèrent des BDE dans leur thématique respective, rappelle Florence Martin. Nous faisons du sponsoring et, en échange, les étudiants organisent des colloques où ils montrent nos livres, et ils nous font part des remontées sur le terrain. » Plus classiquement, la mise en place de PLV dans les librairies reste une valeur sûre pour cibler les étudiants. Les collections de révision proposées par Gualino en droit, ou Vernazobres-Grego en médecine, se distinguent particulièrement dans les points de vente. <
Les étudiants plébiscitent les formats courts
Les collections d’ouvrages synthétiques à petit prix et les recueils de fiches sont au cœur des stratégies des éditeurs.
Tous les éditeurs ont fait le constat : les collections privilégiant les formats synthétiques sont celles qui se vendent le mieux. Ils en tirent tous les conséquences. Espérant mieux séduire ainsi les étudiants, Dalloz a refondu en juillet sa collection de révision « Mémentos ». « La maquette est plus accessible, elle fait moins référence, elle colle davantage au concept éditorial », explique Hélène Hoch, directrice éditoriale universitaire. Les manuels d’entrée de gamme de l’éditeur juridique, en « Cours » et « Hypercours », sont également ceux qui se vendent le mieux, devant les classiques « Précis ».
Bréal a lancé en juillet une petite collection destinée aux classes préparatoires commerciales et comprenant des cartes. « Elle n’a pas de nom, elle se repère à ses couleurs, indique la P-DG, Cécile Colonna. Les étudiants achètent beaucoup moins d’ouvrages de cours tels que ceux de la collection “Grand amphi?. Aujourd’hui, en fac, les élèves se tournent vers des titres de révision, plus synthétiques et moins chers. Nous nous adaptons pour répondre à cette demande », précise-t-elle. Dans la même logique, Dunod a inauguré cette année la collection d’entrée de gamme « Les petits experts », qui propose des fascicules de 48 pages. L’éditeur continue aussi de développer son offre en « Mini manuel » et « Tout le cours en fiches ». Dans cette dernière collection, Dunod a notamment publié en mai Chimie organique. «Les étudiants visent l’efficacité et le résultat, on est dans une logique de fiches, avec moins d’académisme, décrit Florence Martin. Ce livre est complété par un important site compagnon ; il est appelé à durer des années. »
De la même façon, Nathan refond entièrement ses « Repères pratiques », une collection de 70 titres de 120 à 140 pages qui « correspond aux usages des étudiants qui ne lisent plus de grosses sommes, explique Charles Bimbenet, directeur du département technique supérieur formation pour adultes. Ces livres font le tour d’une question de manière très pédagogique. Nous avons une vingtaine de titres qui ressortent à la rentrée, c’est un très gros lancement. » La refonte des « Repères pratiques » a pour objectif de défendre l’unité de la collection dans les points de vente. «Les librairies organisent leurs linéaires par thèmes, mais “Repères pratiques? a besoin d’être regroupée pour aller chercher des ventes supplémentaires, plaide Max Prieux, directeur commercial de Nathan. Le lecteur intéressé par un sujet ira trouver le livre qu’il cherche, mais ne saura pas forcément qu’il existe d’autres titres qui pourraient le séduire en achat impulsif. » L’éditeur lance donc une opération de mises en avant sur table, en vitrine ou sur PLV afin d’optimiser l’exposition de la collection.
Ne pas généraliser.
A La Documentation française, « Doc’ en poche », « Réflexe Europe » et les petits formats « Fac » sont tous des poches. « C’est de plus en plus ce qu’attendent les étudiants, estime Philippe Tronquoy, adjoint au responsable du département des ressources et conseils éditoriaux. Il faut être présent sur ce segment, c’est vital. On sait que les étudiants ont des habitudes de lecture qui changent, ils sont sensibles au coût des livres et ils lisent moins. Nous souhaitons continuer à leur offrir une information sérieuse et référencée, mais plus concise. »
Aux Puf, la parution cette année des premiers volumes d’« Une histoire personnelle de la France » au prix unitaire de 14 euros s’inscrit dans la même logique de réduction des prix de vente. Tout comme « La vie des idées », constituée de petits volumes à 8,50 euros, avec trois nouveautés pour l’automne dans cette collection transdisciplinaire dont le public est celui des sciences politiques et de l’économie. « Nous publions des titres mieux adaptés aux attentes des lecteurs en termes de pagination et qui sont moins chers. Cela concerne une partie de la production, mais il ne faut pas généraliser cette tendance à l’ensemble du catalogue », tempère toutefois la P-DG des Puf, Monique Labrune.
Chez Foucher, la série de fiches mémo Tout le semestre est un succès, affirme le directeur général, Olivier Jaoui. «En DEI [diplôme d’Etat d’infirmier, NDLR], nous avons couvert les trois premiers semestres, nous montons une opération de remise en place en librairie avec de la PLV pour les semestres 1 et 3, dit-il. L’an dernier, les titres étaient parus à la mi-octobre. Cette année, c’est au tout début de septembre, on espère donc faire encore mieux. Le prix est accessible. De plus, ces bonnes ventes poussent l’ensemble des titres en DEI. » Foucher renforce la collection avec un titre consacré à la formation d’aide-soignant. L’éditeur a déjà publié en décembre dernier un ouvrage sur cette thématique dans un tout-en-un qui a depuis été réimprimé. En « Sup’ Foucher infirmier », qui propose des titres de QCM et de fiches, deux nouveautés animent enfin la rentrée : Processus inflammatoires et infectieux et Processus tumoraux.
Le souci de proposer des ouvrages bon marché est récurrent, mais il préoccupe aussi les libraires. «La logique des éditeurs est de simplifier les contenus et les maquettes, et de réduire les prix. Mais si on va au bout de la démarche, on arrivera à tout le Moyen Age résumé en dix pages !, s’inquiète Alain Panaget, le directeur de Sauramps, à Montpellier. Economiquement, cela se comprend, mais intellectuellement, c’est participer à l’effondrement du marché en considérant que moins l’étudiant lit, moins il faut lui donner à lire. » <
A la conquête de nouveaux marchés
Plusieurs éditeurs équilibrent leur activité en développant des collections susceptibles de toucher un public plus large.
Et si la solution pour maintenir son compte d’exploitation à flot était la diversification ? Ces dernières années, plusieurs éditeurs ont minoré progressivement la part de leur catalogue estampillée universitaire à travers des collections identifiées ou leurs fonds tombés dans le domaine public et soumis à une forte concurrence. « Quelques éditeurs ont su s’ouvrir à des lignes éditoriales qui ne sont pas seulement inscrites dans l’enseignement, mais qui sont susceptibles d’intéresser un public plus large en tant que citoyen. Les Puf sont dans cette logique depuis dix ans avec des collections comme “Major? ou “Premier cycle? », analyse Alain Panaget, directeur de la librairie Sauramps, à Montpellier. Pour lui, « s’il y a une matière qui était affaire de spécialistes il y a quinze ans, c’est l’économie. On ne trouvait que des ouvrages universitaires et des classiques. Aujourd’hui, l’économie critique occupe une place importante. Ce sont des livres qui décryptent, dénoncent, et qui sont publiés par des éditeurs comme La Fabrique ou Les Liens qui libèrent. Les éditeurs universitaires sont confrontés à ce phénomène ».
Depuis qu’elle a lancé sa nouvelle collection « Doc’ en poche » en février 2012, La Documentation française ne fait pas mystère de sa volonté de conquérir de nouveaux marchés. « Cette collection propose une approche simple sous forme de questions et d’encadrés. Elle épouse notre objectif de toucher un nouveau public », explique Véronique Isambert, responsable du département commercial de La Documentation française. Les deux premières déclinaisons de « Doc’ en poche », « Entrez dans l’actu » et « Place au débat », ont généré des ventes « encourageantes ». Un résultat acquis en partie grâce au savoir-faire d’Union Distribution, à qui La Documentation française fait appel depuis l’été 2012. « Nous avons amélioré notre présence en librairie grâce à ce partenariat, c’était nécessaire à partir du moment où nous proposions des titres plus grand public », poursuit Véronique Isambert. La maison publique lancera en octobre six nouveaux « Doc’ en poche », dont deux dans la troisième et nouvelle déclinaison de la collection « Regard d’expert. »
Auteurs locaux.
La possibilité de toucher le grand public est de mieux en mieux appréhendée par les éditeurs. Quæ, notamment, s’appuie depuis 2010 sur Geodis et la Sodis pour accompagner ses deux collections grand public de vulgarisation scientifique, « Clés pour comprendre » et « Carnets de sciences ». « Cela permet d’avoir des titres forts en librairie et d’être bien placé sur Sciencespourtous.org, qui a été mis en œuvre par le SNE », explique Catherine Thiolon, directrice du développement numérique. Après Paris, Lyon ou Bordeaux, La Découverte poursuit sa série sur la sociologie des villes avec un nouveau titre consacré à Nantes. « Cette série ouvre notre catalogue à un public plus large que l’universitaire. Les ouvrages sont toujours rédigés par des sociologues locaux, ce qui nous permet de mieux nous faire connaître. Nous organisons des opérations de promotion, c’est une bonne diversification », estime François Gèze, P-DG de La Découverte.
Pour le Dictionnaire philosophique d’André Comte-Sponville, publié fin août par les Puf, la P-DG Monique Labrune annonce la couleur : « C’est un livre qui vise à la fois le grand public et l’universitaire. » Avec ses « Repères pratiques », Nathan cible « aussi bien le lecteur curieux que l’étudiant de licence », rappelle le directeur commercial Max Prieux. Dunod recherche d’abord des passerelles entre monde étudiant et monde professionnel, certains ouvrages conçus pour l’un intéressant parfois l’autre, et réciproquement. « Grilles & mise en page est typiquement un titre conçu pour les professionnels du graphisme, mais qui peut être recommandé aux étudiants », illustre Florence Martin, directrice marketing et communication.
Avec la 24e édition d’Exporter, coédité avec Ubifrance, Foucher joue aussi sur les deux tableaux. « C’est la bible des étudiants et des professionnels, mise à jour tous les deux ans. On en vend 3 000 à 4 000 par an en moyenne », indique Olivier Jaoui, directeur général. De son côté, Armand Colin se lance sur le terrain du livre de poche avec « Armand Colin poche ». « Cette nouvelle collection, qui est un axe fort de la rentrée, a vocation à accueillir des manuels et peut aussi intégrer des ouvrages parus dans des collections non universitaires, explique Stéphane Bureau, directeur délégué à l’édition. Les frontières sont floues entre le manuel et l’essai susceptible de séduire le grand public cultivé. » Une première vague de parutions a été lancée le 18 septembre avec six titres en histoire. <
Quelle formule pour le numérique ?
La faible croissance du marché digital limite les possibilités d’investissement des éditeurs.
Les usages numériques peinent à entrer dans les mœurs du monde universitaire, et cela finit par étonner les éditeurs. Pour Florence Martin, chez Dunod, « le retard à l’allumage du marché de l’ebook s’explique par la faiblesse de l’offre, mais cela fait maintenant deux ou trois ans qu’on attend qu’il se produise quelque chose, et le marché n’est même pas émergent». Chez Armand Colin, le directeur délégué à l’édition, Stéphane Bureau, admet que « le numérique progresse plus vite que les ventes papier. Mais, ajoute-t-il, il part de très bas et génère des revenus encore faibles. Les ouvrages d’anglais et de culture générale sont les deux pôles qui tirent les ventes, suivis par les essais sociétaux ou de géopolitique. »« Toutes choses égales par ailleurs, une bonne vente papier se traduit par une bonne vente numérique, mais on ne peut pas dire que l’activité décolle », confirme Julie Pelpel-Moulian, responsable éditoriale chez Hachette Supérieur.
Comment expliquer le flop ? Plusieurs éditeurs pointent des problèmes récurrents d’accessibilité aux plateformes des opérateurs. « Le classement des ouvrages et le référencement pourraient être améliorés chez la plupart des libraires numériques, estime Julie Pelpel-Moulian. L’iBookstore, notamment, est compliqué. On se voit proposer des livres qui ne correspondent pas à la demande effectuée, on ne sait pas où aller pour trouver ce qu’on veut… Un projet de refonte est en cours, mais Apple ne communique pas sur son calendrier. »« Des acteurs comme Apple ou Google - c’est moins vrai pour Amazon qui vend aussi beaucoup de papier - ne sont pas des spécialistes du livre, rappelle aussi Catherine Thiolon, directrice du développement numérique chez Quæ. En tant qu’éditeur, nous avons découvert qu’il aurait fallu requalifier tout notre catalogue. Les classements proposés sur Apple ou Google ne correspondent pas à la culture de la librairie. »
Si les investissements dans le numérique génèrent des retombées encore modestes pour une majorité d’acteurs, Nathan constitue une exception notable. La maison a lancé l’an dernier son opération « Livre nomade », qui permet aux étudiants de retrouver en ligne (sur ordinateur, tablette et smartphone) les PDF des ouvrages papier achetés en librairie physique. Cet avantage proposé par Nathan (les bonus numériques sont intégrés dans les titres papier sans surcoût) a permis d’augmenter de 20 % les ventes des 70 titres concernés à la rentrée 2012, selon Max Prieux, directeur commercial. « Nous avons bénéficié d’un excellent accueil en librairie car les livres ont été très bien exposés », se félicite-t-il. Une quarantaine de nouveautés seront commercialisées en version nomade pour la rentrée 2013 et Nathan prévoit de renforcer sa communication avec une opération « Livre nomade sur table ». «Nous pensons que l’ensemble du public n’a pas encore perçu cette innovation technologique et commerciale, confie Max Prieux. Nous attendons une nouvelle progression sensible pour cette rentrée. »
Plus-produit ou produit à part entière.
Nathan fait pourtant figure d’exception dans un marché du numérique qui reste difficile à appréhender pour une majorité d’acteurs. Le modèle des offres couplant le papier et le digital développé par Nathan est loin de faire l’unanimité. « Le livre numérique n’est pas un plus-produit, c’est un produit à part entière », revendique Julie Pelpel-Moulian, chez Hachette Supérieur. « Plutôt que de miser sur des offres couplées dont les effets sur les ventes sont hypothétiques, il est plus pertinent de proposer des outils en ligne qui enrichissent les contenus papier », renchérit Stéphane Bureau, chez Armand Colin.
Certains, comme Dunod, ont lancé quelques titres bimédias, mais n’ont pas constaté d’embellie notable. «L’an dernier, nous avons publié de nouvelles éditions de nos best-sellers Mercator et Communicator contenant une version numérique intégrée, sans que cela produise d’effet sur les ventes dans un sens ou dans un autre », relève Florence Martin. Cette année, les versions papier et numérique de la nouvelle édition du Strategor, autre poids lourd de la rentrée chez Dunod, font ainsi l’objet de commercialisations distinctes.
Les éditeurs sont par ailleurs loin d’avoir numérisé l’ensemble de leur production ; le passage au digital fait l’objet d’arbitrages serrés. « Nous proposons plus de 2 000 ebooks, mais tout le catalogue n’a pas encore été numérisé. Parfois, nous n’avons pas les droits, notamment en ce qui concerne les traductions. Nous ne pouvons pas non plus numériser les livres en grand format, qui ne seraient pas lisibles sur un petit écran », poursuit Florence Martin. « Encore aujourd’hui, nous ne publions pas systématiquement des versions numériques de tous nos titres car ce n’est pas justifié d’un point de vue comptable », dit aussi Olivier Jaoui, directeur général de Foucher. Un livre sur deux de l’éditeur fait l’objet d’une déclinaison pour ebook. Marilyse Vérité, responsable enseignement supérieur et développement numérique de Foucher, justifie : « Quand on apporte une plus-value sous forme de quiz ou de QCM comme dans les collections “Fiches & QCM?, “Le meilleur du…?, ou “Sup’ Foucher infirmier?, le livre numérique trouve un intérêt. Ce n’est pas le cas pour un pavé de 800 pages. »
Les Puf étendent de même à un nombre limité d’ouvrages la numérisation amorcée l’an dernier avec « Que sais-je ? ». «Cela concernera quelques titres dans toutes les collections, mais il n’y aura pas de numérisation généralisée. Nous avançons à notre rythme », indique la P-DG, Monique Labrune. Les Puf ont également repoussé sine die le développement d’applis sur smartphone « pour des raisons de coût ».
Après un retard à l’allumage, Dalloz annonce de son côté pour l’automne la commercialisation de ses premiers livres numériques universitaires dans les collections « Cours », « Hypercours », « Sirey » et « Précis ». Une soixantaine d’ouvrages sont concernés. L’éditeur juridique n’affiche pas pour autant d’attentes particulières sur cette nouvelle offre. « Nous savons que le numérique reste marginal, reconnaît Hélène Hoch, directrice éditoriale universitaire. Nous avons davantage d’attentes concernant le mariage du papier et du numérique. »
En la matière, Dalloz s’appuie notamment sur le pack Les fondamentaux de votre réussite, destiné aux étudiants de L1, qui inclut le Code civil, le Lexique des termes juridiques papier et des compléments pédagogiques en ligne disponibles sur Dalloz-Etudiant.fr avec dix fiches de révision, dix annales corrigées et quelques podcasts.
Toujours pas convaincu par le numérique, Ellipses passe une nouvelle fois son tour. Enfin, la création d’un bouquet de revues annoncée par La Documentation française est toujours d’actualité malgré un calendrier incertain. Mais pour le moment, l’éditeur n’a pas l’intention d’étendre le concept à ses livres. <
Les BU numériques, vrai débouché pour les éditeurs
Si les ventes de livres numériques en B2C (business to consumer) sont encore faibles, les bibliothèques numériques représentent en revanche un débouché important pour les éditeurs. Elles permettent même de compenser en partie l’érosion des ventes papier. Les 400 « Repères » de La Découverte et les 800 « Que sais-je ? » des Puf, notamment, sont disponibles sur la plateforme Cairn. « Cette double offre de manuels de 1 200 titres se déploie fortement dans les BU et elle est rendue accessible sur les intranet aux enseignants et aux étudiants, se félicite le P-DG de La Découverte, François Gèze. La montée en puissance est bonne et les revenus permettent de compenser la baisse des ventes de l’imprimé ». « La désaffection des étudiants pour les livres papier est partiellement rattrapée par les liens excellents que nous entretenons avec les bibliothèques en matière de publications numériques », confirme Monique Labrune, la P-DG des Puf.
Après avoir démarré avec des revues, puis des ouvrages collectifs de recherche, Cairn.info a poursuivi avec des collections de poche comme « Repères » et « Que sais-je ? » et s’étend maintenant aux monographies, avec toujours une prédilection pour les ouvrages de recherche. « La plateforme s’adresse plutôt à un public d’étudiants avancés et d’enseignants-chercheurs. Nous démarrons ce nouvel axe avec les éditeurs déjà présents sur Cairn », détaille François Gèze. Les utilisateurs de bibliothèques numériques ne sont pas pour autant perdus pour le papier. « Ce n’est pas parce qu’un livre est disponible sur un bouquet que vous n’aurez pas des achats papier, à partir du moment où l’ouvrage constitue le socle même de l’enseignement. J’ai des étudiants qui ont acheté des ouvrages que je conseillais alors qu’ils étaient disponibles gratuitement à la bibliothèque », témoigne un professeur d’université. Un avis corroboré par François Gèze : « Nous disposons de quelques enquêtes sur les Etats-Unis, où les pratiques sont très en avance. Or, même là-bas, les livres de textes sont peu lus sur des tablettes. Les bases de données sont très utilisées, mais davantage pour les articles, l’e-learning… Il y a des usages qui font qu’on feuillette des livres en ligne pour se documenter, mais lire un livre complet pour l’étudier sur son support personnel, ce n’est pas la tendance. » <
« Les professeurs doivent redevenir des auteurs »
Pour Matthieu de Montchalin, P-DG de la librairie L’Armitière à Rouen et président du Syndicat de la librairie française, le marketing ne suffit pas à résoudre le problème de la prescription.
Aucune maison d’édition du secteur, à ses yeux, ne tire actuellement son épingle du jeu. Pour Matthieu de Montchalin, P-DG de la librairie L’Armitière, à Rouen, et par ailleurs président du Syndicat de la librairie française (SLF), le déclin du livre universitaire semble en effet irrémédiable… à moins de remettre les enseignants au cœur du processus d’édition.
Livres Hebdo - Comment expliquez-vous la mauvaise santé du marché ?
Matthieu de Montchalin - La cause principale est qu’il n’y a plus de prescription efficace, sauf dans les filières sélectives comme les classes préparatoires ou les écoles d’infirmières. Les élèves et leurs parents savent qu’ils s’engagent sur une période longue de travail et veulent se donner les chances de réussir. Quand on sort de ces filières, notamment en sciences humaines, la prescription est quasi nulle, à tel point qu’on ne fait pratiquement plus de commandes de rentrée universitaire. Plutôt que des mises en place massives, on privilégie l’installation de nombreux titres en petite quantité car plus personne aujourd’hui ne peut prévoir les titres qui se vendront. C’est ensuite notre travail de libraire de réagir rapidement quand une prescription importante se déclenche.
Comment expliquez-vous cette quasi-disparition de la prescription ?
Il y a encore quinze ans, tous les manuels étaient écrits par des enseignants d’université et la plupart des enseignants de Rouen - pour parler de notre zone de chalandise - s’efforçaient d’écrire des manuels. Aujourd’hui, les jeunes professeurs écrivent beaucoup moins. Le réflexe livre a disparu pour cette nouvelle génération d’enseignants. Il faut réintroduire la prescription dans l’universitaire et, pour cela, il faut que les professeurs redeviennent des auteurs. Les éditeurs doivent réexpliquer les vertus du livre aux enseignants. Cela peut paraître bizarre, mais je crois que c’est nécessaire.
Cela suppose-t-il, selon vous, que les éditeurs s’impliquent davantage et plus en amont dans la prescription de leurs ouvrages ?
Le SLF les alerte depuis plusieurs années sur cette question. Les éditeurs n’assurent pas le travail de prescription auprès des enseignants, alors qu’ils le font dans le scolaire et le secondaire, où cette stratégie porte ses fruits. Ils lancent des campagnes marketing, offrent des tablettes, proposent des places de cinéma, des réductions pour partir à l’étranger… mais le marketing ne permet pas de résoudre le problème de la prescription. Nous sommes au-delà d’un problème de concurrence entre éditeurs, dont la solution passerait par des coups marketing. Nous sommes face au défi d’un marché qui s’effrite structurellement. Ce qui m’étonne le plus, c’est que les éditeurs importants du marché universitaire, souvent bien implantés par ailleurs sur le marché du primaire ou du secondaire, ont su y faire du lobbying à travers l’association Savoir Livre pour que la prescription ne disparaisse pas et pour que le livre reste au cœur des préoccupations. On doit sensibiliser les étudiants et leurs familles au fait que le livre n’est pas un accessoire parmi d’autres. Comment mener des études de philosophie sans lire les textes ? On ne peut pas s’en sortir avec Wikipédia et un polycopié. Ce travail de sensibilisation appartient aux éditeurs, aux libraires et au monde éducatif. Il faudrait mettre en place une campagne de communication des éditeurs, soutenue par les libraires, dans laquelle on verrait les grands universitaires, les prix Nobel français, expliquer pourquoi, sans le livre, ils n’auraient jamais réussi leur carrière.
Pourquoi cela ne se fait-il pas ?
Les éditeurs travaillent au niveau de leur marque, alors que le problème est beaucoup plus profond. Ce qui est remis en cause par les étudiants, leurs familles et les professeurs, ce n’est pas le travail de tel ou tel éditeur, c’est l’utilité même du livre. Aujourd’hui, plutôt que d’essayer de faire grimper une petite collection, il faudrait déployer des efforts collectifs et sur le long terme pour réinstaller le livre au cœur des problématiques des étudiants.
Le recul du pouvoir d’achat ne contribue-t-il pas aussi aux difficultés du marché universitaire ?
Bien sûr, il y a des problèmes économiques, mais ils concernent tous les secteurs de la vie, pas uniquement le livre. Beaucoup d’acteurs ont pensé qu’ils régleraient la question en baissant le prix de leurs ouvrages, mais cela ne produit aucun effet, si ce n’est une spirale déflationniste dont la conséquence est que les éditeurs disposent de moins en moins de moyens pour lancer de nouveaux titres et rémunérer des auteurs qui pourraient devenir de nouveaux prescripteurs.
Hors des ouvrages relevant de la prescription, les éditeurs développent fortement les ouvrages de révision, de fiches, de QCM, qui eux se vendent mieux.
Ces bons résultats concernent presque toujours les filières sélectives. Quand le cursus est exigeant, les étudiants investissent. Le problème, c’est la masse des étudiants présents dans des cursus peu sélectifs et qui ne prennent plus l’habitude de travailler avec des livres. De nombreuses universités ne donnent plus de listes de prescription au moment des inscriptions. Des enseignants en histoire nous racontent que leurs élèves s’étonnent quand on leur demande de lire des livres en plus du cours qui leur est dispensé.
Certains éditeurs, comme Nathan avec le Livre nomade, développent des offres couplées papier-numérique et annoncent des résultats probants pour leurs ventes. Ces approches constituent-elles une réponse efficace pour l’avenir du livre universitaire ?
L’offre de Nathan est intéressante car elle introduit les librairies dans la chaîne du numérique. Je salue cette initiative. Je préfère cela à des éditeurs qui travaillent en direct avec leurs clients et laissent les libraires se contenter de la vente déclinante des ouvrages papier, comme tous les éditeurs de droit dont l’attitude montre qu’ils ont fait une croix sur la librairie. Quant à savoir si le Livre nomade de Nathan répond réellement aux attentes des étudiants, on manque encore de retours d’expérience. Je ne suis pas sûr que les étudiants perçoivent réellement ce plus-produit. On en revient à la question de la promotion.
Dunod a également proposé le Mercator et le Communicator en version hybride, mais sans impact sensible sur leurs ventes.
C’est parce qu’il s’agit d’ouvrages prescrits. Le plus-produit du numérique n’est utile que pour les livres qui ne font pas l’objet de prescription et qui sont en concurrence les uns contre les autres. Quand l’étudiant a le choix, il peut s’appuyer sur ce facteur pour choisir son livre. A l’inverse, dans le cas d’un ouvrage prescrit, les étudiants ne se risquent pas à acheter un autre livre, même s’il propose un contenu numérique supplémentaire. On peut toutefois imaginer que les bonus numériques seront aussi un moyen de séduire les professeurs pour la prescription.
Quel regard portez-vous sur le développement des livres de poche dans les rayons universitaires ?
C’est une façon comme une autre de baisser les prix. Je ne dis pas que c’est inutile. Mais encore une fois, je pense qu’on s’attaque aux conséquences du problème, et non aux causes. Quand vous partez de zéro et que vous faites un gros effort pour lancer une collection de poche, cela peut fonctionner. Mais les éditeurs doivent consentir un effort important de mise en place pour atteindre le même résultat en année 2. Les coûts induits sont difficiles à reproduire à chaque rentrée. Les lancements successifs de nouvelles collections en universitaire tendent plutôt à montrer que les collections existantes sont mal implantées. Sinon, il n’y aurait pas besoin d’en lancer tous les ans.