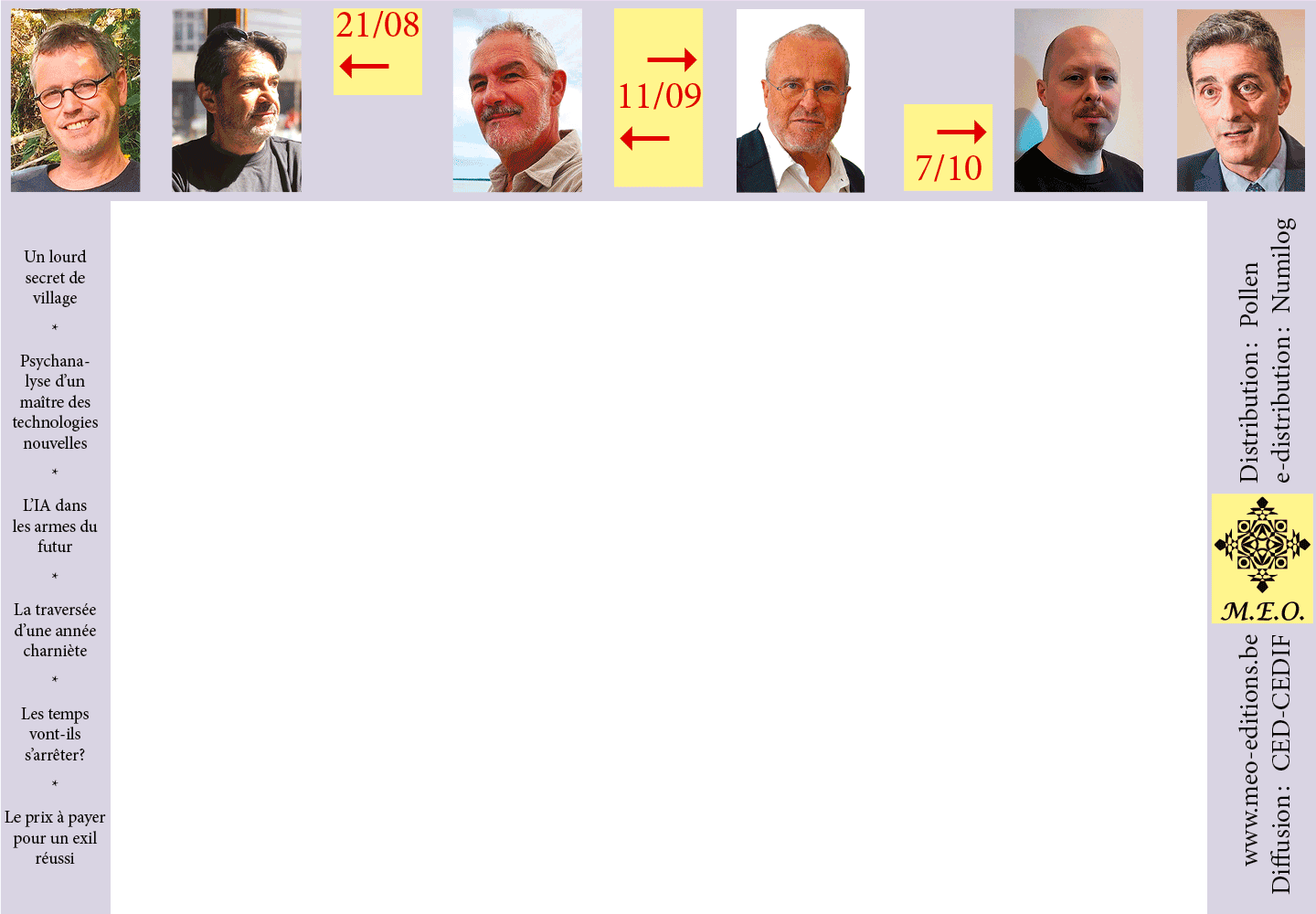Il aura 80 ans le 28 mars. Il est le premier étranger à entrer de son vivant dans la "Bibliothèque de la Pléiade". Son nouveau roman, Cinque esquinas ("Cinq coins de rue", du nom d’un quartier "difficile" de Lima), est paru le 2 mars chez Alfaguara, pour l’Espagne et l’Amérique latine. La traduction française est en cours. Mario Vargas Llosa évoque son parcours et ces honneurs, ses engagements et son amour pour la France, où il a vécu de 1959 à 1967.
Mario Vargas LLosa - Entrer dans la "Pléiade" m’a donné plus de joie que de recevoir le prix Nobel de littérature. Non que je déprécie le moins du monde le prix Nobel, mais, depuis que j’ai appris le français et que je peux le lire, la "Pléiade" représente pour moi le meilleur de la littérature, et pas seulement de langue française. Par exemple, les grands écrivains russes, Tolstoï, Dostoïevski, je les ai lus dans cette collection. Ce privilège m’impressionne énormément, je le dois à mon éditeur, Antoine Gallimard, et aux lecteurs français qui m’ont toujours traité avec beaucoup de tendresse. J’en profite pour exprimer ma gratitude à Stéphane Michaud et à son équipe de collaborateurs, à Albert Bensoussan, formidable traducteur, à Hugues Pradier et à son équipe. La "Pléiade" est une collection unique, et c’est pour cela qu’elle est lue dans le monde entier. Elle offre le meilleur de la culture dans des éditions qui sont un modèle de rigueur intellectuelle, de présentation élégante et avec des commentaires critiques, chronologiques et biographiques qui enrichissent extraordinairement la lecture. Depuis ma jeunesse, là-bas au Pérou, j’ai pris l’habitude de m’offrir au moins une fois par an un volume de la "Pléiade". C’est là que j’ai lu les grands de la littérature française, Montaigne, Balzac, Baudelaire, et bien sûr mon maître, le cher Flaubert. Je suis sûr que, dans le monde entier, il y a des milliers et des milliers de jeunes qui sont venus à la littérature française grâce à la "Pléiade".
Il me semble que ce sont les romans les plus représentatifs de ce que j’ai écrit. S’y manifeste mon attention aux problématiques péruvienne et latino-américaine, mais aussi pour l’histoire, l’une des sources les plus riches de mes fictions. Même si ma vocation première fut le théâtre, j’aime toujours beaucoup le roman.
Ce prix a été créé par une fondation qui porte mon nom et fonctionne, de manière totalement autonome, depuis Madrid, avec la participation d’illustres intellectuels espagnols et latino-américains. Je suis très reconnaissant à son directeur, Juan Jose Armas Marcelo, et à ses collaborateurs, mais je n’interviens pas dans les activités de la fondation, je ne fais ni ne ferai jamais partie du jury.
Ce qui m’unit à la France, c’est sa culture, telle que je l’ai découverte quand j’étais encore enfant grâce à Jules Verne, Alexandre Dumas, Paul Féval et le grand Victor Hugo. Le meilleur de cette culture est son universalisme, le fait de penser, créer et écrire sans se sentir jamais limité par les frontières géographiques, linguistiques, idéologiques ou religieuses, comme si les penseurs, artistes et écrivains avaient l’obligation de toucher tous les publics, dans un langage accessible à tous. Après l’universalisme, mon grand amour pour la culture française est dû à la passion pour la liberté, chez ses meilleurs représentants, cette volonté de ne pas accepter la vie et la société comme elles sont, cet acharnement à vouloir les transformer pour qu’elles soient meilleures, et à la hauteur de nos désirs et aspirations.
Non, je lis surtout les morts ! (Rires.) Parmi mes autres modèles, il y a Sartre. Je l’ai suivi avec passion, dans ma jeunesse, dans tous ses méandres politiques et idéologiques. Ensuite, j’ai pris mes distances, mais je crois que son idée de la "littérature de compromis" demeure vivante en moi, malgré mon désaccord avec les positions idéologiques de sa dernière époque. Pour moi comme pour toute ma génération, l’existentialisme a été très important. J’ai été un lecteur fervent de Sartre, de Merleau-Ponty, de Simone de Beauvoir, et même du catholique Gabriel Marcel ! Mais, tout compte fait, je leur préfère Camus, le plus artiste et le meilleur prosateur de tous, et aussi le plus lucide. Son idée selon laquelle, quand la politique se sépare de la morale, la violence s’installe, continue de m’apparaître, surtout dans ces temps de terreur et de terrorisme, comme valide. Je voudrais aussi saluer un autre grand écrivain, injustement déprécié en France comme romancier, André Malraux. La condition humaine est l’un des grands romans du XXe siècle. Je l’ai lu trois ou quatre fois, chaque fois plus convaincu que c’est un chef-d’œuvre. Il y a aussi le détestable Céline qui, malgré tout, et surtout malgré son stupide antisémitisme, est un autre des grands romanciers du XXe siècle.
Je suis un écrivain péruvien, latino-américain, européen, et j’essaie d’être, dans la mesure du possible, un citoyen du monde. Le nationalisme me semble une des formes les plus agressives de la stupidité et, avec la religion, la source majeure de la violence et des tueries qui ensanglantent l’histoire du monde. La violence n’est belle qu’en littérature et en art, c’est pourquoi je suis partisan de la démocratie et du libéralisme, les deux systèmes qui ont le plus fait progresser l’humanité.
Je m’en souviens avec nostalgie. Le Paris des années 1960 était très différent d’aujourd’hui. L’argent y était moins important, la culture beaucoup plus. Il y avait une fraternité très vive et, bien que certains prétendent le contraire, les Parisiens d’alors ouvraient leurs bras aux étrangers et nous, les étrangers, nous sentions chez nous à Paris. La culture était dans l’air que l’on respirait et les idées importaient beaucoup plus que les images. Aujourd’hui, c’est exactement le contraire. Les polémiques littéraires débordaient des cafés de Saint-Germain-des-Prés et arrivaient jusqu’à la banlieue. Je n’oublierai jamais comment, au lendemain de mon passage à "Apostrophes", les gens me reconnaissaient dans la rue et dans le métro ! C’est la stricte vérité.
Oui, sans aucun doute. Les écrivains doivent participer à la politique et se compromettre. Et donc aussi les peintres, les musiciens et tous les citoyens en général. La démocratie est participation. Si on ne participe pas, on n’a pas le droit de protester, ni de se plaindre. Précisément parce que le monde est sous la menace de la terreur, avec les fanatiques et la résurrection des vieux démons (le fanatisme, le racisme, l’utopisme révolutionnaire), il est indispensable de défendre la démocratie et de combattre le catastrophisme. Nous n’avons jamais eu tant d’armes en main pour progresser. Si j’avais été élu président du Pérou, je serais mort ! (Rires.) La situation était atroce à l’époque. J’ai été battu, je ne recommencerais pas, mais je ne regrette rien, cela m’a beaucoup appris.
Bien que la corrida soit un art immémorial, c’est en Espagne qu’il a atteint sa perfection artistique. Défendre la corrida n’est pas défendre la cruauté, mais un art ancestral, où se combinent la danse, la lutte, la peinture, la musique et le défi à la mort. Une grande corrida n’est pas moins importante qu’un grand poème, un tableau de Picasso ou une symphonie de Mahler. Si les corridas disparaissaient, ce sont les taureaux de combat qui disparaîtraient. La France l’a bien compris, puisqu’elle est le premier pays du monde à avoir classé la corrida "bien culturel". L’Espagne et les pays latino-américains devraient suivre cet exemple, et celui des Indiens du Pérou, qui célèbrent leurs fêtes patronales avec des corridas. Personne n’est obligé d’y assister, mais chacun doit respecter ceux qui aiment ce spectacle qui, d’une certaine façon, représente le dilemme crucial de la condition humaine, laquelle se débat entre la vie et la mort.