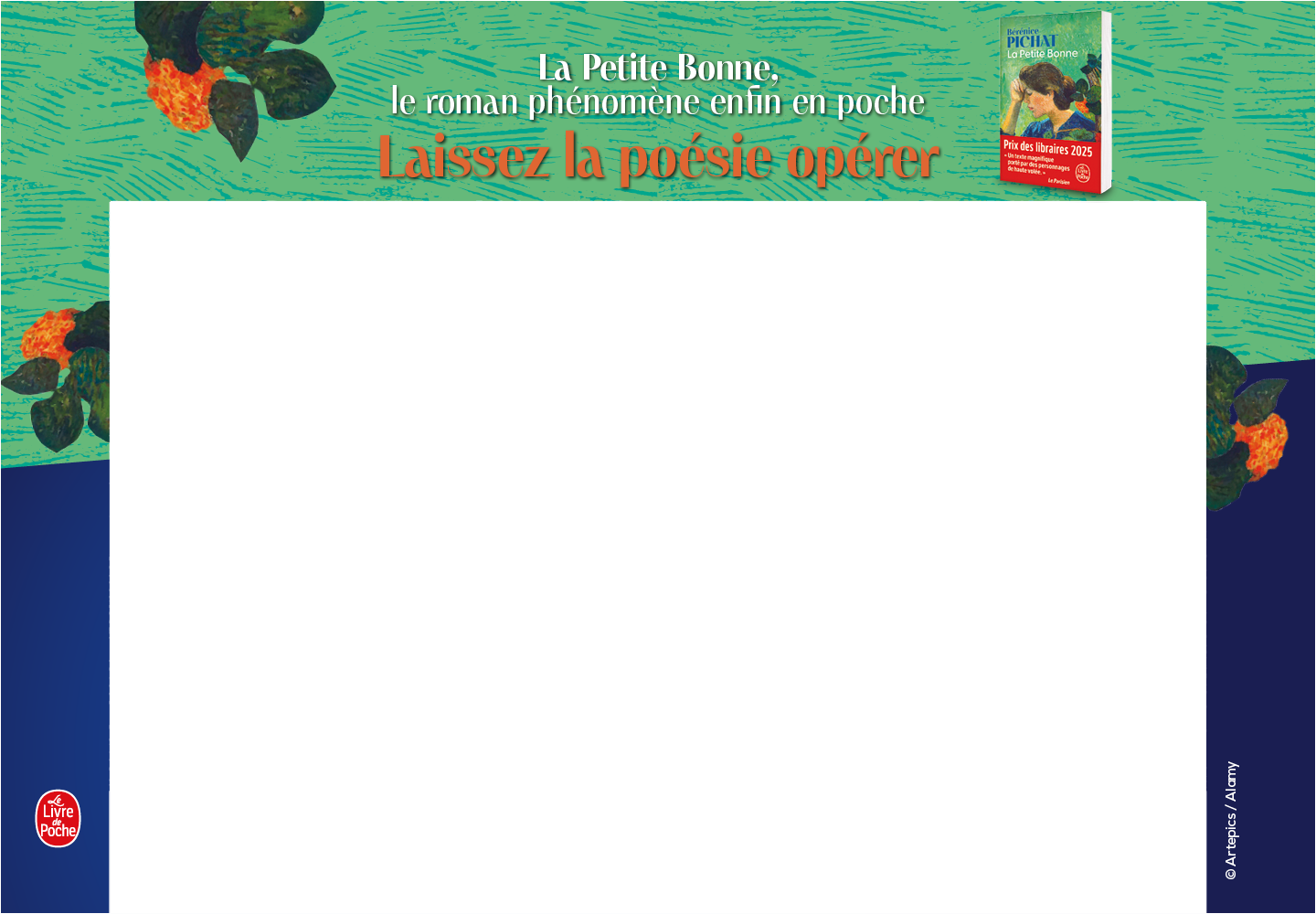L'empire des sens. Dans les dernières lignes de L'intemporel, le troisième volume de sa trilogie illustrée sur l'art paru en 1976 chez Gallimard, l'année de sa mort, André Malraux évoque une ultime fois le Shiva Nataraja d'Ellorâ, dansant, « hérissé de bras et de flammèches », et s'interroge : « Qui pourrait tuer l'immortalité ? » En revenant à un art indien qu'il avait découvert dès sa jeunesse dans les salles du musée Guimet puis « collecté » au Cambodge et au Pakistan, l'écrivain bouclait une longue histoire. Parce qu'il fut l'un des premiers et rares intellectuels occidentaux à intégrer dans sa réflexion sur l'art celui de l'Inde, incluant même deux de ses avatars particuliers : l'art khmer et l'art du Gandhara, dit « gréco-bouddhique » − une dénomination qui ne satisfait pas les spécialistes, mais a le mérite de la clarté. Malraux, surtout, à travers l'immortalité du dieu et de sa statue, insistait sur une donnée fondamentale concernant l'art indien, hindou ou bouddhique : sa dimension spirituelle. En Inde, tout est religion.
Dans son Génie de l'art indien, essai plus qu'ouvrage d'histoire, Vincent Lefèvre, archiviste paléographe, directeur des collections du musée Guimet et indianiste éminent, explore en détail l'art indien, après avoir essayé de borner, concernant l'Asie, la conception même d'« art », puis de délimiter l'espace de cet art indien, lequel, bien plus vaste que son appellation le laisse entendre, correspond à toute l'Asie du Sud. Il finit par conclure : « L'art indien ne fait donc pas tant appel à l'intellect qu'aux sens pour inviter à une expérience sensorielle qui [...] se savoure. » Il aurait pu ajouter « spirituelle ». Et établir un parallèle avec la musique indienne, sacrée : impossible d'aborder un râga interprété par Ravi Shankar avec nos pauvres oreilles occidentales. Henri Michaux l'avait parfaitement senti, perçu, lui qui, dans « Un barbare en Inde » (partie d'Un barbare en Asie, Gallimard, 1933), écrivait : « N'oubliez jamais cela, l'Inde chante. »
Vincent Lefèvre retrace, entre autres richesses de ce livre somme, parfois un peu ardu pour le profane, la perception en plusieurs phases de l'art indien par les Occidentaux : d'abord l'incompréhension totale, puis la réprobation morale scandalisée de chrétiens face au paganisme le plus délirant qui soit − on exceptera l'art moghol, civilisation « plaquée » au nord de l'Inde dès le XVIe siècle, et qui a fini par cohabiter avec le terreau dravidien originel du Sud − et enfin, à partir de la période coloniale (XVIIIe siècle), les premières tentatives de connaissance et les débuts de la science indianiste. Encore fallait-il prendre en compte une histoire de plus de 5 000 ans, jamais écrite en tant que telle (sinon par les mythes et les textes sacrés), et une diversité ethnique, linguistique, culturelle, religieuse unique au monde − laquelle dure encore aujourd'hui. Parmi l'un des rares admirateurs de l'art de l'Inde, Auguste Rodin s'enthousiasma lui aussi pour le fameux Shiva : « Aujourd'hui, c'est immuable de beauté dans le bronze. [...] Il faut étudier plus pour s'intéresser et voir. » Il faut sans doute être un artiste, écrivain, poète, sculpteur, photographe... pour (tenter de) comprendre l'Inde. Et l'aimer.