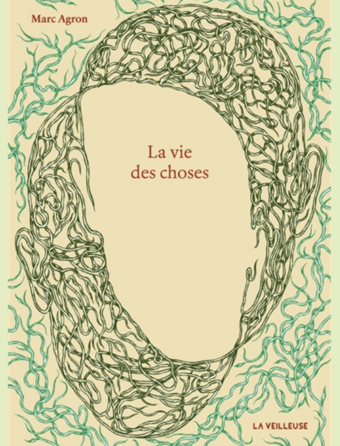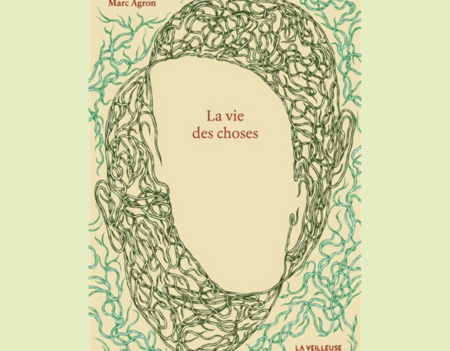C'est l'histoire d'un garçon ; il meurt. Et il va mettre à mourir tant de temps (et pourtant, une si jolie et paradoxale bonne volonté) qu'autour de lui tout s'éteint aussi : les années, les paysages, les visages, les villes, les maisons, son pays, l'horizon. Si ce n'est quelques voix au fond du jardin, une guirlande de souvenirs qui clignotent dans la mémoire et dont le dernier tour de piste nous offre comme des éclats purs de littérature.
C'est donc l'histoire du livre que l'on n'attendait plus, que l'on ignorait même espérer, Du temps qu'on existait, un premier roman foutraque comme la jeunesse, si beau qu'il pourrait être une oeuvre ultime. Son auteur, Marien Defalvard, a dix-huit ans. La belle affaire. On a l'impression qu'il les a de toute éternité, comme Radiguet, Rimbaud ou Desbordes avant lui. Et après ? Rien, si ce n'est ce livre qui est un tout. Roman (c'est ce qu'indique la couverture, alors va pour le roman) des mondes engloutis, ainsi qu'il sied au romanesque vrai, Du temps qu'on existait suit son narrateur le temps d'une parenthèse ouverte et refermée sur son enterrement, sur sa vie même, passée à faire son deuil comme on fait sa pelote... Il y aurait donc dans ces pages une France, bourgeoise et provinciale, qui agoniserait doucement (et non sans style) entre les années 1970 et ce début de siècle, dont on devine que ni l'auteur ni ses personnages ne veulent rien savoir. Qu'on ne s'attende pas à la sagesse bien peignée des narrations trop sûres d'elles-mêmes, le fil biographique est ici le miroir aux alouettes d'une mémoire en lambeaux. Tout fout le camp, tout est sens dessus dessous, à commencer par le souvenir des jolies choses. Le vieux monde est mort et il s'agit, encore une fois, de "courir plus vite que la beauté".
Bien sûr, Defalvard fait son Proust, il n'est pas le premier, mais il le fait très bien. Passent Lyon, la Bretagne, Strasbourg, Paris en hiver et, en guise de Combray, un château quelque part au centre de la France. Passe l'amour aussi, comme une chanson oubliée. Ce n'est pas tant que Marien Defalvard ait de l'ambition pour la littérature (même s'il se tient, avec une belle insolence, résolument de ce côté-là), ce serait plutôt l'inverse. Son livre, fascinant, reprend les choses là où on l'on avait cru les laisser à jamais : à l'aménagement du territoire romanesque.