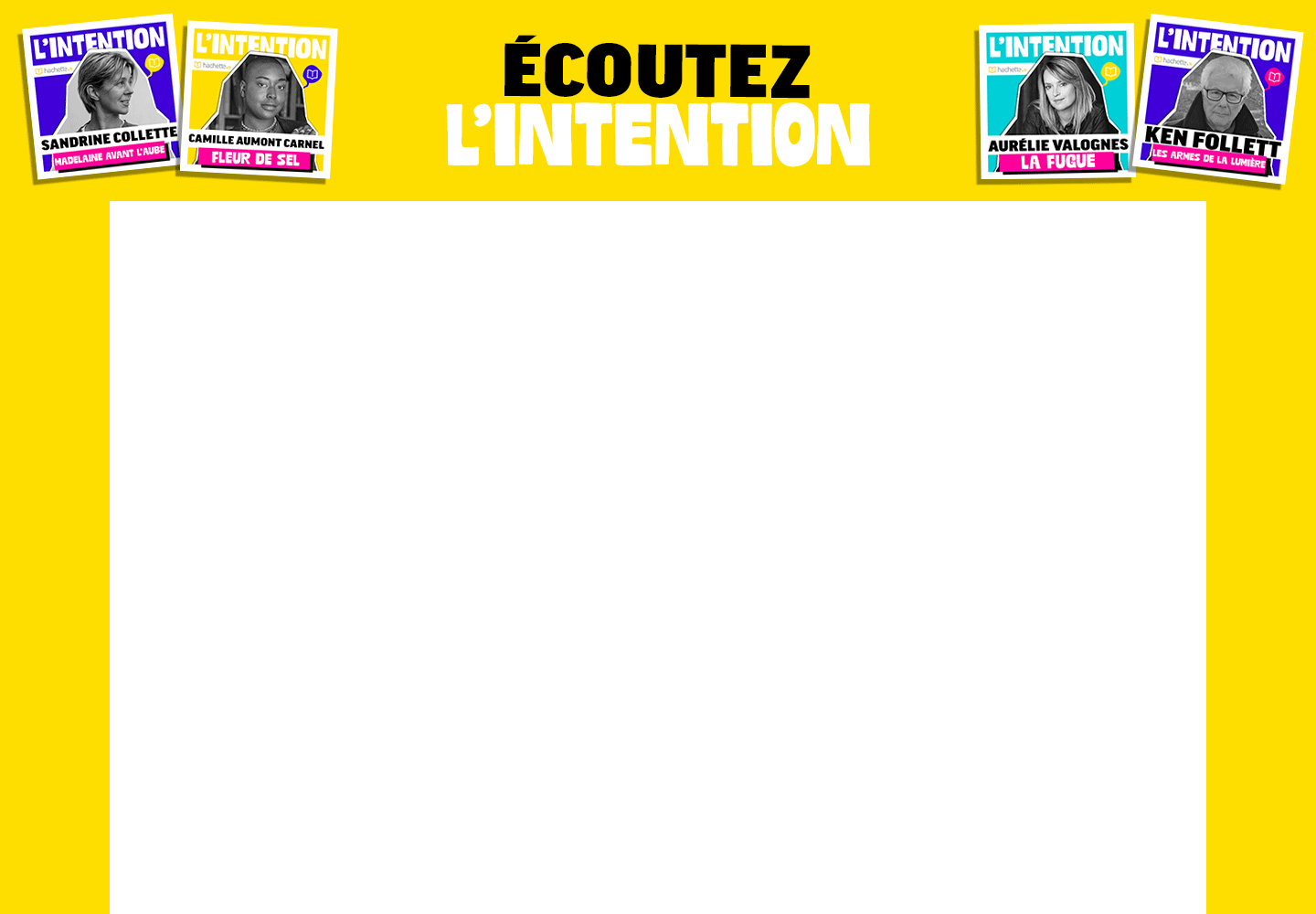Deux hommes d'un âge certain, dont l'un est l'amant de la femme de l'autre, chantant et dansant ensemble au rythme du Daddy cool de Boney M, cela n'existe pas. Une docte conversation entre exilés iraniens pour déterminer si le fait qu'elle fût clitoridienne puisse être la raison de la répudiation de la princesse Soraya, pas davantage. Une thèse (colossale et inachevée par nature) tendant à prouver que rien n'a échappé à l'observation sagace de Karl Marx, aucun secret, pas plus ceux des statues de l'île de Pâques que du monstre du Loch Ness, encore moins. Cela n'existe pas, bien sûr ; mais cela a existé et composé quelques-unes des mille et une facettes d'un homme qui, mort comme vivant, savait tout faire, sauf peut-être se laisser oublier. C'était le père de Yassaman Montazami. Il s'appelait Behrouz. En persan, cela signifie "le meilleur des jours"...
Française depuis l'âge de 3 ans, Yassaman Montazami est née à Téhéran de parents iraniens de culture musulmane et athées. Avec ce Meilleur des jours, son premier roman, dont il n'est pas interdit de penser qu'il est avant tout un récit, elle fait preuve d'une belle audace justement récompensée. Adresse au père disparu en même temps que chant d'exil, le livre aurait pu charrier, comme trop souvent en pareil cas, un torrent limoneux de bons sentiments, se livrer à un quelconque chantage compassionnel. Ces vulgarités-là ne semblent pas être le genre de la maison. Montazami désamorce ce risque par l'adoption d'un ton très intrigant, empreint tout à la fois de loufoquerie et de gravité. On songe en la lisant au scénario qu'aurait pu en tirer un Ettore Scola ou un Fellini première manière. On songe aussi - et c'est moins surprenant mais tout aussi flatteur - à la façon dont Kéthévane Davrichewy avait résolu ces mêmes problèmes dans sa Mer Noire (Sabine Wespieser, 2010). On songe enfin, que ce serait bien le diable si un beau livre n'en annonçait pas d'autres.