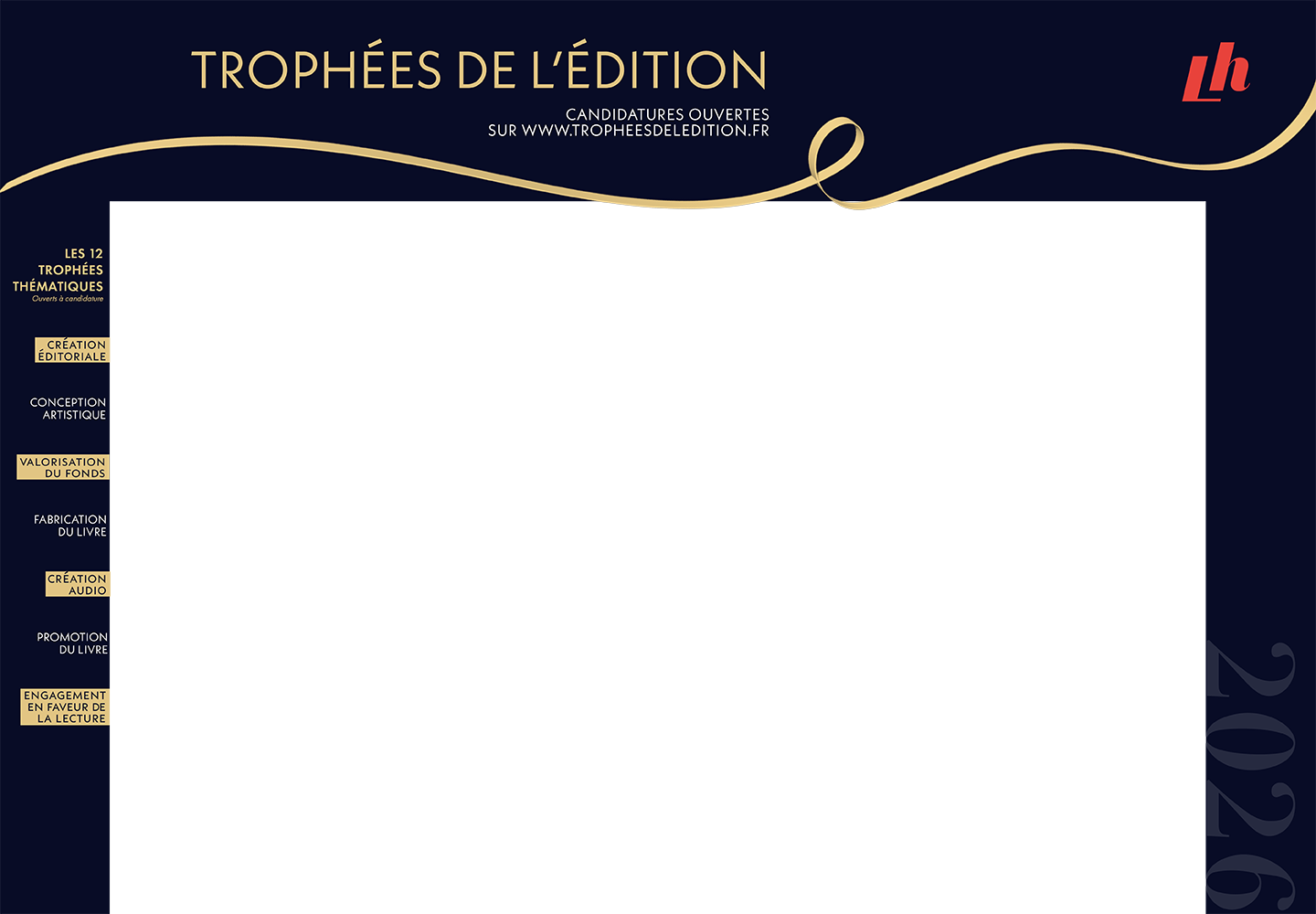En quoi le monde du livre contribue-t-il au bien-être ?
Christophe André : Le bien-être ne consiste pas seulement à s'occuper de ce qu'on mange, à faire de l'exercice physique ou à être bien entouré, c'est aussi élargir sa vie grâce à l'imaginaire, rentrer dans d'autres mondes que celui de notre quotidien. Les libraires et bibliothécaires offrent, via les livres, la possibilité pour chacun d'accéder à des expériences d'autres humains. En lisant, je me connecte à l'expérience d'une personne, crée des extensions de moi-même. Le roman augmente la capacité d'empathie. Le libraire vend de l'enrichissement personnel à prix accessible.

Quant aux bibliothèques, outre le prêt de livres, elles offrent un espace de confort pour accéder à la lecture. Pour certains, il y a toujours la télé qui braille à la maison et de la promiscuité. Ils trouvent à la bibliothèque un lieu où ils ne sont ni sollicités, ni dérangés. Et pour des personnes isolées, elles créent un lien. Les bibliothèques sont des lieux de vie et de socialisation dans une société où beaucoup sont seuls, des lieux de culture dans une société qui considère la culture comme quelque chose d'optionnel.
Quelle est la place du livre dans votre pratique professionnelle ?
C. A. : Le livre est un outil central dans ma façon de traiter les patients. Même avant de publier, je prescrivais beaucoup de livres, dont j'avais réalisé le pouvoir pédagogique, clarificateur, explicatif des souffrances psychologiques. Quand j'ai démarré la psychiatrie à la fin des années 1970, l'univers de la souffrance psychologique et sa reconnaissance sociale n'étaient pas aussi développés. Les gens se dévalorisaient d'aller mal, d'avoir des attaques de panique, ils n'en parlaient pas. Ils étaient soulagés de trouver des livres qui montraient exactement ce dont ils souffraient, à la fois la description de leurs troubles et les conseils pour s'en sortir. J'ai rarement eu un patient à qui je n'ai pas recommandé de lectures, évidemment des ouvrages de psychologie mais parfois de la poésie ou de la fiction. Je demande parfois à mes patients de lire La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï par exemple pour voir comment la façon dont on meurt reflète la façon dont on a vécu et comment il faut s'occuper de cela avant le dernier moment. Je prescris souvent des lectures de poèmes ou les livres de Christian Bobin comme son autobiographie, Prisonnier au berceau. Pour moi, le livre représente un partenaire très important.
Lire peut soigner, c'est du moins ce que prône la bibliothérapie.
C. A. : Il y a des critères à respecter pour pouvoir parler de bibliothérapie au sens strict. Quand on prescrit un livre, on explique au patient ce que l'on attend, on demande de lire un chapitre en particulier puis on y revient, on le commente. On voit si le livre devient un outil thérapeutique, s'il a été relu, surligné... L'écriture, elle aussi, est soignante, au-delà de sa valeur artistique. Il existe de nombreux travaux assez probants depuis les études du professeur américain James Pennebaker [professeur au sein du département de psychologie de l'université du Texas, à Austin, NDLR], qui a été le premier à montrer que demander aux gens qui avaient vécu des événements douloureux de les mettre en mots avait des effets bénéfiques sur la santé du corps et de l'esprit. Des études récentes de neuro-imagerie montrent que plus on arrive à mettre des mots sur des ressentis douloureux, plus cela pacifie les amygdales cérébrales (zones de traitement des émotions douloureuses).
Quels sont les bienfaits de la pratique de la lecture ?
C. A. : On peut déjà considérer la lecture comme un exercice de musculation attentionnelle. Elle nous rend capables de poser notre attention sur un objet qui, contrairement à un écran, ne nous envoie aucune alerte, aucun message d'information qui nous dérange. Comme la méditation, il s'agit d'une activité centrée sur un objet dont la vocation n'est pas de vous faire vagabonder autrement qu'à l'intérieur de notre crâne. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème d'attention chez nos contemporains. Il y a des enjeux commerciaux énormes quant au fait de la capter. C'est la fameuse déclaration de Patrick Lelay, ex-patron de TF1 : « Je vends du temps de cerveau disponible. » Le champ de bataille idéal pour la manipulation de l'attention, ce sont les écrans. Le livre papier reste donc un espace préservé. On devrait se demander plus souvent : est-ce que j'ai offert à mon cerveau un temps de lecture sur papier suffisant cette semaine ? Le livre ne nous donne que ce qu'on lui demande, les écrans tentent toujours de nous revendre des choses en plus.
Pourvoyeur de long-sellers, le développement personnel est aujourd'hui l'un des secteurs éditoriaux les plus dynamiques. Vous qui êtes un historique de ce rayon, comment voyez-vous la concurrence qui s'y développe ?
C. A. : J'ai publié mon premier livre en 1995 et, à l'époque, les livres de développement personnel étaient une bulle rafraîchissante dans le secteur des sciences humaines qui restait assez théorique. Nous avions l'impression qu'il y avait des espaces. Effectivement, le paysage a bien changé et l'offre est devenue pléthorique. C'est dur d'être un jeune auteur dans cette masse de production, de se faire remarquer et lire. Pour ma part, je suis identifié et bénéficie d'une forme de branding, je suis une marque. Dans certaines librairies, il y a un rayon Cyrulnik, un rayon André, etc. Dans un univers hyperconcurrentiel, ce qui guide les choix c'est la marque reconnue, les capacités d'expertise de l'auteur ou la prescription. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est ainsi.
Que répondez-vous aux libraires qui rechignent à vendre des livres de développement personnel ?
C. A. : Certains libraires méconnaissent ce que j'appelle le service psychologique rendu par un livre. J'ai été expert à l'agence du médicament, et nous devions statuer sur le « service médical rendu » des nouvelles molécules par rapport à celles déjà sur le marché. Pour les livres, c'est pareil. Ce « service psychologique rendu » n'est pas proportionnel à la qualité littéraire du livre. Et le conseil en librairie s'appuie sur les mêmes vertus que celle d'un thérapeute. Nous sommes au service des gens, nous n'avons pas à les considérer comme des personnes qu'il faut éduquer, ce qui serait un manque de respect. Faire preuve de snobisme, c'est sous-estimer la fonction des livres. Pendant longtemps, j'ai pris de haut les ouvrages de Jacques Salomé, par exemple. Il y avait peu de données scientifiques, je me méfiais du personnage... Il n'empêche qu'au bout d'un moment, à force d'entendre les patients me dire que ses livres leur faisaient un bien fou, je me suis dis que je passais à côté de quelque chose. Même si je n'apprécie pas totalement son travail, cet auteur rend un service psychologique considérable et je me suis mis à respecter ses écrits. Cette notion de service psychologique rendu d'un livre est capitale pour moi et elle est dissociée de la qualité littéraire et de la validité théorique.
Vous avez vous-même évolué dans votre écriture.
C. A. : Mes livres sont le reflet, à chaque époque, de ce que je fais sur le terrain. Au début, j'ai écrit des livres de psychothérapeute destinés à des personnes qui souffraient de troubles d'anxiété comme La peur des autres (Odile Jacob) consacré à la phobie sociale. Peu à peu, je me suis intéressé à la prévention, d'où les livres sur la psychologie positive et la méditation. Parallèlement à cette évolution thématique, mon style a changé. Au début, les premiers livres étaient très techniques, dérivés des polycopiés destinés à mes patients. En effet, j'animais des groupes de thérapies avec des exercices. J'avais conçu des fiches que je donnais aux participants pour les motiver et les accompagner.
Le premier titre que j'ai coécrit avec Patrick Légeron a été entièrement réécrit par notre éditeur chez Odile Jacob, Jean-Luc Fidel, car il ressemblait à un exposé universitaire. Peu à peu, j'ai intégré que la manière dont on écrit pouvait améliorer la pénétration de nos messages dans l'esprit des patients. Je l'ai compris en bavardant avec les lecteurs qui notent certaines phrases de mes livres, comme L'estime de soi et s'y réfèrent régulièrement. Certaines des formulations leur servent de mantra. D'ailleurs, je fonctionne de la même façon. Si j'aime tant la poésie, c'est qu'elle est, entre autres, l'art de la formule juste, de résumer dans une phrase harmonieuse un concept.
A partir de Méditer jour après jour, j'ai commencé à faire attention à la manière dont j'écrivais. Je me demande : est-ce que la musique de cette phrase pourrait être améliorée pour qu'elle soit plus facile à intégrer, à mémoriser ? Je ne suis pas un véritable écrivain, juste un auteur qui a pigé que la façon dont je formulais mes idées avait plus d'importance que je ne le croyais. J'en parle parfois avec un ami, André Comte-Sponville, qui, parmi les philosophes, est un styliste. La priorité reste le fond mais il n'y a aucune raison selon lui de sacrifier la forme au fond. Si on peut faire que ce qui a du fond ait aussi une belle forme, c'est encore mieux. Ce n'est pas une prétention littéraire, c'est une intention thérapeutique : ce qui est bien écrit se mémorise mieux, rentre plus profondément, par conséquent est plus adopté.
Vous êtes aussi de plus en plus présent dans les livres que vous écrivez.
C. A. : J'ai commencé à le faire grâce à une directrice littéraire, Catherine Meyer, qui m'accompagne depuis Psychologie de la peur. Je lui racontais les séances de traitement des phobies. C'est très spectaculaire car on enferme les patients dans des ascenseurs, on les emmène au muséum voir des araignées, on va place Saint-Sulpice courir après les pigeons... Elle m'a conseillé d'intégrer ces anecdotes au texte, de me mettre en scène car c'était bien plus intéressant que la théorie. Le concept n'était pas encore développé mais il s'agit de la vertu du narratif. Quand vous racontez des histoires, vous captez une autre partie du cerveau de vos lecteurs que lorsque vous énoncez des faits. C'est le problème que se posent les jeunes collapsologues comme Pablo Servigne. Ceux qui tentent d'alerter la population sur le climat échouent car ils empilent les données, les chiffres et pourcentages, mais ils n'ont pas d'histoires, de mythes à raconter qui mobilisent les gens.
A partir du moment où je me suis mis en scène, j'ai été frappé du résultat mobilisant sur mes lecteurs. Mais il y a un art de la révélation du soi quand on veut aider autrui. Il faut savoir doser, c'est juste une épice dans le plat, et le faire non pas au moment où on a envie mais au moment où l'autre en a besoin. Le patient se sent alors moins seul et singulier dans ce qu'il vit comme une infériorité et comprend que c'est une défaillance partagée par tout un tas de gens, notamment ceux qu'il admire. C'est un message assez égalitaire et fraternel. Joseph Delteil, un écrivain un peu oublié, a cette phrase magnifique dans son autobiographie La Deltheillerie : « Je dis souvent : Je, mais c'est le Je pluriel, le Je de l'Homme. » Pour lui tout ce qui est intime est universel.
Vous fréquentez des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, et avez beaucoup travaillé sur les questions de burn-out. Comment évaluez-vous la santé des professionnels du livre ?
C. A. : J'ai le sentiment que c'est un métier de chanceux car ce sont des personnes qui travaillent sur un matériau qui a du sens, qui leur fait rencontrer des personnalités passionnantes. Cet environnement agréable n'empêche pas les souffrances au travail dans certaines entreprises. Ce n'est d'ailleurs pas propre à l'édition mais cela s'étend à toutes les petites PME où vous pouvez trouver des patrons fondateurs charismatiques dont on est à la merci. Il y a le meilleur comme le pire. A l'opposé, vous trouvez des groupes où l'on peut souffrir des mêmes maux que dans les grosses entreprises, avec une maltraitance et une perte de sens.
Si les dysfonctionnements dans le milieu de livre se retrouvent dans d'autres environnements professionnels, la différence réside dans ce qu'on appelle des modérateurs de stress. Quand vous étudiez les dégâts du stress il y a les stresseurs, l'ensemble de ce qui vous agresse, vous fait du mal (ce sont les mêmes dans l'édition, la librairie, la bibliothèque ou toute autre boîte), et vous avez les modérateurs de stress, tout ce qui vous protège, vous aide, vous sauve. Quand vous êtes jardinier, vous pouvez avoir un patron sadique, le modérateur de stress, c'est que régulièrement vous êtes seul dans la nature, avec vos plantes. Dans le monde du livre, c'est précisément le livre. Ce métier ne permet jamais de faire fortune, c'est le moins qu'on puisse dire, mais reste passionnant, avec du sens et vous met en contact avec de l'intelligence et de l'humanité. Cela reste un commerce merveilleux.