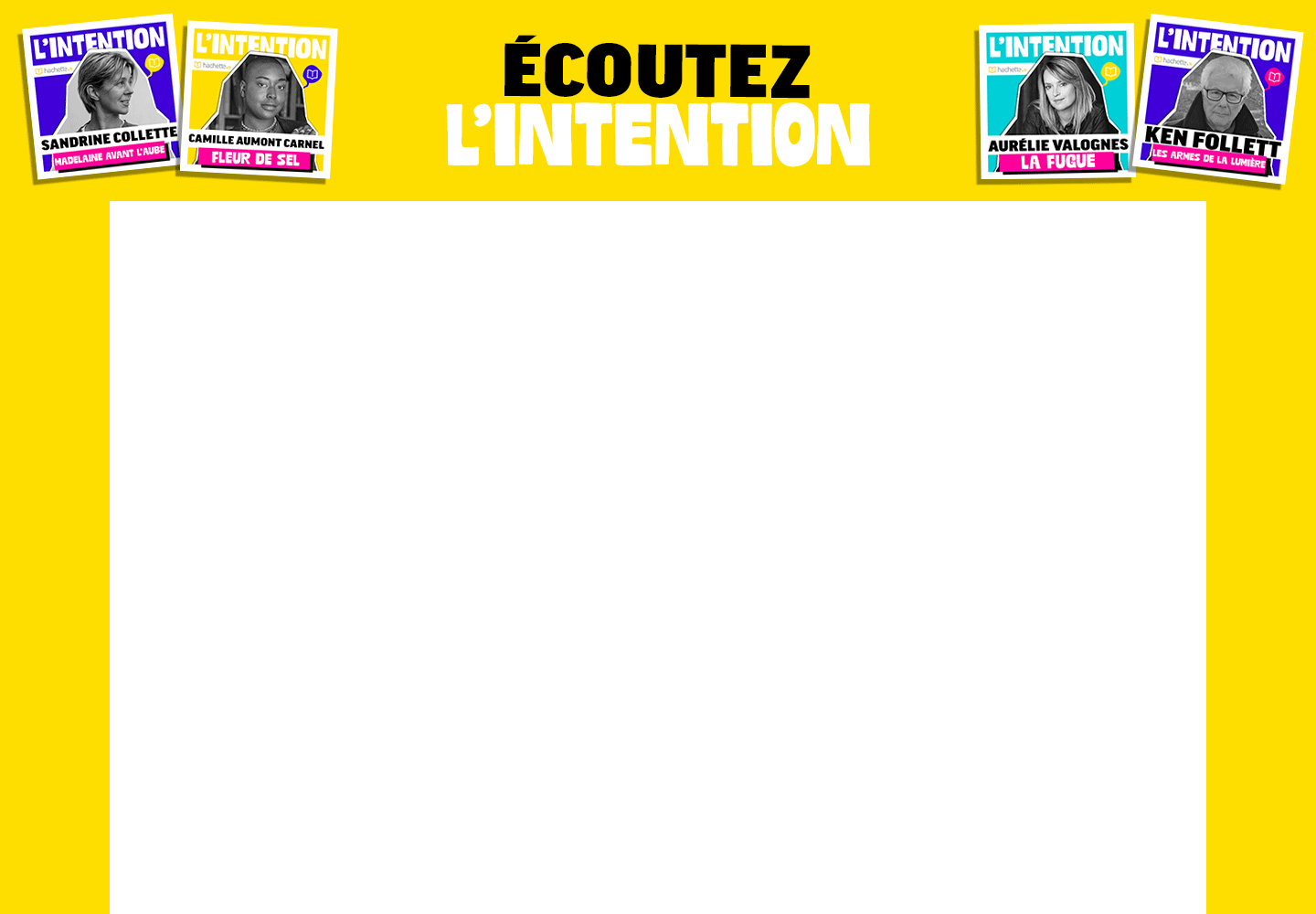Le sentiment d'être étranger, la brutalité sourde de l'intégration au rêve américain, la frontière poreuse entre le mensonge et la fiction... Ce qu'on peut lire dans l'air, le deuxième roman de Dinaw Mengestu, offre une nouvelle variation, à la fois plus ample et plus intime, autour des thèmes qui traversaient déjà Les belles choses que porte le ciel, son épatant premier roman, sorti en 2007, où il mettait en scène, à Washington, des personnages issus de la diaspora africaine récente.
Dans un montage parallèle, on suit ici le naufrage de deux couples à trente ans d'intervalle. L'histoire débute abvec le voyage en voiture de Yosef et Mariam, les parents du narrateur, Jonas Woldemariam, sur la route qui doit les mener de Peoria (Illinois) à Nashville (Tennessee). "Ils n'avaient pas qualifié ce voyage de vacances, mais c'était seulement parce que ni l'un ni l'autre ne se sentaient à l'aise avec l'expression lune de miel qui, en réunissant deux mots sans aucun rapport et dont ils comprenaient le sens pris séparément, semblait suggérer - par cette association - un luxe qu'aucun des deux n'était prêt à accepter. Ils n'étaient pas jeunes mariés mais, après trois années de séparation, ils ne se connaissaient plus." Etrangers, ces deux-là le sont autant l'un pour l'autre que dans ce pays où ils ne sont pas nés, le père ayant fui l'Ethiopie avant que sa femme ne le rejoigne dans le Midwest. L'exil de chacun à l'intérieur du couple crée entre eux une incompréhension irréductible.
Trente ans après ce voyage calamiteux, qui laissait augurer les années de guerre conjugale à venir, le fils unique de ce couple, récemment divorcé, refait la route tout en repassant en mémoire les trois années de son mariage avec Angela, jeune avocate rencontrée dans un centre pour réfugiés du sud de Manhattan, où ils travaillaient tous les deux.
Angela reproche à son mari de ne rien exprimer de ce qu'il pense et ressent. Mais s'il s'épanche peu, Jonas s'épanouit en revanche en racontant des histoires : il commence par réécrire les dossiers des demandeurs d'asile du centre de réfugiés en ajoutant des détails pour rendre leurs histoires plus dramatiques ou plus plausibles. Plus tard, devant les étudiants de l'école privée où il enseigne la littérature anglaise, il inventera l'histoire du départ d'Ethiopie de son père. Au point de finir par ne plus savoir lui-même démêler le récit ou le souvenir avéré de la reconstitution falsifiée.
Il y a beaucoup de violence, sous toutes ses formes, dans ce roman : sociale, raciale, privée, mais elle est toujours décrite, placidement, mine de rien. C'est la signature délicate de Dinaw Mengestu, que le New Yorker a inclus l'année dernière dans sa liste des vingt écrivains américains âgés de moins de 40 ans les plus prometteurs. La plus grande violence du livre est peut-être d'ailleurs cette mélancolie discrètement infusée. Ce fiasco progressif dont le romancier excelle à décrire l'immatérialité. Ces tensions, comme de l'électricité statique : signes avant-coureurs d'une dispute, minuscules points de rupture... Mais aussi, appliquée doucement en baume sur ces vies de solitude, la certitude qu'il reste toujours une trace de ce qui a été vécu et partagé.