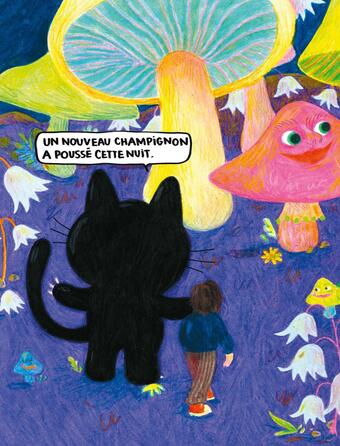Une cour d’appel californienne a statué, le 23 avril 2018 sur le sort du célèbre «selfie» réalisé par un macaque au nord des Célèbes, durant l’été 2014. Rappelons que cette photographie, prise avec l’appareil de David Slater, qui visitait ce zoo indonésien, montrait le singe grimaçant, prénommé Naruto, et avait été vue dans le monde entier.
La question s’est vite posée de savoir si un animal pouvait être l’auteur d’un selfie et donc titulaire des droits d’exploitation sur sa propre image, cliché effectué par lui après s’être emparé du téléphone d’un visiteur de zoo.
Car la Fondation Wikimédia, qui préside aux destinées de Wikipédia, a refusé d’éradiquer la photographie. Mieux encore, l’ONG People for the Ethical Treatment of Animals, connue en France sous l’acronyme de PETA, a saisi la justice des États-Unis, pour faire juger que le signe disposait de droits "
comme ce serait le cas pour un humain".
Un jugement de première instance a débouté PETA, en
septembre 2017, David Slater ayant toutefois accepté de rétrocéder un quart des droits à venir à des organisations en charge de la protection de l'habitat des macaques d'Indonésie.
La cour d'appel américaine a considéré par ailleurs que les violations de droits d'auteur ne pouvaient être dénoncées que par des humains. Les magistrats soulignent même que
"PETA apparaît utiliser Naruto malgré lui, comme un pion pour atteindre ses objectifs idéologiques".
PETA a réagi à cette décision en arguant que le singe
"est victime d'une discrimination simplement car il est un animal non humain". Reste à rappeler, en droit français, le cadre juridique d’un autoportrait, en particulier d’un selfie.
Création de forme
Le droit d’auteur à la française est fondé sur des critères aux termes desquels les simples idées ne sont pas protégeables. En effet, la méthode, le concept, le principe, souvent propres à l’art contemporain, ne bénéficient jamais du droit de la propriété littéraire et artistique en tant que tel. Seule la "création de forme" qui concrétise ou matérialise l’idée, peut être valablement couverte. L’art conceptuel s’est heurté de plein fouet à une telle vision du droit d’auteur.
Toute la difficulté vient aussi de ce que, traditionnellement, les tribunaux accordent à ceux qui ne font qu’appuyer sur le déclencheur d’un appareil photographique le statut d’auteur de ce qui y est représenté. Il en a heureusement été jugé parfois différemment; en particulier, il y a plus d’un siècle, à propos d’un explorateur ayant voulu prouver l’existence d’une tribu en Afrique noire en se faisant photographier par un autochtone au milieu de membres de son ethnie.
Le recours aux outils informatiques a suscité des contentieux, puisque certains ont voulu contester la qualité d’auteur d’une œuvre à qui utilisait du matériel informatique, aussi sophistiqué fût-il. C’est ainsi que, de l’avis unanime des juges et des spécialistes de la propriété littéraire et artistique, le créateur du logiciel ou le fabricant de l’ordinateur ne peut revendiquer le titre d’artiste et évincer celui-ci de son statut. Dans un registre similaire, les photomatons sont aujourd’hui couramment admis comme des œuvres appartenant à ceux qui y figurent et qui ont déclenché la prise de l’image.
Photographies par satellite
Dans le cas des photographies prises par satellite, l’intervention accrue de la machine dans le processus de prise des clichés a longtemps laissé perplexes certains spécialistes du droit de la propriété littéraire et artistique, en raison de la nécessaire originalité. Une récente décision semble toutefois admettre leur protection par le droit d’auteur.
La titularité des images de la Terre prises depuis des satellites pourrait toutefois un jour connaître certains ajustements. Le "retraitement" des clichés est en effet susceptible de donner naissance à une œuvre composite (ou dérivée). Et ce sans compter que les directives de certains commanditaires d’images sont telles qu’ils pourront arguer de leur qualité d’auteurs des clichés, le satellite étant assimilable à un simple auxiliaire technique de l’appareil photographique…
Il est aussi difficile aux artistes ayant recours à autrui pour réaliser leur œuvre d’en revendiquer la paternité. C’est ainsi que d’Orlan et ses chirurgiens à Sophie Calle et ses photographes, il est souvent nécessaire de recourir à un mécanisme contractuel aux termes duquel l’intervenant cède ses éventuels droits au concepteur de l’œuvre.
Un contentieux de cette nature est déjà survenu en 1973, entre Guino et les héritiers de Renoir. Lorsque vieillissant et trop atteint de rhumatismes pour sculpter lui-même, celui-ci donnait en effet des instructions à son disciple, afin de réaliser ses œuvres. Plus récemment, Vasarely s’est retrouvé aux prises avec le peintre Valuet, à qui il avait confié la mise en forme du tableau
Stri Pauk. En 1983, les magistrats ont estimé à propos du maître de l’art cinétique, qu’
"en se réservant de corriger et d’approuver l’œuvre, auquel a participé matériellement un autre peintre, avant d’y apposer sa propre signature, l’œuvre réalisée se trouve ainsi marquée de l’empreinte de sa personnalité de créateur et doit être considérée comme une œuvre de collaboration ayant nécessité le concours de deux peintres".
Œuvres de commande
Le problème est
a fortiori accru, quand il s’agit d’un artiste ayant recours à un photographe ou vidéaste pour capter l’œuvre et la pérenniser dans le but de la commercialiser. Les performances sont au cœur de cette problématique. C’est ainsi qu’Alberto Sorbelli, connu notamment pour ses interventions spectaculaires dans les musées, a dû batailler en justice pour se voir reconnaître, en 2004, par la Cour d’appel de Paris, la qualité de coauteur des images tirées de son art. Les juges ont souligné que
"comme le fait observer à juste titre M. Sorbelli, il n’a pas été seulement un sujet pris en photo par Mlle Yoshida, sujet inactif, qui aurait pris des poses dictées par la photographe, mais a été un sujet actif". Et ils ont ajouté :
"M. Sorbelli a imposé son choix dans la composition et la mise en scène du sujet, tandis que la photographe a imposé son choix dans le cadrage, les contrastes et la lumière." Christo et sa compagne, dont les installations sont l’objet de commercialisations à tous vents, sont fréquemment confrontés à de semblables déboires.
Enfin, au sens juridique du terme, l’œuvre de commande est l’œuvre qu’un esthète demande à un auteur de réaliser dans le but d’en conserver la propriété matérielle. Il ne s’agit donc pas de la commande passée par un éditeur à un auteur, qui se traduit juridiquement par un contrat d’édition.
Photographes et stylistes
Ce principe essentiel du droit d’auteur qu’est l’indépendance de la propriété intellectuelle par rapport à la propriété matérielle s’applique aux œuvres de commande. Ainsi, la cession d’un tableau commandé à un artiste n’entraîne-t-elle en aucun cas la transmission des droits d’auteur au commanditaire de l’œuvre. Cependant, le schéma se complique lorsque la commande fait l’objet de directives précises de la part du commanditaire. Celui-ci peut alors être considéré comme auteur de l’œuvre. En pratique, cette hypothèse se rencontre assez rarement, même si des conflits surgissent, notamment dans le domaine de la photographie. En effet, des sociétés, des stylistes ou des maisons d’édition font appel à des photographes dans le but d’utiliser commercialement les clichés pour une couverture, un catalogue, une publicité, etc. Ces "commanditaires" ont souvent tendance à fournir des indications assez draconiennes sur le travail à effectuer et en viennent parfois à s’autoproclamer auteur ou coauteur de l’œuvre du photographe. Mais les tribunaux reconnaissent presque toujours le photographe comme seul auteur, quand bien même le sujet lui aurait été imposé avec force détails. Il reste en effet maître de l’éclairage, du choix de la pellicule ou de l’objectif, faisant en cela œuvre de création suffisante pour se voir attribuer les droits d’auteur.
De même que l’éditeur pourra très difficilement apparaître comme le coauteur de la photographie de couverture qu’il aura commandée, il ne peut s’estimer coauteur du manuscrit pour lequel il aura sollicité très précisément un écrivain. Un artiste graveur s’est toutefois vu reconnaître par une juridiction la qualité de coauteur d’un livre consacré à l’art fantastique de la gravure, pour lequel sa spécialité lui avait valu de jouer le rôle de conseiller.
Enfin, le Code de la propriété intellectuelle distingue classiquement trois catégories de créations qui peuvent être le fruit de plusieurs auteurs: les œuvres de collaboration, les œuvres collectives et les œuvres composites. Cette dernière situation recouvre les œuvres dites dérivées ou secondaires, élaborées à partir d’une œuvre première préexistante.
Mais les critères retenus par la jurisprudence sont cependant de plus en plus flous. La définition législative de l’œuvre collective est, par ailleurs, pour le moins ésotérique. Et la pertinence de ces notions, élaborées il y a au mieux des décennies, est mise à mal par les pratiques artistiques depuis des lustres. Le droit est la plupart du temps en décalage par rapport aux avant-gardes. Pour ce qui est de désigner l’auteur d’une œuvre, cela fait bien longtemps que la loi n’est plus au diapason des innovations de la création. Quant aux animaux ne sont plus, en France, de simples meubles depuis 2014, ils ne sont pas encore devenus auteurs à part entière.