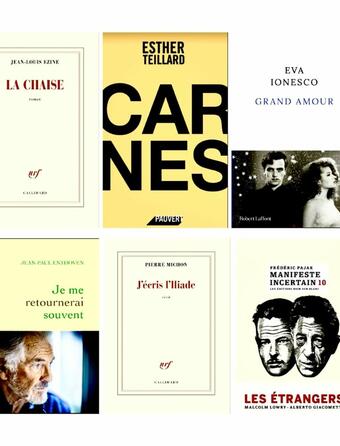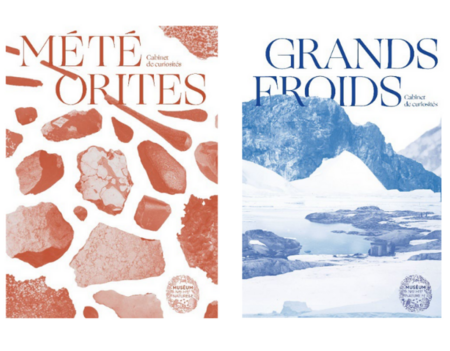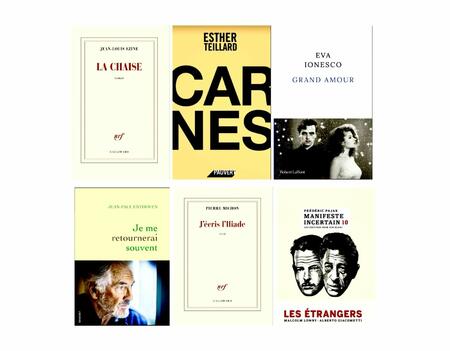"On a parfois besoin de la fiction pour comprendre la condition humaine", déclare Orhan Pamuk. L’écrivain turc tente de la saisir à travers ses grandes fresques romanesques. La dernière en date, Cette chose étrange en moi, qui paraît le 31 août chez Gallimard, lui a pris six ans. Dense, se déployant sur 685 pages, elle magnifie ses thèmes habituels : la famille, l’amour, la part de destin et de liberté individuelle. L’ancien étudiant en architecture articule l’intrigue autour d’une ville, Istanbul, et scrute l’évolution sociopolitique et religieuse de son pays.
Visiblement tendu, Orhan Pamuk nous répond par téléphone depuis son domicile stambouliote. Il évite les sujets délicats. Le contexte reste instable pour les intellectuels turcs, et le président Erdogan continue de restreindre la liberté d’expression. Journalistes, éditeurs, auteurs ou traducteurs sont arrêtés en nombre. L’écrivain en est bouleversé, mais il préfère concentrer nos échanges sur son roman, écrit avant ces événements, et s’étendre sur le pouvoir de l’imaginaire et de la fiction. Dans ce texte ambitieux, il dessine "un tableau de la vie à Istanbul entre 1969 et 2012". Lui qui ne cesse d’arpenter sa ville natale est le témoin privilégié de sa mutation. La mégalopole continue de s’étendre et change de visage au gré des vagues d’arrivants. A commencer par celle des villageois turcs, venus comme son héros Mevlut pour tenter d’améliorer leur sort. C’est par ces petites gens qu’Orhan Pamuk appréhende la ville mutante.
Orhan Pamuk - J’adorais écouter mes grands-mères, ma mère ou les bonnes qui enflammaient mon imaginaire… Possédant une grande bibliothèque, mon père m’a toujours encouragé à lire. Le mari de ma tante étant éditeur, j’avais accès à plein de romans, dont Lesmille et une nuits, version jeunesse. Mon panthéon ? Tolstoï, Proust ou Nabokov. Les histoires viennent toujours à moi, mais la vie est trop courte. Et je mets hélas des années avant d’écrire joliment un roman.
Petit, je m’ennuyais tant en classe que je m’échappais dans des univers imaginaires. Ceux de mon héros sont d’une richesse incroyable, en dépit de son extrême pauvreté. Si la mémoire est porteuse de passé, l’imagination renferme l’avenir. Le présent est traversé de choses infimes. Là, je regarde le Bosphore par la fenêtre. Cette vue imprègne mon esprit, mon verbe et mon imaginaire. Celui-ci fonctionne mieux si l’on s’empare du réel avant de développer, déformer ou transformer.
Au contraire, elle s’avère pleine de contraintes, de doutes et de casse-tête. C’est plutôt l’imagination qui est libératrice. Etant de la génération des écrivains urbains, je me distingue des classiques turcs. Je n’écris pas sur les joies ou les tragédies de l’Histoire, mais celle-ci peut s’immiscer entre les pages. Ici, elle prend une forme labyrinthique à la Borges. Au départ, le roman se dessine comme un tableau, mais il évolue avec le temps. L’écriture lui donne du sens et du relief, grâce aux mots soigneusement choisis.
Je ne suis pas l’ambassadeur de mon pays ! La démocratie est limitée en Turquie. La liberté d’expression n’existe pas, mais les élections oui. Certains de mes amis se trouvent derrière les barreaux. Ça me fait enrager, et je tiens à préciser que les éditeurs, les journalistes ou les écrivains emprisonnés ne le sont pas à cause de leurs livres, mais en raison de leurs opinions politiques. Proust ou Kafka ne représentaient pas un danger pour les dirigeants. A l’inverse de Zola, qui est clairement un auteur engagé. Malgré la colère, je continue à écrire tout en restant confiant en l’avenir.
Bonne question. Dans mes livres précédents sur Istanbul, j’explorais le milieu dans lequel je suis né. Celui de la classe moyenne, installée dans les quartiers occidentalisés. Cette fois, je me suis aventuré hors de ce cercle, pour voir la ville à travers les yeux d’un vendeur de rue. Mevlut est né en bas de l’échelle sociale. Il arrive à Istanbul en 1969, puis on le suit pendant quarante ans. Tout comme moi, il est le témoin privilégié de l’évolution d’Istanbul. Dire que de mon vivant, elle est passée de un à quinze millions d’habitants !
Une ville vous modèle, surtout si vous avez toujours vécu dans sa cosmologie. Istanbul représente mon monde. Tout me relie à cette cité, bordée d’eau, de trafics, de corruption, de pauvreté et d’anarchie politique. Au fil de mes traductions, j’ai compris que j’étais l’écrivain d’Istanbul. Ce roman tend justement à la voir autrement. Quand j’ai écrit le récit Istanbul : souvenirs d’une ville [qui ressort en version illustrée le 31 août chez Gallimard, NDLR], je pensais que ma ville natale était immuable. Cet imaginaire romantique explique ma nostalgie. Istanbul appartenait avant à l’Europe et à la civilisation musulmane. Désormais surpeuplés, ses nouveaux quartiers ne laissent plus de place à la solitude.
Complètement, tant il décrit une société de paysans se transformant en urbains modernes. Certains atteignent leur rêve à Istanbul, d’autres pas. J’ai exploré les coins les plus pauvres de la ville pour donner la parole aux gens qui ne l’ont pas. Le roman résulte de leurs témoignages et de bon nombre de documents visuels ou écrits. Les vendeurs de yaourts faisaient partie de mon enfance. Liés à l’immigration économique, ils ont disparu avec les supermarchés. Au-delà de l’Histoire épique, de micro-événements chamboulent une ville ou un destin. Ce roman se veut une chronique du changement architectural, socio-économique et historique d’Istanbul. Comment affecte-t-il les êtres attachés à ce lieu ?
Telle est la surprise du roman. Mevlut est un homme ordinaire, que je voulais rendre unique. Il migre à Istanbul pour bâtir une nouvelle vie, or il se heurte à la pauvreté, la confusion politique, identitaire et religieuse. Ainsi, il apprend la persévérance et l’amour. Celui-ci n’incarne pas un mystère, mais une nécessité à inventer tous les jours. Les femmes turques sont opprimées, mais pas forcément passives ou brisées, alors j’ai imaginé des personnages courageux, épris de liberté. Le pouvoir de la fiction consiste à expérimenter des choses a priori anodines. L’amour, la jalousie, la haine du père ou la colère font partie du registre intime universel. Seule la littérature peut les rendre visibles. Sa beauté étant qu’on puisse la partager avec d’autres cultures, civilisations et continents.
[Rires] J’ai la chance d’être un écrivain heureux, malgré les coups d’Etat militaires, l’anarchie ou l’horreur de mon pays. Si l’existence est mauvaise, il faut imaginer quelque chose de beau et de nouveau, comme l’espoir malgré ces moments de turbulences politiques.