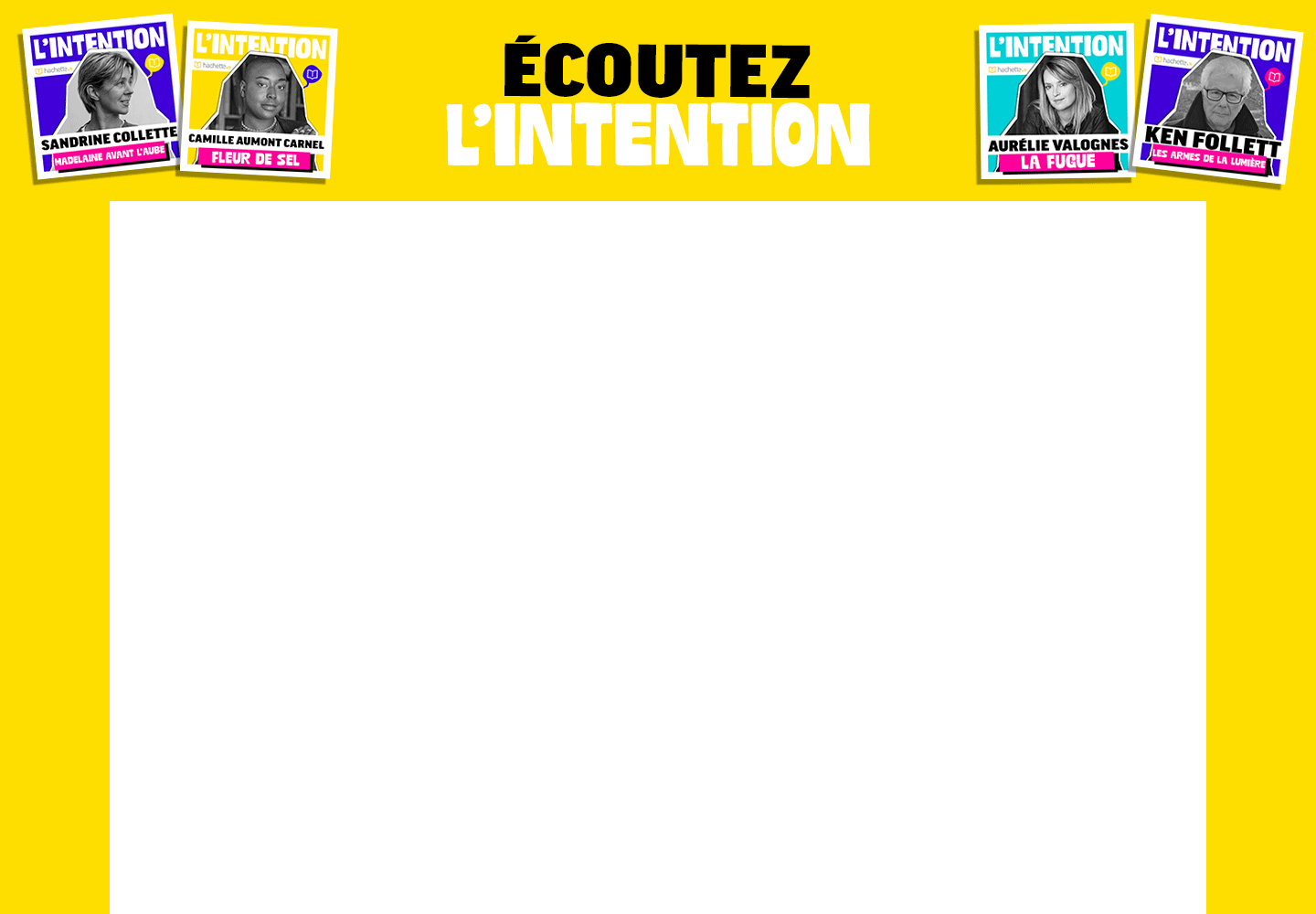On ne devrait jamais revenir chez soi. Surtout quand ce « chez-soi » a tous les traits, non d’un paradis perdu, mais de la scène initiale sur laquelle se déployèrent les frustrations, les humiliations et les trahisons de l’enfance et de la jeunesse. Peter Jacobs, un journaliste et écrivain sud-africain installé à Londres depuis de nombreuses années, savait tout cela lorsque, pourtant, un matin de janvier 2010, il revint dans sa ville natale d’Alfredville, en plein cœur d’un pays afrikaner pour lequel la fin de l’apartheid, désaveu historique, a sonné le glas des heures glorieuses d’un rêve racialiste et petit-bourgeois. Pourquoi Peter est-il revenu ? Pourquoi se jette t-il ainsi dans la gueule du loup ? Peut-être parce qu’en Angleterre son compagnon, un comédien jamaïcain, vient de le quitter et qu’il veut mettre à nouveau un océan, un continent, entre lui et son chagrin ? Peut-être aussi pour enquêter sur le meurtre de sa cousine, Désirée, qui fit scandale en son temps en épousant un officier de police noir, devenu comme de bien entendu, à sa mort, le principal suspect de son assassinat ? Plus sûrement encore pour affronter les ombres du passé, ses propres contradictions, ses peurs jamais tout à fait éteintes et se reconnaître enfin comme membre de cette communauté de vaincus de l’Histoire.
Avec Lost ground (Un passé en noir et blanc), quatrième roman traduit en français de Michiel Heyns depuis Le passager récalcitrant (Lattès, 2007) et sûrement l’un des plus beaux, on commence à comprendre la démarche de cet ancien professeur d’université reconverti en romancier érudit. S’il flirte avec le récit de genre, c’est pour mieux dissimuler une inspiration sourdement lyrique fondée sur les lignes de tension qui traversent l’histoire de sa terre natale. En ce sens, si Un passé en noir et blanc est bien un thriller (remarquablement mené de surcroît) ironique et tendu, c’est aussi un chant du départ, un complot de colère et une méditation douloureuse et mélancolique sur les désirs qui ne peuvent s’avouer... Depuis Coetzee (que Heyns cite joliment), sans aucune lourdeur démonstrative, on n’a rien lu d’aussi juste sur la tragédie paradoxale d’un pays et de ceux qui ne savent plus y habiter. O. M.