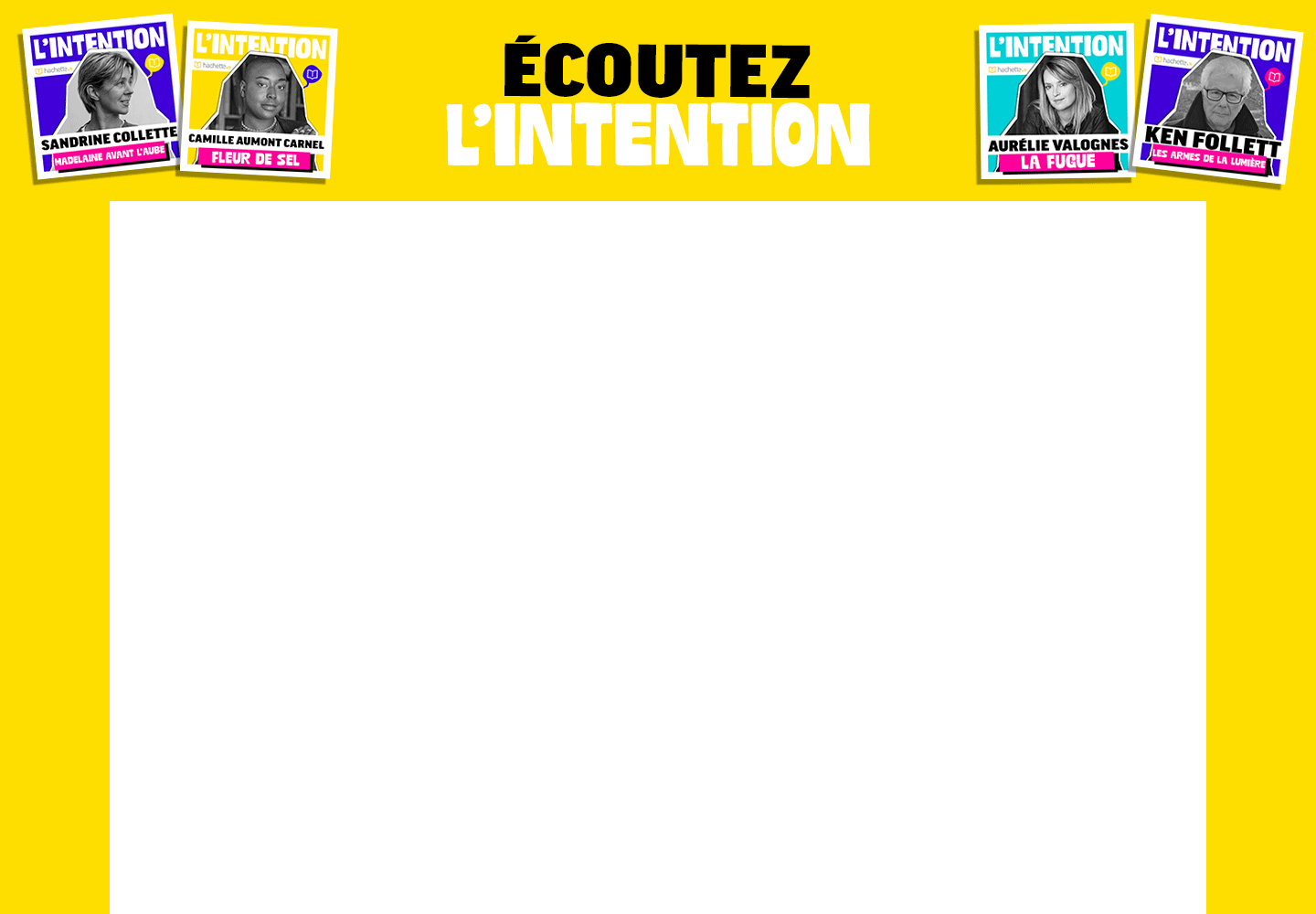L’année devrait se finir comme elle a commencé et s’est poursuivie, dans la meilleure des compagnies, celle de Roland Barthes. Après le livre que consacre à leur amitié Philippe Sollers et le film documentaire que préparent pour Arte Thierry et Chantal Thomas (Roland Barthes, le théâtre du langage, diffusion le mercredi 23 septembre), c’est au tour du dernier des grands disciples, qui s’est tu durant cette année commémorative, de rompre le silence. L’expression peut être malheureuse tant cet Age des lettres vise justement moins à participer à la cacophonie des temps qu’à redonner à un homme qui ne fut que voix, mystère et silence donc, une présence qui est aussi celle des ombres…
De quoi s’agit-il ? Avant même d’une démonstration discrète de la maïeutique d’un maître, d’une amitié qui ne s’est jamais explicitement reconnue comme telle. En cause, la différence d’âge et d’usages (du monde, des autres, etc.). Tout de même, Antoine Compagnon connaît Roland Barthes et Barthes le reconnaît. Si l’un est le disciple de l’autre, cela ne va pas sans quelques réserves tout en délicatesses. Rétif à tout grégarisme, fût-il celui du savoir, Compagnon (qui ne fréquentera qu’un an le Séminaire), avec le plein accord de Barthes privilégie le dialogue, les tête-à-tête. Les deux hommes, qui longtemps dîneront ensemble un soir par semaine, évoquent moins les aléas de leur vie personnelle (aussi, Antoine sera-t-il surpris et passablement choqué lors de la publication posthume de ses Soirées de Paris) que ceux de l’élaboration tortueuse de leurs œuvres et comment, l’une et l’autre, malaisément, se répondent.
Né du désir de retrouver et de relire la correspondance qu’il échangea avec Barthes, L’âge des lettres se présente avant tout comme un roman de formation et celui d’une époque, les années 1970, où l’avenir promettait de durer longtemps. On rejoint le philosophe dans sa retraite basque d’Urt, on se promène en 4L, on fait, un jour de colloque à Cerisy, l’achat d’un caban qui n’est déjà plus de saison, on fume sans discontinuer et l’on parle tout autant. On voudrait écrire un roman et l’on ne sait s’il faut le donner à Georges Lambrichs ou à Denis Roche, on prend soin de soi et de son ami, on est dévoré de bienveillance, d’ambition et de délicatesse, et tout cela se termine dans la chambre d’un hôpital parisien où Barthes pleure, où Roland meurt. Quand même, l’exercice aura été profitable, et ce livre admirable ne nous le laissera plus ignorer.
Olivier Mony