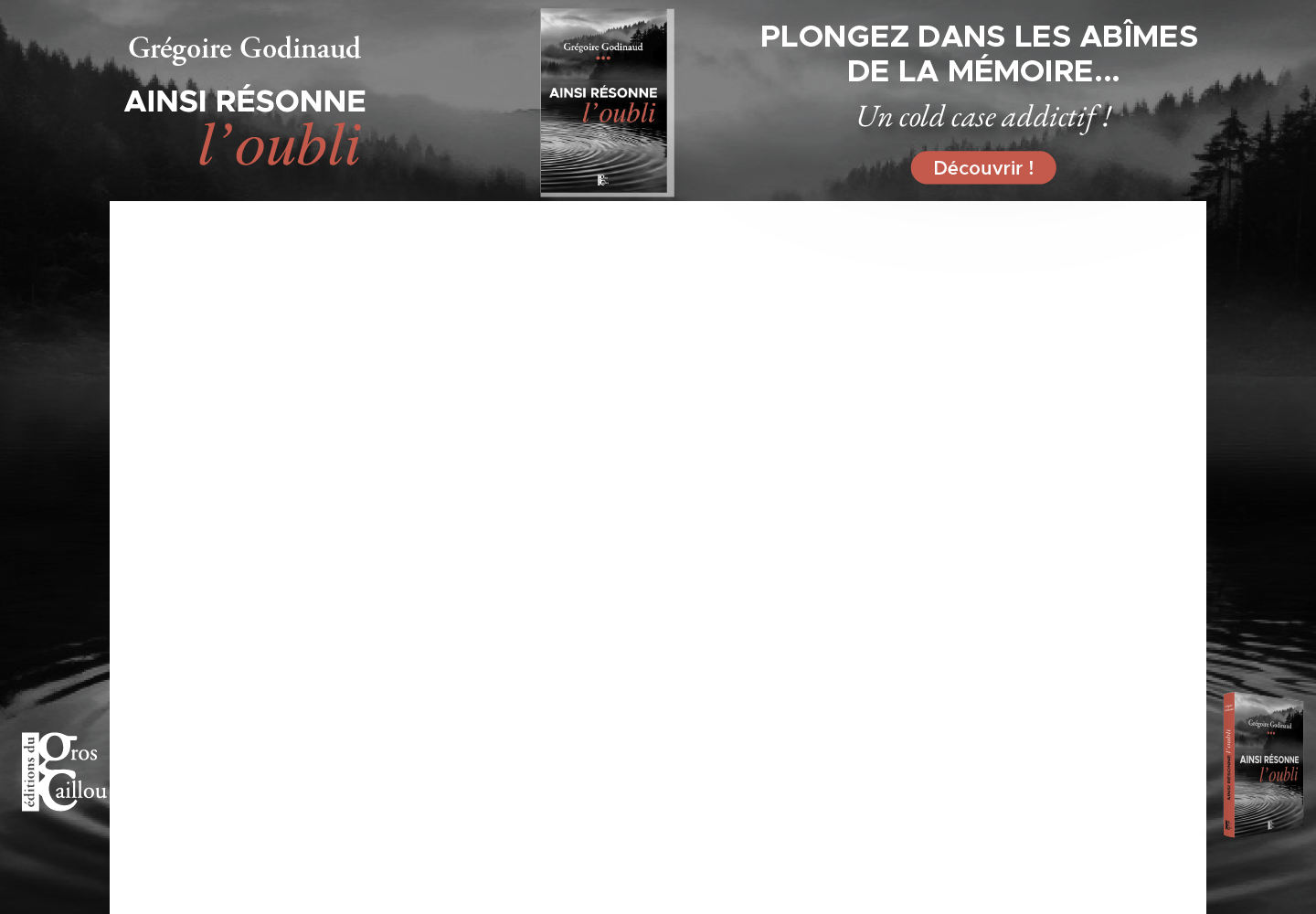Annoncée mercredi 6 novembre au personnel de Fayard, la nomination à la tête de la maison de Sophie de Closets, à compter du 1er janvier 2014 met fin à une période de quatre ans et demi pendant lesquels Olivier Nora cumulait les fonctions de P-DG de Grasset et de Fayard. La nouvelle P-DG aura à ses côtés Jérôme Laissus, l’actuel directeur général adjoint, nommé directeur général chargé des finances et de l’administration de la maison qui publie quelque 200 titres par an et a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 millions d’euros en 2012 avec près de 40 salariés.
Livres Hebdo - En nommant Sophie de Closets P-DG de Fayard, vous renoncez à rapprocher Grasset et Fayard comme vous l’aviez envisagé en 2009 en les confiant toutes deux à Olivier Nora ?
Arnaud Nourry - J’avais demandé à Olivier Nora de réfléchir à un schéma pour adosser les deux maisons l’une à l’autre. Il a d’abord dû prendre chez Fayard la succession d’un grand éditeur, Claude Durand. Puis, il est arrivé à la conclusion, qu’il a partagée avec moi, qu’il valait mieux les développer séparément. Je lui ai demandé de continuer à diriger les deux mais, le temps passant, il a jugé inadéquat qu’elles aient chacune un patron à mi-temps. Le contexte général impliquait des initiatives pour lesquelles il fallait des dirigeants à temps plein. J’ai hésité, car il faisait un travail remarquable et salué par tous. Mais je me suis finalement rangé à son avis. Il a choisi de rester chez Grasset, où il avait été nommé en premier lieu.
En 2009 vous vouliez constituer un pôle d’édition généraliste plus puissant, un peu comme dans votre filiale américaine. Ce modèle n’est plus d’actualité ?
Le modèle américain marche très bien aux Etats-Unis, le modèle anglais en Angleterre et le modèle français en France. Il est vrai que la particularité d’Hachette Livre est de détenir des maisons de littérature petites par la taille même si elles sont grandes par le renom. Cela nous différencie de certains de nos concurrents, qui sont même en train de fusionner et de constituer des maisons encore plus grosses. Je me suis interrogé sur l’idée d’en avoir une plus importante au sein d’Hachette. Mais, finalement, en littérature, cela m’a paru un peu secondaire par rapport à la nécessité d’avoir une équipe soudée autour d’une marque forte. C’est ce modèle que nous allons développer, et ce sans restriction : Grasset et Fayard sont deux maisons généralistes aux ADN différents, présentes en fiction comme en non-fiction. Il n’y a pas de raison de les spécialiser.
La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.
Pourquoi avoir choisi Sophie de Closets, jusqu’alors directrice éditoriale de Fayard ?
C’est une normalienne, un très grand talent, depuis dix ans chez Fayard où elle a été recrutée par Claude Durand : je suis très heureux de confier la maison à une femme jeune qui pourra la développer en poursuivant le travail engagé. Elle aura pour directeur général, chargé des finances et de l’administration, Jérôme Laissus, précédemment directeur général adjoint. Il est important pour moi qu’un groupe comme Hachette Livre puisse former, et que l’on trouve en son sein les talents pour prendre la succession des grands éditeurs, comme cela a aussi été le cas avec Manuel Carcassonne chez Stock.
Entre Lattès qui multiplie les succès commerciaux, Stock forcément déstabilisée par la mort de Jean-Marc Roberts, Calmann-Lévy qui se cherche, plus Grasset et Fayard, l’identité des filiales de littérature d’Hachette n’est-elle pas un peu confuse ?
Je ne porte pas un regard global sur notre branche littérature : chaque maison a son histoire et son projet. Stock a été, et c’est bien normal, très marquée par la disparition de Jean-Marc. Manuel Carcassonne, qui n’en a pris la direction qu’il y a quatre mois, a ma pleine confiance. Lattès est aujourd’hui le premier éditeur de littérature en France, avec 9 points de parts de marché, 3 points devant le deuxième : c’est le produit d’une accumulation de best-sellers sur une courte période, mais aussi d’un travail de fond, réalisé depuis dix ans par Isabelle Laffont et son équipe. Fayard est bien assise sur ses marchés, et Grasset, un peu dépouillée depuis le départ de Manuel Carcassonne pour Stock, va bénéficier de l’investissement à plein-temps d’Olivier Nora. Quant à Calmann-Lévy, affectée par la perte de son auteure vedette, Patricia Cornwell, elle est en voie de guérison à travers différentes pistes de développement. Notre souhait est de développer toutes ces maisons en autonomie, comme nous le faisons depuis toujours.
Après l’annonce du départ de Cécile Boyer-Runge, quelle direction envisagez-vous pour Le Livre de poche ?
Je ne ferai pas de commentaire sur cette situation. Il est inhabituel qu’un confrère se permette d’annoncer un transfert aussi tôt. Cécile Boyer-Runge est encore en poste pour quelques semaines.
Editis n’a pas annoncé officiellement son arrivée chez Laffont.
Vous le dites, mais des choses très précises ont été exprimées. Pour notre part, nous allons chercher un successeur. La direction du Livre de poche est un job formidable. Les candidatures seront nombreuses. Je n’ai aucune inquiétude sur l’avenir du Livre de poche.
L’émergence du numérique ne déstabilise-t-elle pas ce secteur ?
Malgré notre expérience américaine, j’ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Là-bas, le « mass market paperback » avait commencé à reculer au profit du « trade paperback » avant le numérique. Certes, ce dernier a un impact, mais je ne sais pas dans quelle proportion. Quoi qu’il en soit, cet impact est plus important pour le grand format, car le numérique touche aux nouveautés. Aux Etats-Unis, pendant la période de sortie d’un livre, le numérique représente souvent 50 % des ventes. Par la suite, la part du papier remonte. Aussi le numérique ne signe-t-il pas l’arrêt de mort des éditeurs de poche, je n’y crois pas du tout, d’autant qu’eux aussi peuvent publier des inédits en numérique, comme le fait Le Livre de poche.
Que représente le numérique pour votre groupe en France, et comment le voyez-vous évoluer ?
Dans l’ensemble des activités éditoriales d’Hachette Livre, il ne pèse que quelques pour-cent, et j’hésite à mettre un « s » à « quelques » ! Mais, pour les maisons de littérature, hors poche, nous sommes entre 5 et 8 % du nombre d’exemplaires vendus, voire un peu plus cette année chez Lattès. Ce n’est pas anodin. Nous sommes encore très loin des 40 % enregistrés aux Etats-Unis, mais l’activité est manifestement en croissance. Le taux d’équipement des Français en tablettes et liseuses progresse, c’est le plus important ; l’offre existe. Je serais étonné que le pourcentage ne double pas au cours des deux prochaines années, même si, par rapport à l’ensemble du marché du livre, il restera faible. En fin de compte, aux Etats-Unis, le numérique ne touche que la littérature. Dans le livre illustré, malgré les efforts déployés, il reste marginal. D’ailleurs, à sa sortie, nous n’avons fait que quelques milliers de téléchargements du nouvel Astérix, alors que, sur papier, nous en avions 1,9 million en place.
Comment analysez-vous la mauvaise orientation du marché du livre depuis deux ans ?
L’économie de notre pays n’est guère florissante ; l’ambiance est morose. Cela se traduit par une frilosité des consommateurs et une petite baisse des ventes. Je ne crois pas à un phénomène durable, et cela n’a rien à voir avec le numérique : nous retrouvons le même phénomène dans les autres secteurs économiques. Nous aurons certainement cette année un Noël très tardif, mais je le prévois plutôt bon, car le livre est souvent une valeur refuge. Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, en dépit du numérique qui représente un tiers du marché, l’activité progresse depuis dix-huit mois : c’est un beau présage.
Quelles réflexions vous inspirent la faillite de Virgin, la crise de Chapitre, la fragilité de la Fnac ?
Ce sont des histoires différentes qu’il ne faut pas agréger. La trajectoire de Virgin est celle d’une marque formidable dédiée à la musique, qui a essayé vainement de se réinventer et s’est retrouvée entre les mains d’un actionnaire financier qui n’avait pas de projet durable. Cela a malheureusement coûté assez cher à tout le monde. Chapitre, c’est une autre histoire, qui met en jeu des librairies indépendantes rachetées pour former un groupe sans jamais que cela fonctionne vraiment. Beaucoup de ces librairies sont viables, mais l’ensemble ne l’est pas. Et on retrouve chez Chapitre, comme chez Virgin, un actionnaire financier, en l’occurrence Najafi, basé dans l’Arizona, qui n’a pas de projet. J’espère que toutes les belles librairies de cette chaîne trouveront des repreneurs. Quant à la Fnac, je ne veux pas spéculer sur son avenir. C’est un acteur essentiel du marché dont elle représente 15 %, et parfois plus de 20 % pour des livres exigeants. Son entrée en Bourse semble avoir bien fonctionné. Alexandre Bompard est un manager formidable. Il y a une place en France pour une chaîne comme celle-là, sous réserve qu’elle réussisse sa transition numérique comme Barnes & Noble l’a fait aux Etats-Unis.
Le P-DG de Chapitre, Michel Rességuier, reproche à Hachette de ne pas jouer le jeu pour ses commandes des fêtes malgré les garanties qu’il a offertes. Qu’en est-il ?
Contrairement à ce que Monsieur Rességuier suggère, Hachette Livre n’a pas bloqué telle ou telle solution : la très grande majorité des interlocuteurs a jugé que le plan n’était pas sérieux et que les garanties (chaque magasin constituerait une cagnotte spéciale pour rémunérer les distributeurs en cas de dépôt de bilan) étaient inopérantes et juridiquement fragiles. Ce n’est pas en désignant malhonnêtement un fournisseur à la vindicte des salariés que les librairies de Chapitre seront sauvées, mais en exigeant de Najafi qu’il assume ses engagements.
La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.
L’affaiblissement du commerce traditionnel, « en dur », doit-il inciter les éditeurs à rechercher d’autres débouchés ?
Nous assistons à une expansion claire et durable du e-commerce partout dans le monde. Je ne vois pas que la France reste à l’écart, et je n’ai aucune raison de m’y opposer. Un nombre croissant de consommateurs a besoin d’acheter en ligne. Ils le font d’autant plus qu’un certain nombre de commerçants en ligne sont de très bons revendeurs, notamment pour le fonds. Certes, cela condamne le commerce « en dur » à perdre environ 1 % de part de marché par an. Cependant, ce ne sont pas les libraires, qui font un formidable travail d’animation, qui vont disparaître, mais plutôt des points de vente fragiles, ni très spécialisés, ni très professionnels. Aux Etats-Unis, ce ne sont pas les librairies indépendantes qui souffrent, mais les supermarchés, qui présentent une offre faible.
Il y a un mois, vous avez pris la défense d’Amazon, attaqué en Europe pour ses politiques de contournement fiscal et de vente à perte. Ne craignez-vous pas la constitution d’un quasi-monopole ?
Je n’ai pas pris la défense d’Amazon. J’ai dit qu’il y avait un vrai problème avec certaines entreprises américaines qui s’organisent pour ne pas payer d’impôts - c’est intolérable, et il faut qu’elles réfléchissent à adopter un comportement citoyen - mais aussi rappelé qu’Amazon est un acteur essentiel et efficace du marché. On ne peut pas lutter contre la propension des consommateurs à acheter en ligne ! Amazon est puissant, mais ne se trouve en situation de monopole nulle part dans le monde. Au demeurant, cette question relève des autorités de la concurrence.
Est-ce à dire que vous ne soutenez pas la loi votée au Parlement pour réguler les frais de port ?
Nous n’avons pas eu à la soutenir ou non. C’est un amendement qui corrige une inégalité. Il était symboliquement nécessaire, mais je ne crois pas qu’il déplacera beaucoup de parts de marché entre le e-commerce et le commerce traditionnel.
La fusion en juillet de Penguin et Random House a donné naissance à un mastodonte en littérature générale. Hachette peut-il rester spectateur de cette concentration ?
Hachette Livre a été l’agent de concentration dans l’édition mondiale entre 2003 et 2012 : c’est déjà pas mal ! Il faut se réjouir qu’une entreprise française, qui plus est dans le domaine de la culture, ait planté son drapeau à New York, Londres ou Madrid. Pour l’industrie du livre en France, avoir Hachette Livre à ce niveau permet de peser dans les négociations sur les modèles économiques et juridiques à Bruxelles comme aux Etats-Unis. Notre expansion internationale dans le numérique est aussi utile à l’édition française. Cela dit, il serait bon que nous reprenions le chemin de la croissance externe dans les cinq ans qui viennent, même si l’avenir de l’édition ne se résume pas aux grands groupes. Au demeurant, il y a d’autres modèles, avec notamment des maisons familiales. Chaque année dans le monde, de très grands livres sont publiés par de petits éditeurs. Mais je pense que nous, nous réussissons assez bien à regrouper des maisons autonomes. Pour éditer J. K. Rowling ou Malala, il vaut mieux avoir une dimension internationale. Nous avons la chance d’être les deux : petits et grands.
(1) Voir « Markus Dohle : Big is bad », LH 970, du 18.10.2013, p. 23.