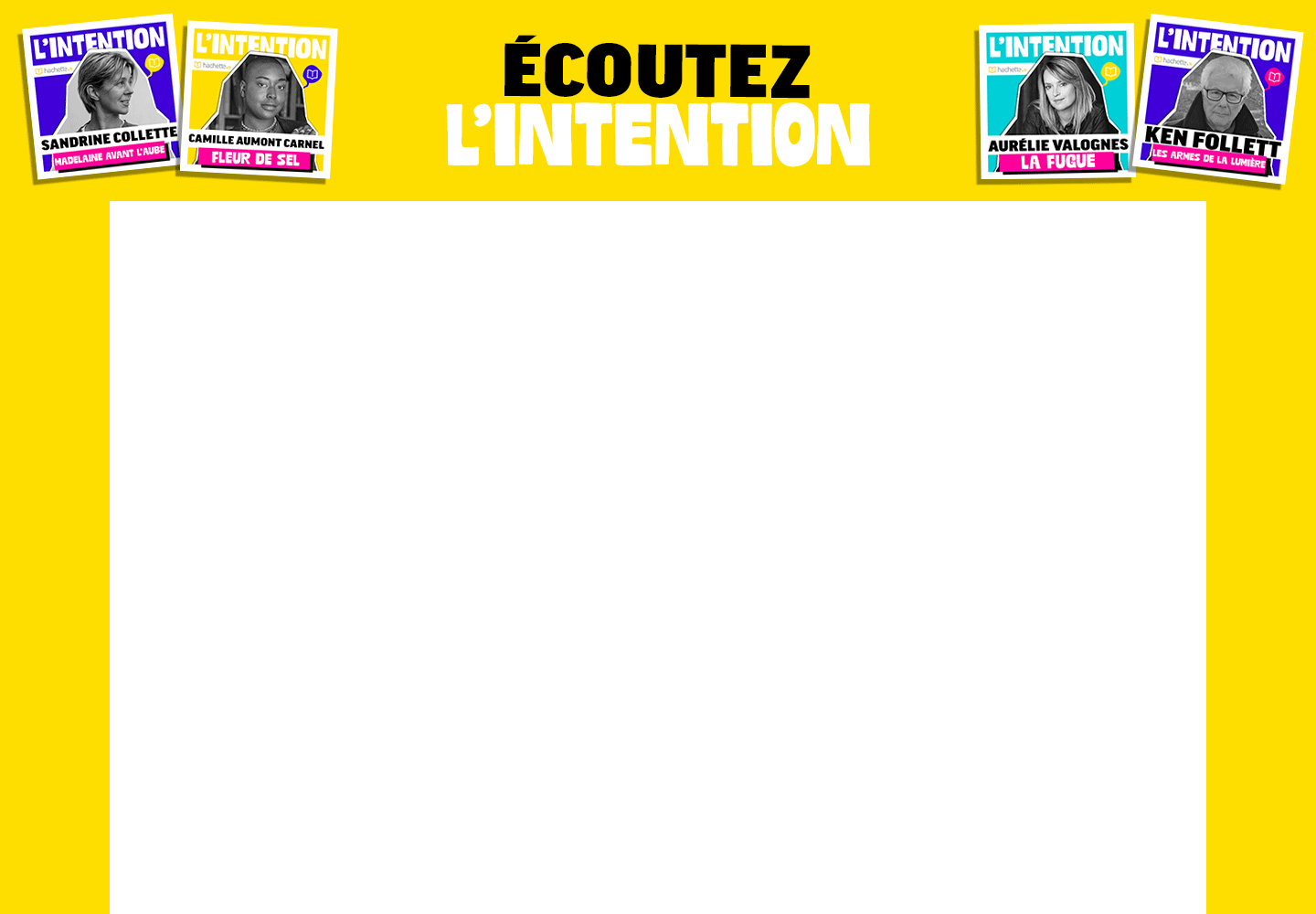Livres Hebdo : Votre titre fait référence à votre fils qui aura vingt ans en 2042. Alors que vous êtes spécialiste des questions d’opinion et de communication publique, pourquoi un livre de prospective pour la génération qui vient ?
Chloé Morin : Les gens considèrent que les responsables politiques n’arrivent plus à éclairer l’avenir et à nous dire à quoi va ressembler la société qu’ils essayent de façonner. Or tout le monde s’interroge sur l’avenir, et à celui de ses enfants : car ça oblige à nous projeter plus loin que ce que nous faisons naturellement. Et quoique cet avenir-là soit souvent très angoissant, à part quelques prospectivistes, personne n’approfondit les sujets à venir.
On a même l’impression que les responsables politiques les évitent…
Ils calent leur offre politique sur ce que « les gens » veulent, ou plutôt l’idée qu’ils se font de nos désirs. Le monde médiatique fait pareil, et pour paraphraser le titre d’un de mes ouvrages précédents, On a les politiques qu’on mérite, on a également les médias qu’on mérite. Les offres politique et médiatique correspondent à une demande. Aussi y a-t-il une responsabilité citoyenne des consommateurs du contenu médiatique – les auditeurs, les téléspectateurs ont leur part dans la médiocrité de ce qui leur est proposée. Le suivisme des politiques et des médias ne fait que refléter le manque d’exigence du public.
Votre essai se déploie de manière originale à travers des chapitres scénarisés sous forme de dystopies…
J’aime beaucoup la série Black Mirror, et sans me prétendre scénariste de science-fiction, cela m’a semblé intéressant de me projeter dans le futur avec une vision dystopique pour aller au bout de certaines logiques. La fiction autorise toujours plus. Grâce à elle, on peut dépasser le domaine du raisonnable, on entre sur un terrain qui permet de questionner davantage, d’ébranler nos habitudes de penser. L’objectif de ce livre, c'est qu’on ressorte de sa lecture, pas forcément en ayant changé d’avis, mais en ayant fait un bout de chemin en dehors des sentiers battus. Je voudrais que les gens se disent : « Tiens, je n’aurais pas vu les choses comme ça… » ou qu’ils aient conforté leur opinion avec des arguments neufs. Dans un sens ou dans un autre, ce qui m’importe, c'est le cheminement.
On rit parfois, d’un rire grinçant. Par exemple, l’histoire de « iel » et de la poupée Barbi.e : iel crée la stupeur chez son parent lorsqu’iel demande si sa poupée est une fille ou un garçon.
Typiquement, il est difficile d’aborder la question du genre frontalement en disant : « N’est-on pas un peu ridicule à vouloir s’abstraire de la réalité biologique pour considérer que le genre est uniquement une construction sociale ? » Si vous posez une question aussi directe, vous pénétrez dans un champ totalement balisé avec des pour, des contre très radicaux… le terrain est tellement miné que vous vous interdisez de bousculer les gens dans leurs a priori. La fiction permet d’aborder à nouveau la question de manière oblique, en réduisant les arguments jusqu’à l’absurde par des situations exagérées mais crédibles.
Mais ces questions qui viennent des campus américains via leur relecture des intellectuels français (French theory) trouvent un écho dans l’élite hexagonale. Vous dites que Sciences Po est le patient zéro de "l’épidémie woke".
Oui le wokisme importé des États-Unis, qui consiste à être « éveillé », ouvrir ses yeux devant les inégalités et la domination de l’homme occidental, a essaimé à partir de Sciences-Po. Récemment encore, un débat où intervenait notamment Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières, y a soulevé un tollé parmi les associations… Ce qui se passe autour du conflit israélo-palestinien a révélé la virulence de cette idéologie. L’incapacité de certains à condamner l’attaque du 7 octobre ou à dénoncer l’antisémitisme a eu un effet de souffle sur une partie de la gauche française, qui avait du mal à voir le fond de cette pensée et son ancrage dans le paysage intellectuel français. Pas que français d’ailleurs… j’ai lu dans le Daily Telegraph un article relatant la difficulté d'éditeurs britanniques à promouvoir des auteurs juifs.
Les « sensitivity readers », ces comités veillant à ne heurter personne, vont-ils être la norme en France ?
Je crains que oui. J’ai l’impression que sous la pression des éditeurs anglo-saxons, un certain nombre de règles s’imposent déjà à l’édition française.
Comment nous sauver du pessimisme ?
En fin de compte, ce n’est pas que nous manquons de ressources face aux enjeux majeurs de notre époque, comme la lutte contre le réchauffement climatique, le problème se situe ailleurs. L’effondrement est plutôt intellectuel et moral : le plus difficile pour une nation ce n’est pas de fabriquer des gens employables demain, c'est de construire des citoyens. Créer l’adhésion à un ensemble de valeurs et jeter les bases d’une histoire commune à partager et à transmettre… Et ça, nous ne savons plus le faire.