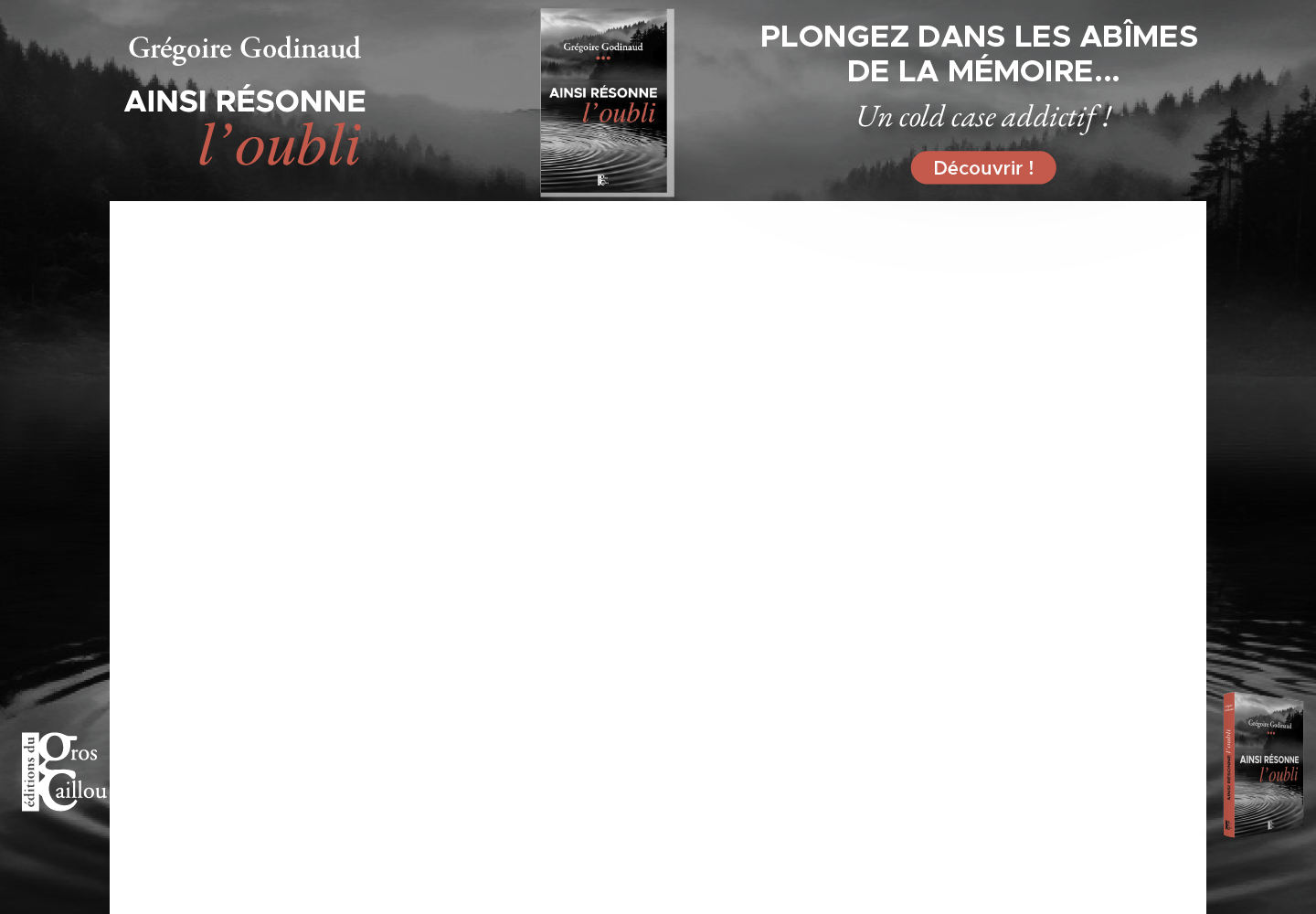Dès la sortie de La ballade de Rikers Island, un récit qui met en scène les mésaventures américaines d’un certain dirigeant d’une grande institution financière, jamais nommés ni l’un ni l’autre, Jean Veil, avocat de Dominique Strauss-Kahn, a bien sûr reconnu son client dans le personnage principal du récit de Régis Jauffret. Et annoncé à l’AFP que l’ancien directeur général du FMI allait porter plainte pour diffamation, c’est-à-dire choisir la voie de la procédure pénale, et non civile. Tout comme le propriétaire du château Angélus, Hubert de Boüard, qui a déposé une plainte en diffamation le 11 mars contre Isabelle Saporta et son éditeur Albin Michel à propos de Vino business : la face cachée du royaume enchanté, publié fin février. Ou encore le 12 février, la veille de la publication aux éditions du Moment de Coupole et dépendances : enquête sur l’Académie française, écrit par Daniel Garcia (collaborateur régulier de Livres Hebdo), l’Institut de France qui annonçait sur son site Internet une plainte pour diffamation.

L’éditeur Yves Derai, gérant des éditions du Moment, en est à sa troisième procédure pénale en un an, calcule-t-il, et a l’impression de subir une forme de harcèlement via ces plaintes qui l’obligent à répondre aux questions de la brigade de répression du banditisme et d’un juge d’instruction. "Les policiers comme le juge s’assurent simplement que je suis bien responsable du texte publié, il n’y a aucune enquête. Ils s’excusent même parfois de cette convocation pour des questions aussi banales, mais on est automatiquement mis en examen chez le juge. C’est quand même un peu infamant", s’énerve l’éditeur, qui traîne aussi une plainte du P-DG d’EDF, s’estimant diffamé dans Henri Proglio, une réussite bien française. Le Front national attaque aussi presque systématiquement au pénal. Le dernier exemple en date, dont le jugement est rendu ce 13 juin, concerne la plainte contre Claire Checcaglini, auteure de Bienvenue au Front : journal d’une infiltrée. Elle s’était fait passer pour une militante du FN et a rapporté le double langage de la présidente du parti d’extrême droite à propos des immigrés.

Rwanda
La maison qui s’est attiré le plus de procédures, civiles ou pénales, est sans doute Les Arènes. "On doit détenir un record, autour de 70 depuis notre création", évalue Laurent Beccaria, le fondateur de cette maison spécialiste de l’édition d’enquêtes et d’essais prometteurs d’ennuis, mais solidement argumentés : "Nous avons perdu deux fois seulement, avec 1 euro de dommages-intérêts." A côté de la médiatique affaire Clearstream, traitée au civil, un dossier pèse lourd dans ce compte : la réédition en 2009 de Complices de l’inavouable : la France au Rwanda, de Patrick de Saint-Exupéry, a provoqué une rafale de sept plaintes d’officiers supérieurs et de généraux, ulcérés de voir leurs noms en toile de fond sur la couverture, parmi une trentaine d’autres accolés à côté de ce titre accusateur.
Tous ont été déboutés, mais la procédure prend un tour extraordinaire dans une affaire de diffamation : deux plaignants en sont à leur second pourvoi en cassation. Rendus le 20 mai dernier, ils ordonnent pour la deuxième fois un renvoi en cour d’appel, à Lyon maintenant. Tous avaient choisi la voie pénale, pour un objectif avant tout symbolique et non financier, explique Pierre-Olivier Lambert, avocat de l’un d’entre eux, le général Lafourcade : "faire reconnaître qu’il n’était pas un complice de génocide" et obtenir "une condamnation par la société dans son ensemble", représentée par le ministère public dans une audience pénale. Mais Vincent Tolédano, avocat des Arènes, s’indigne du dévoiement de la prise en charge des frais de justice par le ministère de la Défense. En tant que fonctionnaires, ces officiers bénéficient tout à fait normalement de la protection et du soutien de l’Etat au titre de leur mission, mais ils ont choisi d’agir individuellement, devant plusieurs tribunaux en France, "à seule fin de contraindre l’auteur et l’éditeur à engager des frais importants pour organiser leur défense simultanée devant plusieurs juridictions".
"Mauvaise foi"
Les dossiers ont finalement été regroupés à Paris, mais sont restés individuels. "Le débat souhaité par certains officiers aurait dû faire l’objet d’un seul procès ; au lieu de financer en pure perte avec l’argent des contribuables des procédures multipliées sans fin et de parfaite mauvaise foi en vue de pénaliser un éditeur indépendant", s’irrite l’avocat. Interrogé à ce sujet, le ministère de la Défense n’avait pas répondu au moment de notre bouclage. Pierre-Olivier Lambert, avocat du général Lafourcade, qui vient d’obtenir la seconde cassation qu’il interprète comme une décision sur le fond, explique autrement cette offensive en formation dispersée : "La procédure de diffamation est une procédure nominative, dans laquelle la personne diffamée subit un préjudice qui lui est propre, en l’occurrence une atteinte à son honneur et à sa considération."
Vincent Tolédano souligne une autre déconvenue dans ce dossier, mais qui concerne toutes les affaires pénales : "L’auteur et l’éditeur ont chaque fois été mis hors de cause, mais sans qu’ils puissent obtenir le remboursement de leurs frais de procédure, la loi pénale ne le permettant pas." C’est une des différences avec une procédure civile : le juge peut contraindre le plaignant débouté à couvrir les frais de celui qu’il a attaqué. Au pénal, il faut que le tribunal reconnaisse une procédure abusive, ce qui est très rarement accordé.
"Le choix de la procédure dépend d’effets occasionnels plus que stratégiques", estime Emmanuel Pierrat, avocat spécialiste de l’édition. "A Paris, les chambres civile et correctionnelle sont regroupées, ce sont donc les mêmes magistrats, il n’y a aucune incidence", remarque-t-il. Et depuis l’homogénéisation des deux voies (voir l’interview de Nicolas Bonnal, p. 15), la procédure est tout aussi complexe et rigoureuse au civil, comme l’a appris à ses dépens Valérie Trierweiler, ex-compagne du président de la République, condamnée pour avoir retiré par opportunisme son assignation en diffamation contre La frondeuse (éditions du Moment). Pour le cas DSK, les éventuels dommages-intérêts seraient sans doute faibles, mais "au pénal, il pourrait dire qu’il a obtenu une condamnation", insiste Emmanuel Pierrat.
Le pénal permet aussi "aux plaignants d’instrumentaliser la mise en examen, comme si des indices graves et concordants étaient déjà là, permettant de dire que la diffamation est constituée", décode Christophe Bigot, avocat d’Henri Proglio, mais aussi de Stock, Flammarion, Grasset, entre autres éditeurs. En novembre 2013, l’AFP a ainsi titré qu’Alain Minc et son éditeur Grasset faisaient l’objet d’une telle procédure suite à la plainte de Christian Didier, l’assassin de l’ex-chef de la police de Vichy René Bousquet, qualifié de "fou" dans la biographie L’homme aux deux visages : Jean Moulin, René Bousquet, itinéraires croisés, publiée six mois auparavant. Le procureur d’Epinal Etienne Manteaux, chargé du dossier, a beau avoir pris la peine d’expliquer que "ce sont des mises en examen tout à fait formelles", l’effet voulu a été obtenu. Idem en mai dernier pour le "renvoi en correctionnelle", opportunément fuité dans la presse, de Johnny Hallyday et d’Amanda Sthers, coauteurs chez Plon de Dans mes yeux, autobiographie du chanteur, qui fait l’objet d’une plainte pour diffamation par Adeline Blondieau, son ex-femme.
Par surprise
Une plainte peut aussi être utilisée par l’éditeur pour remettre un livre dans l’agenda médiatique. Lorsque le Seuil a reçu celle de DSK, trois mois après l’annonce, le P-DG Olivier Bétourné a publié un communiqué solennel, en appelant à la "liberté de l’écrivain" et à son rôle en tant qu’éditeur qui consiste à la protéger.
A l’inverse, le pénal peut aussi permettre d’agir discrètement et de prendre l’éditeur par surprise : le plaignant n’est pas tenu de communiquer sa plainte au prévenu, comme le regrette Yves Derai à propos des accusations d’Henri Proglio, connues alors que le livre était déjà reparti des librairies. Au pénal, les délais sont en effet toujours bien plus longs. L’affaire DSK ne connaîtra ainsi sa première audience de procédure que fin juin, et ne sera pas plaidée avant l’an prochain.
Dommages-intérêts : inflation, confusion ou affaires exceptionnelles?
Quelques affaires récentes ont pu donner l’impression d’une inflation dans les dommages-intérêts auxquels sont condamnés auteurs et éditeurs, mais ces dossiers concernent en fait des cas d’atteinte à la vie privée.
Le plus médiatique d’entre tous et le plus récent est le référé intenté par Dominique Strauss-Kahn contre Marcela Iacubet son éditeur Stock pour Belle et Bête (50 000 euros). Juridiquement, ce motif n’a rien à voir avec la diffamation, même s’il peut être invoqué conjointement.
Le cas de diffamation le plus lourdement condamné dans l’édition concerne L’enfant d’octobre, publié le 4 avril 2006, qui a valu 20 000 euros de dommages-intérêts à l’encontre de Philippe Besson et son éditeur Grasset en première instance, plus 10 000 euros pour atteinte à la vie privée de Christine Villemin et 5 000 euros pour atteinte à celle de son conjoint, Jean-Marie Villemin. En appel, la cour a sévèrement alourdi les dommages-intérêts, portés à 15 000 euros chacun pour les époux Villemin pour atteinte à la vie privée, et à 50 000 euros pour la diffamation commise à l’encontre de Christine Villemin, ordonnant en plus la suppression, en cas de réimpression ou de réédition, des passages incriminés. L’ouvrage, très discuté jusque dans le milieu de l’édition, prêtait à Christine Villemin des propos qui en faisaient la meurtrière de son fils, alors qu’elle avait été innocentée.
"J’ai toujours souhaité que le montant des dommages-intérêts reste essentiellement symbolique, mais je sais bien que je ne suis pas majoritaire, et il apparaît quelquefois au juge qu’il est nécessaire de réparer une vraie souffrance infligée à la personne diffamée", explique aujourd’hui Nicolas Bonnal, alors juge à la 17e, et qui avait prononcé la condamnation en première instance. "Le principe est la réparation intégrale du préjudice, mais il est de nature purement morale, et donc très difficile à estimer", ajoute le juge, aujourd’hui président de chambre à la cour d’appel, précisant aussi que la justice anglaise a la main terriblement plus lourde.
Dans une affaire d’une tout autre dimension, et maintenant examinée au fond, la 17e a condamné en référé Johnny Hallyday, Amanda Sthers et leur éditeur Plon à 1 euro d’amende, et 1 euro de dommages-intérêts à Adeline Blondieau, ex-épouse du chanteur, pour diffamation et atteinte à la vie privée commises dans l’autobiographie Dans mes yeux.
La dépénalisation serait un piège
Nicolas Bonnal, aujourd’hui président de chambre à la cour d’appel de Paris, a présidé pendant dix ans la 17e chambre du TGI de Paris, qui traite principalement des affaires de presse et d’édition.