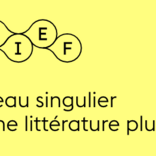Jean-Marc Roberts n’était pas l’écrivain des longues phrases, du grand style. Pas l’écrivain non plus de grands romans, amples et ambitieux, comme on dit. Adepte de l’autodérision, il a souvent été son plus lucide critique, se chargeant lui-même de remettre ses livres - une vingtaine publiée sur quarante ans - à leur place : ne les qualifiait-il pas de « petits romans de saison » dans François-Marie (Gallimard, 2011), plaidoyer pour le photographe François-Marie Banier, acolyte de ses 20 ans, compère des quatre cents coups ? « Mes livres, comme l’a regretté P.O.L en me refusant l’un d’entre eux, ressemblent à des tours de cabaret. Je fais sortir des lapins d’un chapeau, au mieux des colombes, mais si peu de vérités. Où est leur profondeur ? » s’interrogeait-il déjà dans Toilette de chat (Seuil, 2003), ce roman qui appartient à la veine plus franchement autofictive amorcée au mitan des années 1980. Dans le même livre, on pouvait aussi trouver cette appréciation : « Mes livres semblent tellement légers que je finirai par m’envoler avec eux. »
L’ancien « petit gros » avait mis sa prose au régime, écrivant des livres comme des biscuits secs, sans matière grasse, peu roboratifs. Pris un par un, sans doute aucun chef-d’œuvre, mais mis bout à bout, au final, une œuvre pourtant, un ensemble identifiable qui faisait dire dans ces colonnes, à propos de La prière (Flammarion, 2008), qu’il avait l’air d’« un Roberts très Roberts ». Qu’est-ce qu’était donc un Roberts ? C’était mince, souple, séduisant, gentiment roublard, furtif, habile, ironique, codé, coquet, cruel par saillie, grave en contrebande…
Eternel meilleur espoir.
Sa carrière avait commencé un peu par hasard mais pied au plancher, à 18 ans, avec Samedi, dimanche et fêtes (prix Fénéon 1973), le premier manuscrit accepté par Jean Cayrol après trois refus. L’adoubement, lui aussi, avait été précoce : lauréat du prix Renaudot 1979 pour Affaires étrangères, le jeune écrivain pouvait déployer à 25 ans l’étendard plein de promesse d’« écrivain le plus doué de sa génération ». Taraudé par la reconnaissance et doutant de la mériter, parvenu doué, Jean-Marc Roberts est ainsi resté l’éternel meilleur espoir des lettres françaises. Rien qui ressemble au destin du pote de jeunesse Modiano.Roberts romancier, saison 1, cela aura été une dizaine de titres enchaînés avant d’atteindre les 30 ans jusqu’à Méchant (1985), une étape. Il ne voulait plus écrire de romans « adaptables », analysait-il des années plus tard, après que cinq d’entre eux furent devenus des scénarios de films. Affaires étrangères, cette histoire de jeune cadre persécuté par son patron dans le monde de la publicité, était devenu en 1981, derrière la caméra de Pierre Granier-Deferre, Une étrange affaire, avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli dans les rôles principaux. Le même adaptera en 1983 L’ami de Vincent, tiré du roman éponyme.
A partir de 1988 et de Mon père américain, que, bloqué, Roberts mettra trois ans à écrire, le romancier accentuera encore le tournant autobiographique, donnant régulièrement, quoique à un rythme moins soutenu, des nouvelles de sa vie amoureuse et professionnelle, mêlant les protagonistes (rebaptisés ou non) de son show de music-hall - mère (Peggy dans les romans), femmes aimées, enfants et collègues - à des fictions qui s’amusaient à cacher les clés : Une petite femme, Un début d’explication, Je te laisse…
Désinvolture élégante.
Lui qui, en 1982, se décrivait en écrivain ayant besoin d’habitudes, de régularité, offrait plutôt des livres de dilettante qui donnaient l’impression d’avoir été écrits en passant, des romans « en vitesse » comme il le disait des souvenirs convoqués dans Deux vies valent mieux qu’une, le livre dans lequel, peut-être parce qu’il misait avec le plus de sincérité sur l’idée que ce serait le dernier, le tour de l’illusionniste était particulièrement réussi. Emouvant, autant que peuvent l’être ces drames où le héros-narrateur, en position particulièrement délicate, conserve une insouciance, une inextinguible joie. Et il faut du talent pour la légèreté. Encore plus pour s’y tenir. Ni l’âge, ni la maladie ne sont parvenus à recouvrir d’amertume la désinvolture élégante de la griffe Roberts. C’était sa grâce, un savoir-vivre.Jean-Marc Roberts avait un jour raconté qu’il s’était mis à écrire à 15 ans et demi quand il avait compris qu’il ne serait pas chanteur. « Je voudrais enfin réussir à lire Proust en entier, Thomas Mann aussi. Je ne m’abrite pas derrière une pose quand je parle d’imposture. On voit bien que je n’écris pas avec autant de mots », insistait-il dans son ultime livre. « Pas autant de mots », voilà bien le genre de tournures en esquive qu’il affectionnait : feinter en utilisant une négation à la place d’une affirmation. Ainsi il n’écrivait pas « Gérard venait d’apprendre une mauvaise nouvelle », mais « Gérard ne venait pas d’apprendre une très bonne nouvelle ». Une façon toujours déviée d’aller au but. Dans Cinquante ans passés (Grasset, 2006), Jean-Marc Roberts avait fait mettre sur la quatrième de couverture : « J’ai toujours rêvé d’écrire un livre comme celui-ci. Doux et imprévu. Un livre que je n’attendais pas. Raconter ce qui ne s’est pas passé, rien que pour voir où ça nous mène. » <
Véronique Rossignol