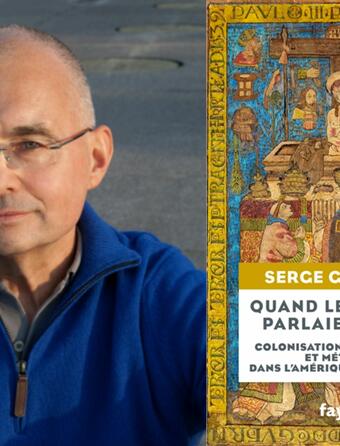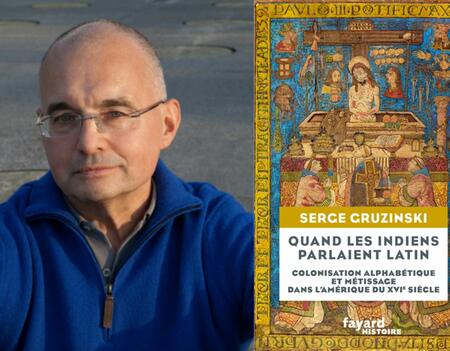La lutte contre le racisme et l’antisémitisme a été désignée “grande cause nationale”. Ce qui se traduit concrètement tant par une quarantaine d’actions que par un Plan gouvernemental 2015-2017, qui ont été présentés en avril dernier.
Le gouvernement a ainsi l’intention de rendre les actions plus efficaces et plus pédagogiques, en particulier en “intégrant la répression des discours de haine au droit pénal général pour simplifier les règles d’enquête et de jugement”. Il s’agit aussi de mieux réguler les propos qui fleurissent sur internet dans une apparente impunité.
Les “hébergeurs de contenus destinés au public français” devraient avoir bientôt “l’obligation de disposer d’une représentation juridique en France”. Et il devrait être créé une “unité nationale de lutte contre la haine sur internet”.
Rappelons que, en droit, la mise en ligne n’est qu’une déclinaison, et donc une nouvelle potentialité, de l’écriture et de la lecture, même si les nouvelles pratiques semblent se jouer des règles classiques de la diffamation ou de l’incitation à la haine raciale. Internet, que ce soient la presse et l’édition en ligne ou les réseaux sociaux, n’est pas au cœur d’un vaste vide juridique, où les pirates resteraient impunis, faute de droit applicable.
Il faut prendre garde à plusieurs phénomènes qui déforment le discours juridique relatif au numérique. Il s’agit notamment du décalage entre l’intention et l’action : le numérique suscite des prises de position démagogiques sur le thème de la piraterie continue et de la transgression permanente, et donc d’une supposée absence de lois et règlements appropriés, que les pouvoirs publics pourraient faire cesser par l’adoption d’un nouveau texte juridique miraculeux. Il y a aussi et surtout le discours lobbyiste émanant des prestataires techniques, qui ont tout intérêt à prôner le vide juridique afin d’être juridiquement déresponsabilisés et pouvoir diffuser sans rendre de comptes. Ce débat s’étend aujourd’hui au monde du cloud computing, ces nuages qui peuvent abriter de gigantesques bibliothèques numériques.
En réalité, le droit de l’information – et même le droit d’auteur ou encore le droit de la consommation – s’appliquent aux réseaux, au même titre qu’à n’importe quel autre support.
Alors que le numérique est présent dans nos vies depuis une vingtaine d’années, la plupart de nos concitoyens ignorent les conséquences de ce qu’ils publient, affichent ou partagent sur internet.
Il est vrai que la confusion est facile. Un message adressé par une personne à une autre est, éventuellement, en droit, une diffamation (s’il s’agit d’une imputation ou allégation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la réputation). Cela peut aussi devenir une apologie du terrorisme ou une incitation à la haine raciale. Mais le vrai critère consiste à savoir si les propos ont été rendu publics. C’est-à-dire à prouver qu’ils ont été diffusés au-delà d’une conversation privée. Si tel est le cas, les capacités d’action de la victime de diffamation ou d’injure sont en effet beaucoup plus importantes. Les sanctions le sont tout autant. Un message public est en effet susceptible de constituer un délit, à la différence d’un message privé, qui relève de la simple contravention.
Afin de déterminer ce qui relève du caractère public ou privé, les juges se sont appuyés sur des exemples qui préexistaient à notre monde moderne. C’est ainsi par exemple que certaines informations syndicales ont été jugées blâmables lorsqu’elles étaient affichées sur un panneau au sein de l’entreprise, visible par tous. De la même façon, si le courriel est adressé à plusieurs correspondants au lieu d’un seul – comme cela est très faisable via un réseau social ou une mailing list, les magistrats peuvent estimer que le message est passé du registre privé à celui de publication. Il n’y a pas de chiffre magique ou scientifique à partir duquel un seuil serait franchi. Chaque cas est apprécié individuellement.
Cette méthode, très pragmatique, est utilisée pour la publication sur une page Facebook. Si la page n’est accessible que sur autorisation, ouverte à un cercle très limité d’“amis”, elle peut, le cas échéant, être regardée, en justice, comme privée. A l’inverse, une publication sur le réseau social Twitter – un “tweet”, par nature visible par tous les utilisateurs dudit réseau social, sera en principe considéré comme un message public. Certains tweets ont d’ailleurs déjà conduit à la condamnation de leurs auteurs, qui avaient visiblement laissé leur intelligence éloignée de leur clavier. C’est ainsi que trois personnes ont par exemple été condamnées, au mois de janvier 2014, pour avoir publié sur Twitter des messages comportant des propos homophobes. Un représentant du peuple, député, a quant à lui été condamné, la même année, pour provocation à la haine raciale en raison d’une publication portant sur les “descendants d’esclaves”. Dernier exemple : un autre utilisateur de Twitter a été condamné pour injure publique envers un particulier, en l’occurrence Jean-François Copé.
Non, internet n’est pas un lieu où l’on peut dire n’importe quoi en toute impunité, et chaque citoyen – même mineur ! – doit se résoudre à tourner sept fois son pouce devant son clavier avant de poster des messages ou commentaires sur internet.
L’anonymat sur les principaux réseaux sociaux est par ailleurs de moins en moins d’actualité, et se cacher derrière un pseudo ne sert plus à grand chose au regard du risque juridique. Les trois internautes ayant tenu des propos homophobes sur Twitter ont par exemple été identifiés, malgré leurs pseudonymes, grâce à des investigations techniques.
C’est pourquoi les mesures annoncées portent à la fois sur la possibilité de rendre des ordonnances pénales en matière d’injures racistes comme sur le développement des peines à valeur pédagogique.