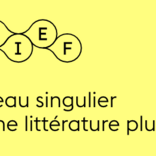La hausse spectaculaire de la part des traductions dans les rayons jeunesse et pratique n’est pas le fruit exclusif d’un changement de politique éditoriale des grands acteurs du marché. Elle reflète aussi un effet de masse lié à la création de petites maisons ou de nouvelles collections, qui bien souvent commencent par des titres traduits, façon d’étoffer rapidement leur catalogue.
Les gros éditeurs de pratique, d’Eyrolles - dont Eric Sulpice, directeur éditorial pour les loisirs créatifs, annonce 5 % de traductions en moyenne dans la production annuelle - à Solar qui en affiche « environ un tiers », selon son directeur Jean-Louis Hocq, ont pour leur part le sentiment d’une proportion « stable » de traductions dans l’ensemble, dont les variations sont aléatoires. « Nous sommes effectivement passés de 30 titres traduits en 2011 à 50 en 2012, mais nous n’en prévoyons que 40 en 2013 », souligne Catherine Saunier-Talec, directrice d’Hachette Pratique. En jeunesse, Hélène Wadowski, directrice de Flammarion-Père Castor et présidente du groupe jeunesse au SNE, nuance elle aussi cette hausse : « On parle beaucoup des traductions, car ce sont des succès qui se remarquent. Mais la part de traductions dans le catalogue reste plus ou moins constante d’une année à l’autre. » Christophe Savouré, responsable éditorial de Fleurus Pratique et Jeunesse, Mango Pratique et Jeunesse et Rustica, estime que « la part des traductions est de 10 à 15 titres par an pour Mango Jeunesse, mais il n’y en a pas eu 15 en 2012 », le catalogue Fleurus jeunesse étant, lui, constitué exclusivement de créations.

Le choix de la traduction résulte en effet de stratégies qui ne sont pas forcément « aussi évidentes qu’elles en ont l’air », comme le dit Hélène Wadowski. « Ce n’est pas une facilité : l’investissement est moins rentable pour un petit tirage, mais c’est une recherche de qualité qui a un coût. La diversification du catalogue est nécessaire, mais le travail de recherche prend beaucoup de temps. » Pour Flammarion, les achats se concentrent sur des romans unitaires, majoritairement anglo-saxons : « Les auteurs ont un savoir-faire pour raconter des histoires, que l’on retrouve dans la production audiovisuelle. Leur rapport à l’écriture est différent, ils fonctionnent très bien sur des idées, et cela permet de rencontrer des thèmes plus variés. »

Vers l’Orient.
Chez Mango Jeunesse, Christophe Savouré s’est tourné vers l’Orient : « Les Coréens et les Japonais deviennent des pourvoyeurs importants. Leur travail graphique correspond à un goût qui s’est développé en France depuis plusieurs années maintenant. Nous fonctionnons surtout au coup de cœur pour le travail d’un illustrateur. Néanmoins, il nous arrive d’acheter les droits pour une collection, comme “Nature en vue?, que nous avons découverte chez un éditeur coréen. L’énorme travail iconographique n’aurait pu être réalisé pour un prix d’achat raisonnable en création. De même, pour un livre jeunesse de fabrication complexe, un packager, qui le tirera aussi bien pour nous que pour les marchés allemands, italiens et j’en passe, a un coût de fabrication divisé par autant, et nous évite de le répercuter en librairie. »Cet aspect financier est davantage présent dans le rayon pratique. « Quand nous proposons un livre de référence en jardinage qui couvre toute l’année, l’iconographie est énorme. Comment voulez-vous que nous proposions la même chose en création ? Cela reviendrait beaucoup plus cher à produire, et donc à acheter pour le lecteur », s’exclame Catherine Saunier-Talec. Dans un secteur très influencé par les modes, le recours à l’achat est aussi une façon de se positionner rapidement sur le marché : « Les délais de publication se trouvent divisés par deux », mesure Christophe Savouré. Cependant, la facilité financière est, elle aussi, à nuancer, si l’on en croit Jean-Louis Hocq : « A moyen terme, c’est moins rentable que de créer : les droits de réexploitation ne sont pas compris, et il est plus difficile, dans le cas d’un contrat avec un packager, de réajuster le tir en amont de la publication, notamment au niveau du tirage. Ce qui fait qu’on peut se retrouver avec des stocks sur les bras… »
Et puis, les éditeurs ne croient pas vraiment à la disparition totale des frontières. Aussi bien en jeunesse qu’en pratique, la mondialisation reste relative. « Quand un livre est destiné à être publié dans toutes les langues, comme c’est le cas avec les packagers, il y a, malgré la qualité, une sorte d’uniformisation des goûts, que les libraires comme les clients identifient très vite et qui n’est pas attrayante : il y manque un certain point de vue d’auteur », analyse Eric Sulpice. Ce qui n’empêche pas une « universalisation des goûts », selon Catherine Saunier-Talec, qui ajoute que « pour les vins ou la chasse, on ne recourt pas à la traduction. Nous sommes attendus par notre public français ». Comme le note Christophe Savouré à propos des livres de cuisine anglais, très traduits partout, « si cela marche pour les salades, ce n’est pas forcément le cas pour les pâtisseries ». Pour Jean-Louis Hocq, « un double phénomène est à l’œuvre : il y a un retour à la tradition culinaire nationale, mais il s’accompagne d’une ouverture aux gastronomies d’ailleurs ». Ce que retrouve Christophe Savouré en jeunesse : « La génération des années 2000 est indubitablement plus cosmopolite que les précédentes. Mais cela nous ouvre des portes : c’est le cas en France, mais aussi dans le reste du monde. » Plus de traductions, peut-être, mais dans les deux sens.
< Fanny Taillandier