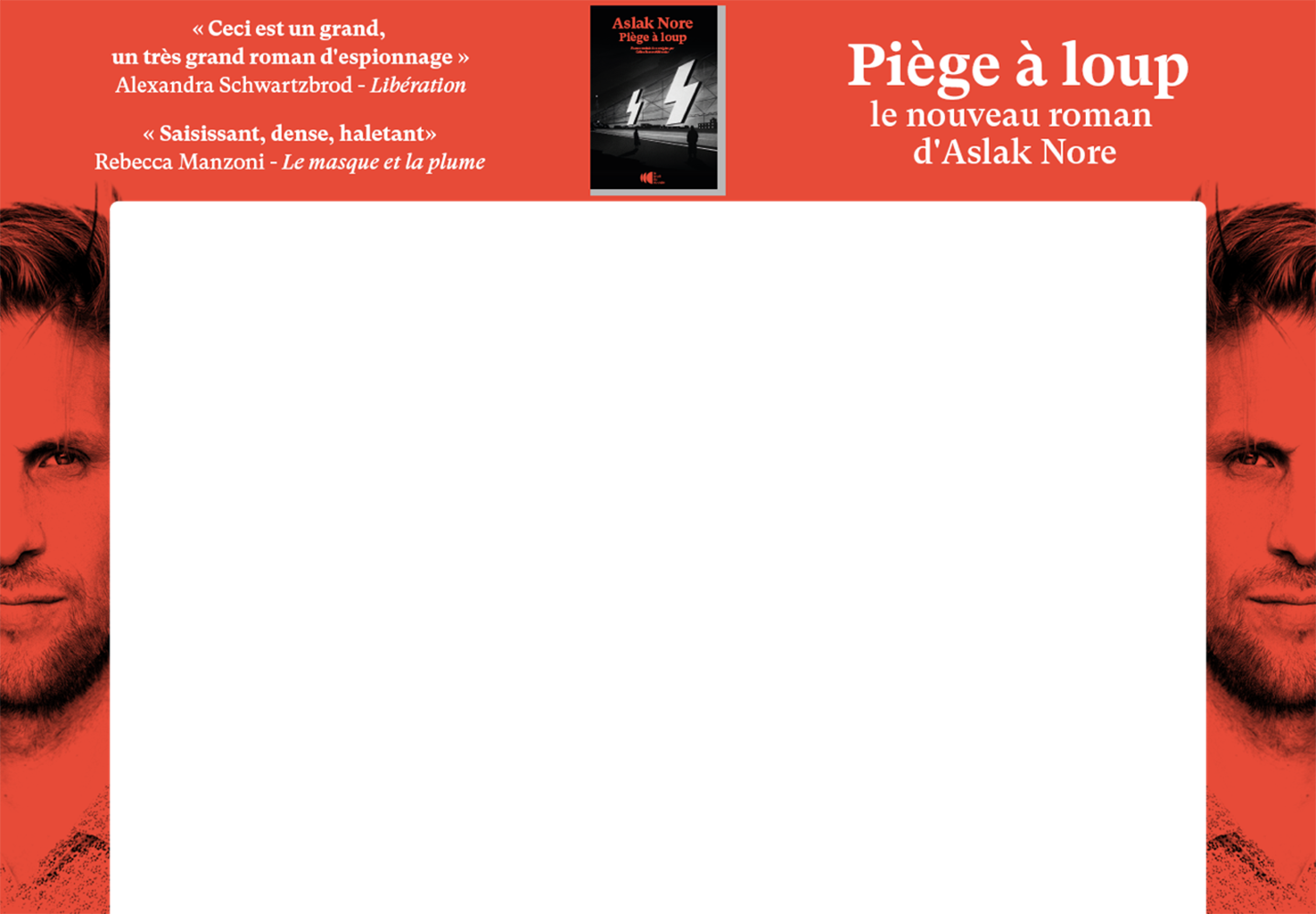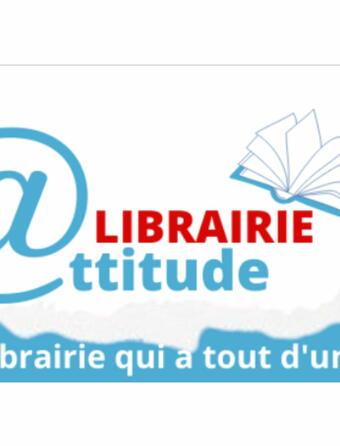Le récit, car c’en est un, commence par la mort d’un fidèle. Il est venu s’éteindre à La Mecque, sous les yeux de l’auteur qui dépose un drap sur le sol. C’était en 1975. Ziauddin Sardar accomplissait le hajj, le pèlerinage à la ville sacrée, l’un des plus importants devoirs qui incombent à un musulman. Depuis, ce journaliste et historien né au Pakistan et ayant grandi près de Londres - il enseigne à la City University - a publié près de quarante livres sur l’islam, sa culture, sa science et sa civilisation.
Il nous embarque donc dans cette aventure accomplie par près de trois millions de musulmans chaque année, ce qui constitue le plus grand rassemblement du monde. Mais, surtout, il raconte l’histoire de cette ville, dont Mahomet fit le cœur spirituel de sa mission contre l’aristocratie polythéiste mecquoise qui refusait la nouvelle religion.
Sur quatorze siècles, Ziauddin Sardar déroule l’histoire profane de la Ville sainte qui est un condensé de l’islam, avec ses luttes entre chérifs, sultans et califes, et les différents courants spirituels qui s’y sont affrontés, parfois de manière sanglante, autour de la Kaaba.
A la différence de l’excellent travail de Sylvia Chiffoleau qui se limitait au pèlerinage (Le voyage à La Mecque, Belin, 2015), Ziauddin Sardar investit la totalité du champ religieux pour cette histoire narrative dans laquelle il s’inscrit pleinement. Partisan de l’ouverture contre le puritanisme wahhabite, il aide à comprendre les troubles qui agitent l’islam, notamment entre l’Arabie saoudite et l’Iran, à travers une ville qu’il présente avec force comme le microcosme du monde musulman. L. L.