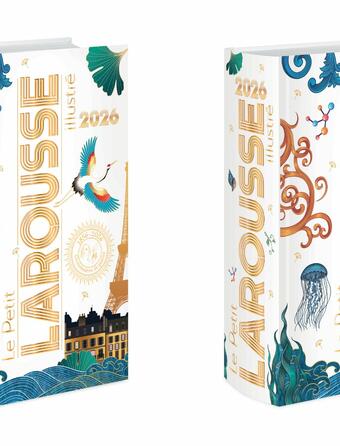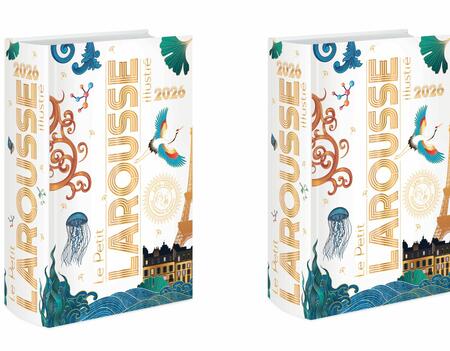"Qui l’on est a-t-il tant d’importance ? Nous n’étions qu’une famille au milieu de milliers d’autres familles qui appréciaient Vestegnen et son bien-être en expansion, avec ses écoles, ses piscines, ses centres commerciaux et ses complexes sportifs. Là, les photos sont en couleurs, délavées par le temps comme les jeans qui étaient alors à la mode. Des pastels jaunis qui donnent à l’ensemble un éclat brumeux et mat, même aux voyages en Crète et aux Canaries. A quel moment cela n’avait-il plus suffi ?"
Finalement, de livre en livre (et Les portes de fer est déjà son dixième roman traduit en français), Jens Christian Grøndahl n’aura fait qu’essayer de répondre à cette question. A quel moment ? A quel moment les choses ont-elles cessé d’être ce qu’elles devaient être ? A quel moment s’est éteinte l’espérance des beaux lendemains ?
Comme toujours, ce sera donc à nouveau l’histoire d’un homme. De sa vie, de ses vies, de ses femmes, aussi. En trois temps distincts, cette fois. On le découvre dans le Danemark du miracle social-démocrate, alors que sa mère se meurt d’un cancer au moment où elle s’apprêtait à refaire sa vie, ayant appris l’allemand pour pouvoir lire Karl Marx dans le texte. Il tombe éperdument amoureux de la fille de son professeur d’allemand réfugiée de Berlin-Est et laisse tout pour la rejoindre au pied du rideau de fer. Les années passent, l’âge vient avec le mariage, un enfant, le divorce. Devenu enseignant à son tour, le narrateur, 40 ans, est fasciné par l’un de ses élèves venu de Serbie, Stanko, et plus encore par la mère du jeune garçon. Mais peut-être la passion est-elle déjà un luxe qu’il ne peut plus se payer. Enfin, le voilà à Rome, presque sexagénaire, déjà grand-père, dans les rets d’une torve nostalgie. Il rencontre une photographe qui pourrait être sa fille, qu’il emmène à Paestum comme en un lent au revoir. Il lui parle des ruines : celles des civilisations, celles d’une vie.
Bien entendu, Les portes de fer est d’abord un grand roman générationnel. Grøndahl a-t-il jamais écrit autre chose ? Seulement, à la manière d’un Modiano, qu’il admire et à qui l’apparente son goût pour les topologies urbaines, il écrit moins le même livre qu’il ne le poursuit. Ses dérives existentielles - souvent d’un bout à l’autre de l’Europe, vécue comme un destin partagé - sont comme autant de thèmes musicaux repris sans cesse avec de légères dissemblances de l’un à l’autre. Depuis longtemps, Grøndahl a évacué le problème de la modernité en littérature. Il n’écrit pas classique, il écrit charnel. Hormis le regretté James Salter, qui sait comme lui dire le désir, la tristesse de son assouvissement ? Il écrit aussi d’un monde disparu : la bourgeoisie, dont c’est moins le charme qui est désormais discret, que le drame. Les jolies choses s’en sont allées, reste leur souvenir. C’est mieux que rien. C’est mieux que tout. Olivier Mony