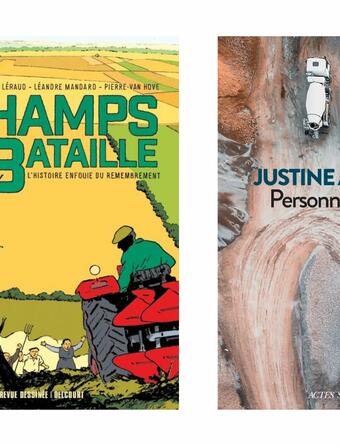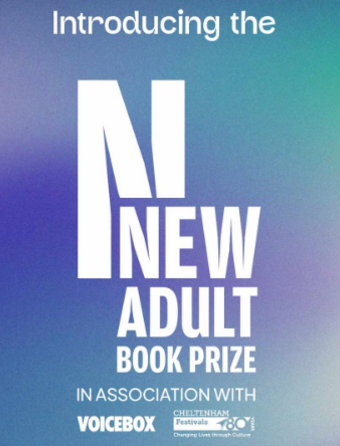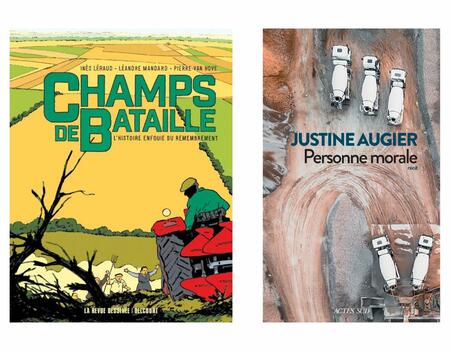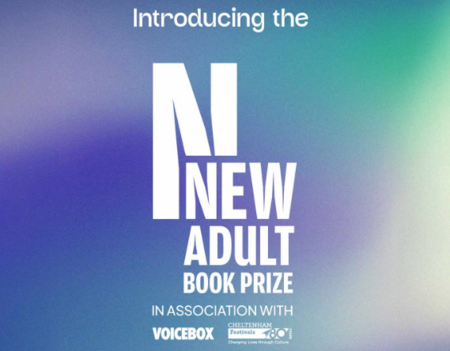C’était les années 1980. L’époque de l’argent coulant à flots, de l’adrénaline provoquée par la flambe. De la drogue, du sexe à foison, de la "grande fiesta de l’insouciance". Le narrateur du nouveau roman de Robert Goolrick se souvient de ses "outrances publiques" et de ses "excès privés". Il n’en est pas fier. Il ne présente pas d’excuses, décrit juste des faits irréfutables. "J’avais tellement de charme que j’aurai convaincu un poussin d’éclore, ou vendu la clim à un Esquimau mort", affirme-t-il. En ce temps-là, monsieur avait le corps sculpté, un sourire aux dents parfaites, des costumes à cinq mille dollars, des lavallières Hermès à deux cents dollars et des palanquées de cravates Charvet. C’était un type incontournable à qui tout réussissait. Celui-ci se rappelle son arrivée à Wall Street, dans la "Firme" et sa tour noire en verre. L’entretien d’embauche d’alors consistait en une partie de poker avec le grand patron, un ponte doté de huit secrétaires, avec un bureau ayant appartenu à Napoléon.
Plus tard, après avoir touché le pactole et le ciel, il y eut le revers de la médaille. L’envers du paradis. La chute. Un licenciement sans ménagement et avec une gifle un jeudi. Carmela, fille brillante mariée à East Hampton en présence de Lee Radziwill et d’Henry Kissinger, a aussitôt demandé le divorce. Puis le trentenaire a connu quatre internements, deux fois en désintox et deux fois à l’asile. Désormais, le héros de La chute des princes a un poste chez Barnes & Noble. Il souffre d’insomnie, visite des appartements qu’il ne pourra jamais acheter, se contente d’un studio…
L’auteur de Féroces (Anne Carrière, 2010, repris chez Pocket) et de Arrive un vagabond (Anne Carrière, 2012, repris chez Pocket) signe ici un formidable portrait d’époque. Et décrit avec minutie le New York des eighties, ville de tous les excès et de toutes les extravagances que le sida allait ravager. Tendu et tenu, alternant parfaitement l’adrénaline et la mélancolie, La chute des princes est un petit chef-d’œuvre du genre. Al. F.