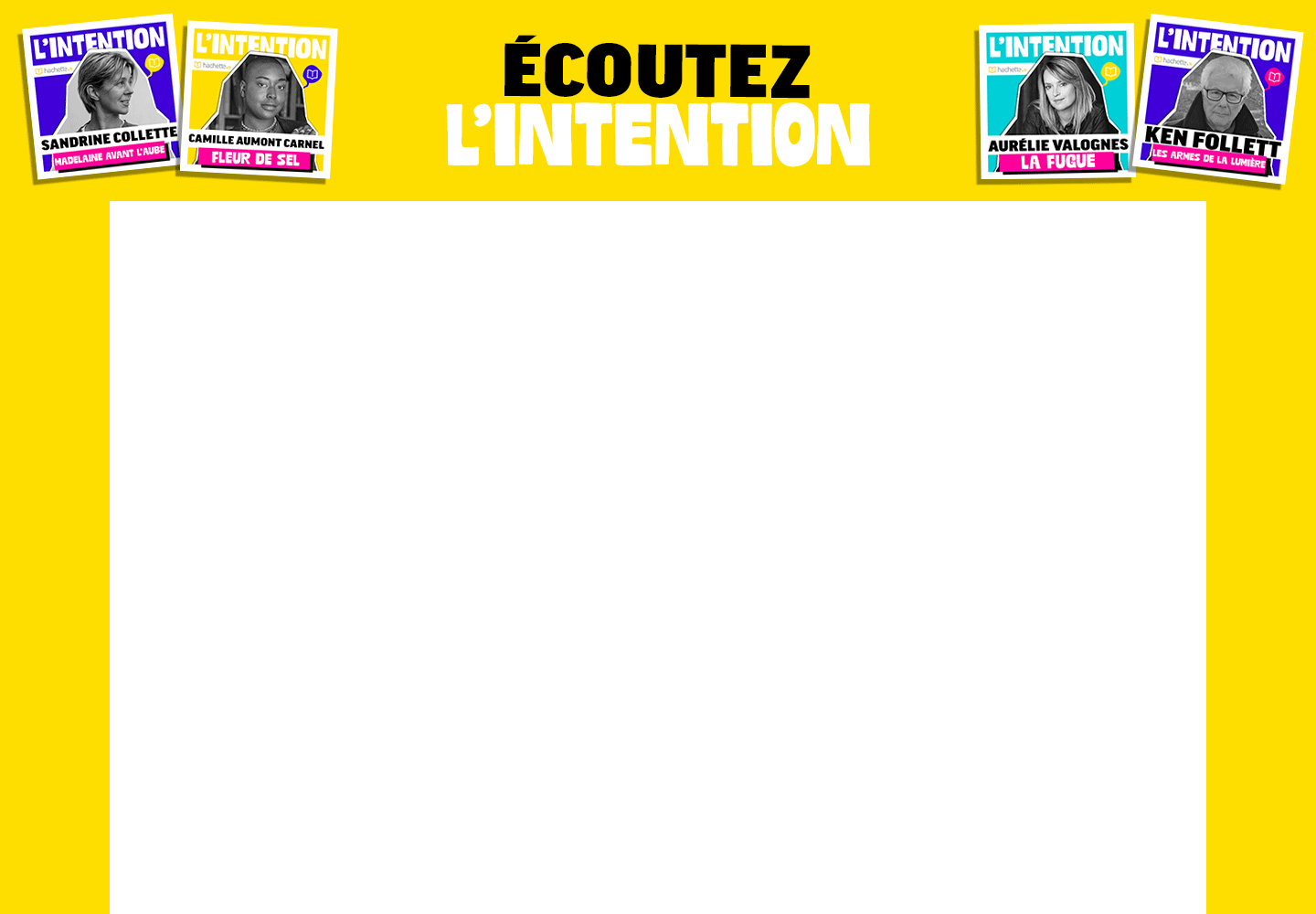Avec la publication chez Plon en 2011 des Privilèges, cinquième roman de son auteur, mais le premier traduit en français, les lecteurs découvraient fascinés un nouveau grand romancier américain. Elégiaque et endeuillé, moins fitzgéraldien peut-être qu'il n'y parut de prime abord, mais plus moraliste que son sens du récit ne le laissait initialement deviner, Jonathan Dee confirme avec cette Fabrique des illusions, roman initialement paru aux Etats-Unis en 2002, l'étendue de son talent.
Ces illusions-là, qui seront bien entendu perdues, naissent du miroir aux alouettes de la publicité. Ce sont aussi celles - amour, ambition artistique, franchissement du plafond de verre - par lesquelles toute jeunesse tend à s'épuiser. Ainsi en va-t-il de Molly Howe, trop belle jeune fille pour un endroit trop petit (voire étroit), qu'un scandale provincial (avoir couché avec un homme marié, ce genre de choses...) chasse de sa ville d'enfance. Recueillie par son frère sur le campus de Berkeley, en ces années 1980 où le libertarisme cède peu à peu la place à un ordre moral et reaganien, elle y fait la connaissance de John Wheelwright, un étudiant en histoire de l'art, presque mystérieux de timidité. Les deux s'aimeront, comme ils peuvent, c'est-à-dire mal, dans l'inconscience de la force de leurs blessures intimes. Dix ans plus tard, on retrouvera John, publicitaire aliéné à New York, quittant femme et boulot, pour répondre à l'invitation d'un étrange gourou de la pub, amateur d'art contemporain, se donnant pour mission de vider la publicité de sa substance commerciale pour la proposer à tous comme un art pur, exempt de toute ironie. Et John retrouvera, dans l'orbite de ce mogul ambivalent, Molly, avec laquelle les choses ne tarderont pas à reprendre au point exact d'incompréhension mutuelle (et de chagrin) où ils les avaient laissées.
Jonathan Dee orchestre ce requiem pour des illusions perdues avec une époustouflante maestria. La perte ici est aussi celle de l'innocence, celle de ses héros comme celle de cette idéologie wasp sur laquelle se sont fondés la puissance et l'imaginaire du modèle d'un monde qui a cru pouvoir se définir comme nouveau... Déconstruisant le temps du récit en un jeu de miroirs entre les deux époques, il nous plonge dans le plus doux, et le plus terrifiant, des désenchantements. On songe au James Salter d'Un bonheur parfait (L'Olivier, 1997), au Rick Moody de Tempête de glace (L'Olivier, 2003), à tous les grands romanciers mandataires liquidateurs du rêve américain. Le reste, la beauté de ces désastres intimes, appartient au mythe et ne nous quittera pas de sitôt.