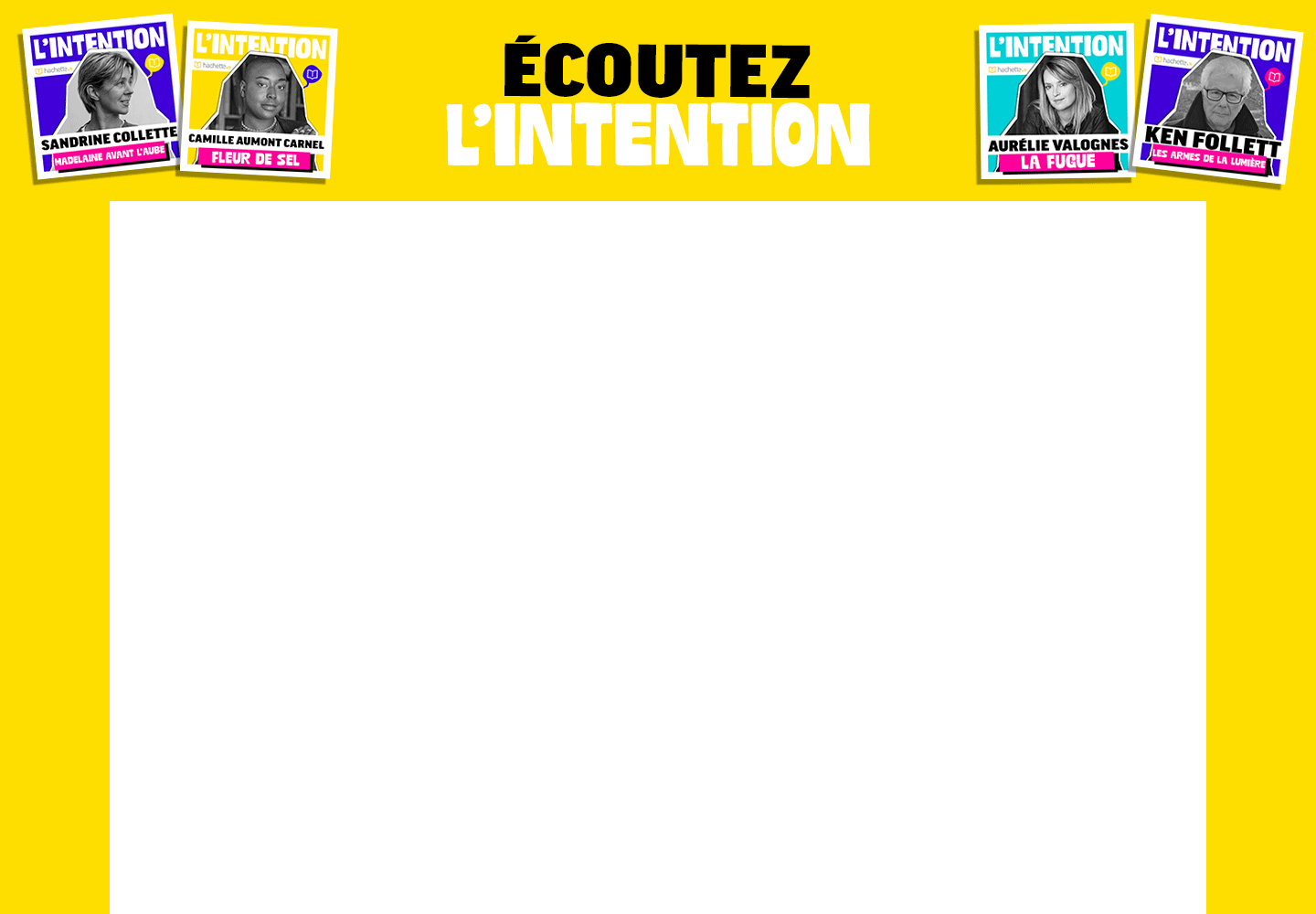Prenez Dickens, rajoutez-y Philip Roth, mais aussi John Irving, une pincée de Saul Bellow et, pour peu que vous soyez persuadé que le roman (et notamment le trop fameux "big american novel") demeure un outil essentiel de compréhension du monde, vous obtenez Mordecai Richler. Combien de temps faudra-t-il avant que les lecteurs français comprennent - comme seuls avant eux, en Europe, les Italiens l’ont fait - quel immense écrivain, quel "ogre" romanesque, était Richler (disparu en 2001, à l’âge de 69 ans) ? Peut-être le temps de la reconnaissance est-il arrivé puisque les éditions du Sous-sol entreprennent de rééditer, à raison d’un titre par an, en collaboration avec l’éditeur canadien Boréal, et dans de nouvelles traductions enfin dignes de ce nom et respectueuses des savoureux "montréalismes" des textes originaux, l’ensemble de l’œuvre romanesque du génial et un tantinet misanthrope écrivain.
Coup d’envoi donc, avec ce Solomon Gursky. Choix judicieux tant il s’agit là de l’un des sommets de l’œuvre, grand texte de la maturité et maelström furieux, qui en compile toutes les obsessions comme portées à leur incandescence. C’est la plus drôle et pourtant foncièrement mélancolique des sagas. Une saga familiale sur fond de mythe du juif errant, d’identités introuvables ou fantasmées, mais aussi d’expédition en Arctique, de tribus inuites converties au judaïsme, de Londres au temps de Dickens, de la Longue Marche de Mao, de l’ultime coup de téléphone de Marilyn Monroe, de prohibition et de tout ce qui peut parfois exhausser la vie au rang de l’épopée. Le tout, sous l’œil noir d’un corbeau qui vole au-dessus de ces six cents pages furieuses et enchantées et de six générations de la famille Gursky (très librement inspirée à Richler par les Bronfman, alors propriétaires de la plus importante multinationale de vins et spiritueux dans le monde, famille "royale" judéo-canadienne à l’histoire sulfureuse). Solomon Gursky est une éblouissante réussite romanesque dans laquelle l’écrivain apparaît comme merveilleusement maître de sa propre démesure. Construit autour de ce qui est la "scène initiale" de presque tous ses livres : la disparition, l’enquête sur un disparu et sur le monde qui bascule avec lui.
En clair, l’infinie présence des morts. Ici, celle de ce Solomon Gursky, ange et démon, dont l’absence hante comme un remords mal enfoui tous ceux qui se soumirent à son charme dévoyé. En ce sens, dans l’analyse infiniment subtile qu’il peut y faire des ambiguïtés du charisme, le roman peut aussi se lire comme une variation autour de Gatsby, jusque dans la mélancolie. Voilà une fresque américaine de la fin du Far West à l’âge du désenchantement, le plus triste des livres, plein de bruit et de fureur, qui serait aussi le plus drôle. Car la "vis comica" est essentielle chez Richler, outil de compréhension du monde. Que demander de plus ? La suite. Olivier Mony