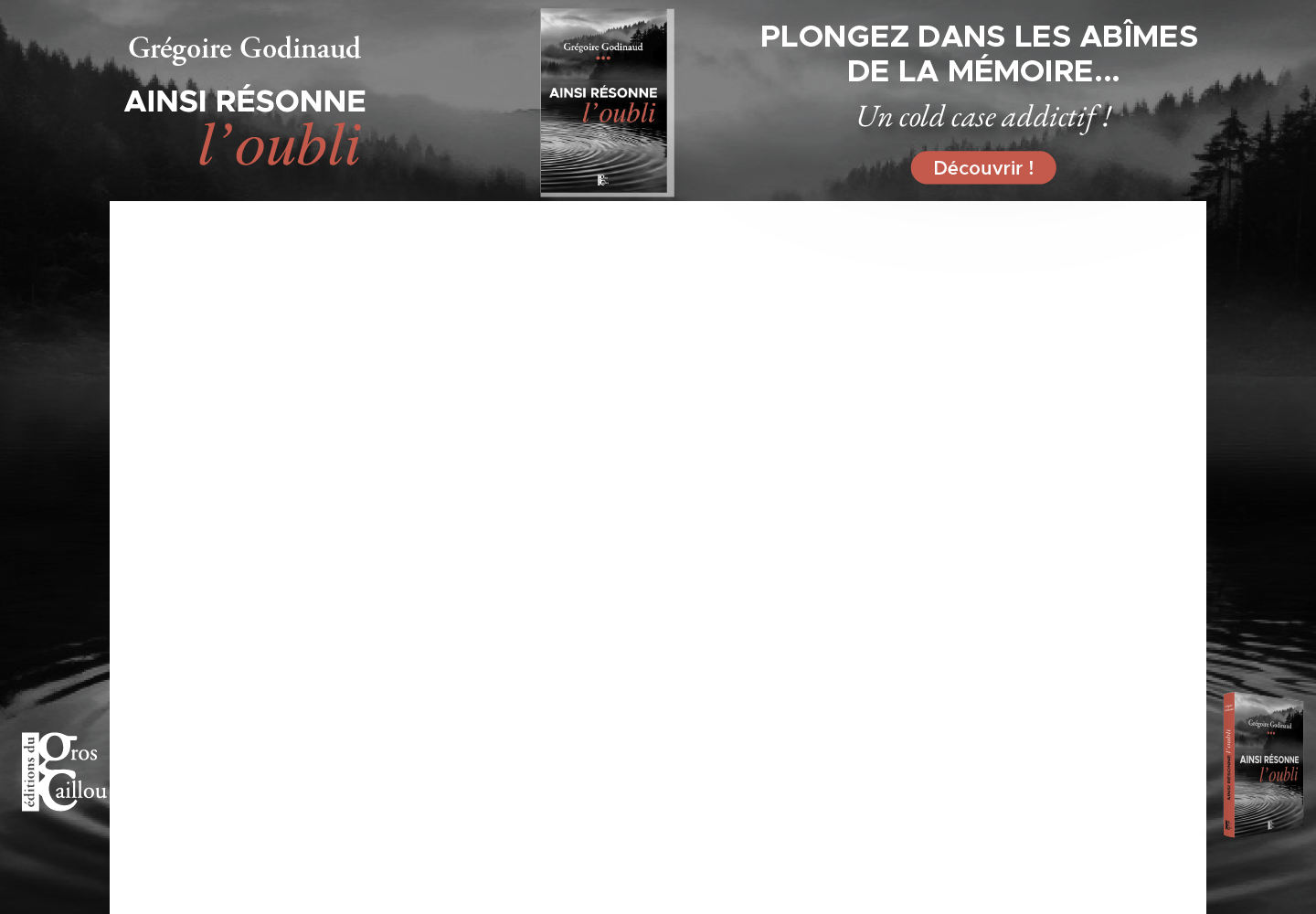Pour présenter Tom Barbash et son recueil de nouvelles, Les lumières de Central Park, son éditeur français, pour changer, en appelle à Raymond Carver, John Cheever, voire Tobias Wolff. Agacé par ce passage désormais obligé vers les vaches sacrées de la nouvelle américaine, l’auteur de ces lignes, lecture faite, doit tout de même reconnaître qu’ici comparaison est raison. Ce n’est pas que Barbash les imite (comme tant d’autres le firent, ces dernières années), ni que les trajectoires de ses héros soient aussi socialement et personnellement erratiques que celles des héros carveriens ou cheeveriens (ou avant cela, fitzgéraldiens, celui de Retour à Babylone, ne l’oublions pas), c’est qu’il est leur frère en empathie et en humanité.
Treize nouvelles, treize histoires de solitude, bien sûr. C’est à New York, Manhattan ; ce pourrait être ailleurs, mais ce serait moins bien. Une mère s’inquiète que son fils ait pour petite amie une serveuse qui n’est pas de son monde. Un homme organise une fête dans son appartement que vient de déserter sa femme. Un prof d’université d’origine indienne voudrait bien que son fils cesse de coucher avec l’une de ses étudiantes. Un homme se souvient de son enfance et de la mort de son frère. Deux promoteurs immobiliers véreux essaient de profiter d’un vieux couple. Un garçon, qui vient de perdre sa mère, s’inquiète de ce que son père devienne un "veuf joyeux"… Chacun n’est que plaies et chagrins, chacun en villégiature à l’auberge des cœurs brisés, chacun fait ce qu’il peut : pas grand-chose.
Tom Barbash mène son affaire avec une fluidité, mais aussi un sens du trait, une vitesse qui laissent peu de doute sur sa virtuosité. Tout ici est joliment lapidaire et évite avec grâce les pièges de la psychologie. Il n’est question que de lien défait, du temps qui passe et de celui qui ne passe pas vraiment, de l’oppression merveilleuse de l’amour. O. M.