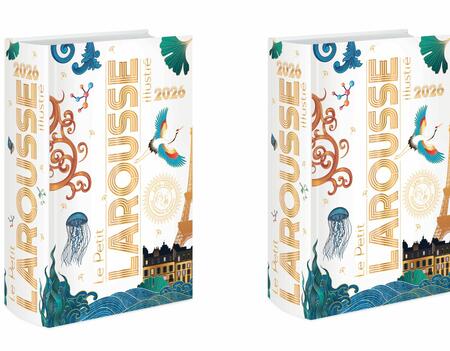Il y a aujourd’hui, dans ce qu’il est peut-être inconvenant d’appeler la littérature de la Shoah, un moment, qui serait celui de l’Histoire, s’il n’était d’abord celui de la troisième génération. Aux fils et filles des filles et des fils de déportés s’impose parfois le devoir de rompre le silence qui fut celui, choisi ou subi, de leurs parents. A ce sujet, Virginie Linhart (La vie après, Seuil, 2012), Colombe Schneck (La réparation, Grasset, 2012) ou bien sûr, Daniel Mendelsohn (Les disparus, Flammarion, 2007) ont écrit leurs plus beaux livres. Il convient désormais d’ajouter à cette liste Séverine Werba. Son premier "roman", Appartenir, s’inscrit pleinement et avec une remarquable élégance, c’est-à-dire en demeurant toujours à la juste distance empathique de son sujet, dans cette quête mémorielle.
A quoi, à qui, appartient-elle, cette Séverine qui au moment de devenir mère s’avise de ne pouvoir différer plus longtemps le rendez-vous que lui a donné son histoire familiale ? Aux fantômes d’un grand appartement au 30, rue de Leningrad. C’était à Paris l’appartement de son grand-père Boris, Babar pour ses petits-enfants, un homme secret, aimant, silencieux. Après sa mort, Séverine, devenue étudiante, reviendra vivre quelque temps rue de Leningrad. Sans s’interroger vraiment sur les âmes errantes qui lui faisaient office de colocataires. Il faudra qu’elle s’apprête à devenir mère, pour comprendre que le passé, celui-là au moins, ne passera jamais. Boris l’amènera à Rosa, à Lena, à tous les autres, aux villages de Pologne, aux rivières d’Ukraine, aux rues de Paris, au yiddish oublié, à ce deuil impossible, à ce monde englouti auquel Séverine Werba reconnaît enfin son appartenance. Son livre est un livret de famille.
Olivier Mony