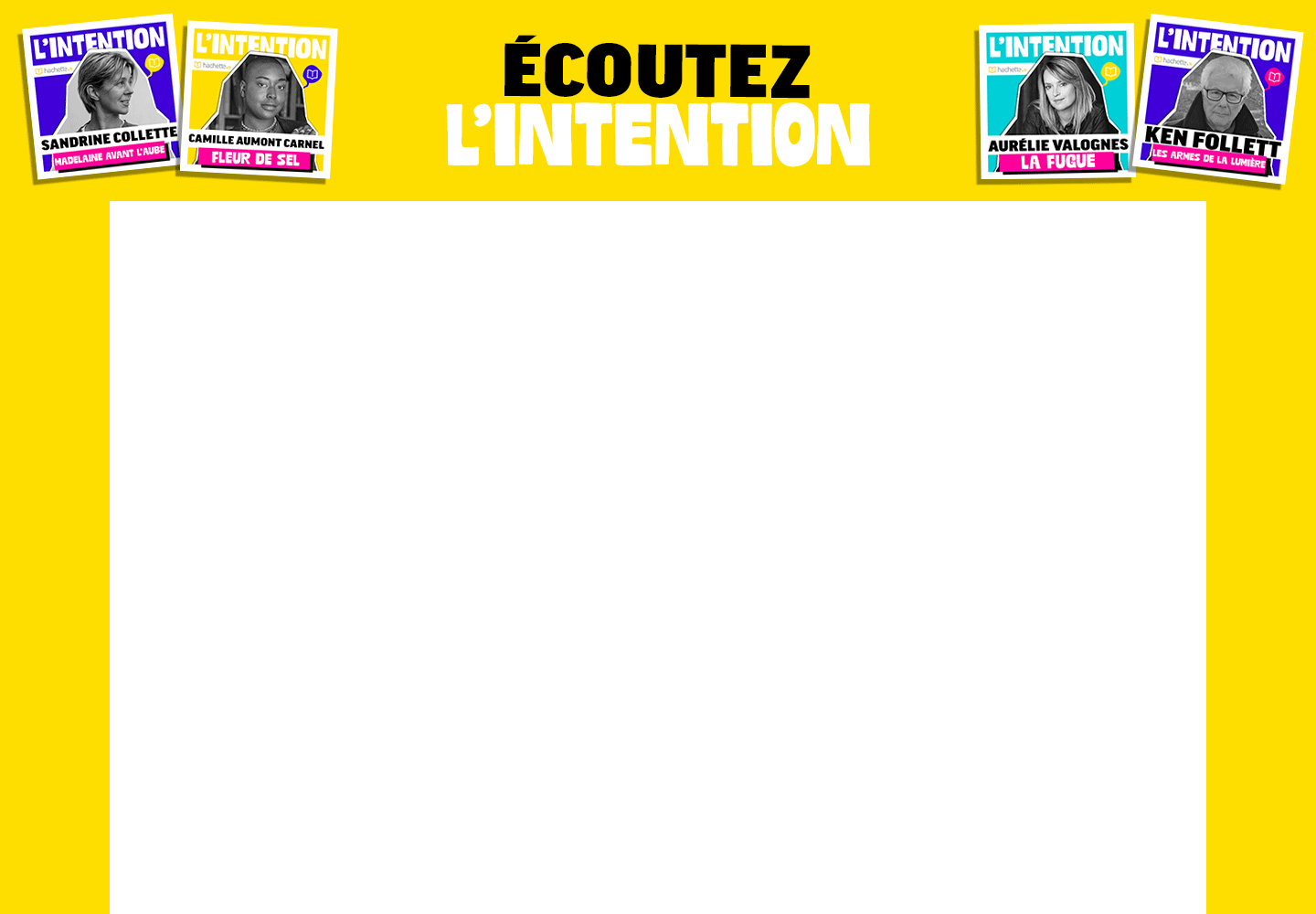Dans un café de Saint-Germain-des-Prés, un matin d'été, Olivier Barrot passe en revue les vingt-sept dernières années. Passionné et pas nostalgique, le présentateur d'« Un livre, un jour » confie avoir eu « une vie active », des voyages au cinéma en passant par le livre. L'émission continuera sans lui puisqu'il vient de quitter l'antenne avec une audience en hausse de 27 % sur une saison (451 000 téléspectateurs en moyenne).
Le 31 juillet, c'était votre dernière présentation d'« Un livre, un jour ». Qu'est-ce que cela représente pour vous ?
Olivier Barrot : C'est pour moi la fin d'un engagement professionnel extrêmement fort, même s'il n'était pas exclusif.
Ce n'était pas votre volonté.
O.B. : On applique la règle qui prévoit à France-Télévisions que les collaborateurs sont obligés de partir à 70 ans. Ils prennent leur retraite. C'est une mesure automatique qui n'appelle aucun commentaire puisque c'est la loi. Ça n'a rien d'une sanction. D'une manière courtoise, ils m'ont annoncé que ça s'arrêtait au bout de vingt-sept ans et 6 000 émissions. Mais si on m'avait proposé de poursuivre, j'aurais continué.
De quoi êtes-vous fier après vingt-sept ans d'antenne ?
O.B. : J'ai la faiblesse de penser que sur les formats courts, on a innové, on a créé quelque chose d'utile, ça a toujours été mon critère. Ce n'est pas une question d'esthétique ou la mise en évidence de la création littéraire, mais la primauté de la lecture qui comptait. Ce n'était pas une émission littéraire, c'était une émission de service sur la production littéraire.
Comment est née l'émission ?
O.B. : Je viens du livre et je finirai dans les pages d'un livre. Quand Jacques Chancel m'a engagé, il m'a dit : « Je me suis renseigné, vous êtes un homme du livre. » Quand il m'a appelé, un vendredi au printemps 1991, après m'avoir repéré comme chroniqueur « voyages » dans l'émission de -Michel Denisot sur Canal+, « Demain », il m'a donné quelques clés. Il voulait une émission littéraire grand public, -ouverte à tous les genres, courte et quotidienne. J'ai trouvé le titre, « Un livre, un jour », et on a commencé en septembre, avec un programme de deux minutes, à une heure de très grande écoute. On était diffusés à 18 h 50, avec des scores d'audience colossaux.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
O. B. : En étant décalé en fin d'après-midi, on a perdu en nombre de téléspectateurs, mais on a touché des publics plus particuliers. Il fallait fédé-rer les seniors sur une chaîne qui est regardée principalement par les sexagénaires et un public plus jeune, avant les jeux populaires. Ce n'est pas la télé-vision qui a changé, c'est le monde. A l'époque, c'était FR3, il y avait les « Jeux de 20 heures », quelques chaînes tout juste nées, le Minitel. C'était une télévision plus proche des origines que celle d'aujourd'hui.
Quelle est la place du livre sur le petit écran ?
O.B. : La télévision n'est objectivement plus le canal privilégié de l'information, de l'éducation et de la distraction, les trois missions d'un média public. Dorénavant, l'immatériel, la numérisation et le temps réel absolu l'emportent. Ce n'est pas étonnant et ça ne me choque pas que la place du livre se soit réduite. Mais reportons-nous vingt ans en arrière. Hormis la position incon-testée de Bernard Pivot, qu'est-ce qu'il y avait de plus ? J'ai fait pour l'Ina une série de rencontres sur les émissions littéraires. Personne ne se souvient de la plupart d'entre elles. C'est injuste mais c'est comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une déperdition dramatique de la présence du livre. En -revanche, un programme ne doit pas être docte et encyclo-pédique, parce que la télévision c'est le plus petit dénominateur commun.
Quel est le secret de votre durée ?
O.B. : J'ai toujours pensé que mon programme devait accessible, intelligible. Le brillant intellectuel, le raffinement, la qualité littéraire, je laisse ça à d'autres. Selon un mot qu'aime à employer notre référence à tous, Bernard Pivot, cette émission est comme le « courrier ». Elle est présente tous les jours, sauf le dimanche ! Une autre raison c'est sa brièveté, qui rend la fréquentation facile. Mais il fallait -aussi la rendre séduisante : le programme -devait décourager le zapping. On a tourné dans trente pays, en extérieur, ce qui n'est plus concevable actuellement. Avec les années, les moyens de production se sont amoindris et sa place dans la grille est devenue moins stratégique.
L'émission a-t-elle été menacée ?
O.B. : C'est une production interne à France-Télévisions ce qui a été un sauf-conduit pour nous. Un seul dirigeant a menacé l'émission, Raymond Vouillamoz, alors directeur des programmes de France 3. C'était à la fin de la première année et il trouvait que cela coûtait cher. Il a fallu que je trouve un sponsor en 1992. Grâce à Marie-Anne Bernard, j'ai rencontré Michel-Edouard Leclerc. Avec Jean-Pierre Elkabbach, les rapports étaient peu aisés. J'avais fait pour Jean-Marie Cavada, sur la Cinquième, une série documentaire avec Jean d'Ormesson, et Elkabbach en a pris ombrage, me demandant de choisir. Finalement, j'ai fait les deux.
Comment avez-vous fait évoluer le concept ?
O.B. : En obtenant 2 minutes 45, je pouvais réaliser des entretiens. On pouvait entrer dans une conversation. Aujour-d'hui, avec le format d'une -minute trente, sans champ-contrechamp, c'est désormais impossible. En 2009, on a créé une hebdomadaire, « Un livre toujours », sans un sou de plus, consacrée au format poche, qui a toujours été pour moi une préoccupation de premier plan. Il y a eu 300 numé-ros abordant tous les classiques de toutes les époques.
Quel est l'avenir du programme ?
O.B. : Il m'a été confirmé que l'émission continuait. Elle prendra un tour sans doute différent.
D'autant que vous l'incarniez.
O.B. : J'ai l'impression d'avoir dit « je » à travers tous les livres et tous les auteurs. Ce n'est pas par narcissisme car je ne suis pas « fana » de ma propre image. Il y a une ligne éditoriale revendiquée qui me ressemble. L'objectivité est un leurre, le journalisme ne saurait être neutre. J'ai l'espérance d'avoir agi avec discernement et avec une certaine équité.
De si belles rencontres
Des invités exceptionnels aux auteurs étrangers qui font l'effort de parler en français, Olivier Barrot ne manque pas de -souvenirs et de belles rencontres. Il en a retenu cinq.
L'écriture ou La vie de Jorge Semprun (Gallimard). A l'époque je suis seul, au Rostand. L'auteur n'est pas là. Je présente ce livre majeur sur la Shoah et le nazisme. C'est un long travelling dans un environnement sombre qui se termine avec un éclair rouge. On voulait une traduction en image qui ne soit pas indigne du livre. Je l'envoie à l'auteur, que je ne connaissais pas. En retour, Semprun m'a confié être ému qu'on ait si bien compris son texte.
J'abandonne de Philippe Claudel (Balland). J'ai été l'un des premiers à le repérer. Le livre a reçu le prix Roman France-Télévisions en 2000. Il débarquait de sa ville de Dombasle en Meurthe-et-Moselle, il avait un look de rocker de mauvais genre, tatoué, avec des boucles d'oreilles. Et il m'a enchanté. Il était tellement différent des gens que je fréquentais. C'était l'anti-6e arrondissement.
Mona Ozouf, un des très grands noms de la littérature contemporaine française. C'est la souveraineté de l'intelligence. Elle a écrit des livres admirables : Composition française, Varennes, Les mots des femmes... J'ose augurer de sa permanence dans l'histoire de la littérature.
Ostinato de Louis-René des Forêts (Mercure de France). J'ai tourné dans un café de Tokyo fréquenté par Chris Marker, un minuscule lieu très coloré dans l'ancien quartier chaud de la ville. Ce n'est pas vraiment un auteur grand public, c'est un poète. C'est un souvenir impérissable.
Et puis il y a la constance de Jean d'Ormesson. Il avait intégré la brièveté, le laconisme, la nécessité d'être compris et de séduire. Sans préparation, il donnait énormément de lui-même à l'intérieur de l'économie de l'émission. Il avait cette générosité. J'ai une vraie gratitude envers lui.