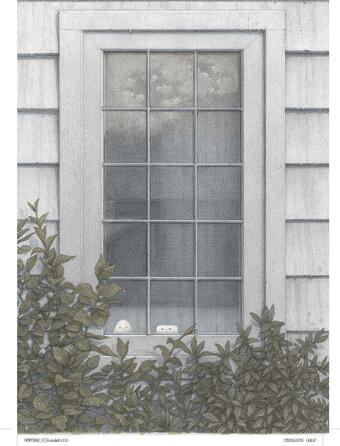De la défaite considérée comme l’un des beaux-arts. En matière de « lose », André Baillon (1875-1932), écrivain belge qui de son vivant déjà s’appliqua à demeurer méconnu, mérite d’être considéré comme un virtuose. Toute sa vie, il perdit tout. Son père lorsqu’il a un mois, sa mère à l’âge de six ans, les femmes qu’il a aimées (souvent des prostituées, ce qui, chacun en conviendra, n’est pas toujours gage de stabilité affective), son travail (il fut tout aussi bien éleveur de poules que rédacteur de nuit pour un quotidien bruxellois), sa fortune, dilapidée au casino d’Ostende, et, pour finir, sa raison lorsqu’il fut interné en hôpital psychiatrique et la vie, à la suite d’une énième tentative de suicide enfin couronnée de succès. La seule chose que Baillon ait jamais su garder, c’est son talent d’écrivain, le regard sarcastique qu’il porte sur sa vie, sur son temps, où le pittoresque n’est jamais rendu à l’état de décor.
Pourtant, malgré l’admiration que lui portèrent nombre de critiques essentiels (au premier rang desquels le regretté Maurice Nadeau), André Baillon demeure largement mésestimé, ou oublié, ce qui est pire. Il faut donc rendre grâce aux éditions Cambourakis d’avoir entrepris de rééditer son œuvre complète, prévue en six volumes. Les deux premiers sont déjà parus en 2009 et 2013. Il faudra désormais à ces remerciements joindre les éditions Finitude, dont on sait le talent en matière d’exhumation de pépites littéraires, qui publient aujourd’hui Le chien-chien à sa mémère, recueil de nouvelles resté ignoré depuis sa première publication en 1929. C’est d’ailleurs moins de nouvelles qu’il faudrait parler que de saynètes, d’une banalité drolatique, comme transfigurées par le regard « en biais » de Baillon. Il y est en effet beaucoup question de petits chiens, d’un chat qui s’appelle Poulet, de pots de fleurs, d’accidents, de messieurs qui lorgnent à la dérobée les courbes des dames. Voyez le genre…
Olivier Mony