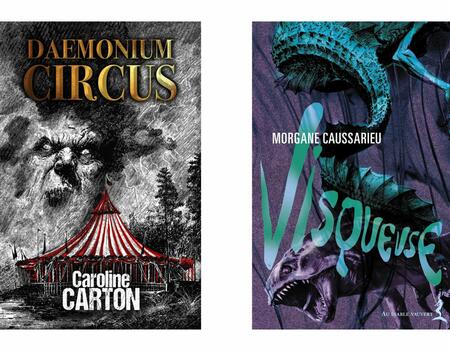Aux États-Unis, c'est une star. Dans sa ville, plus que ça encore, une reine. Personnalité singulière, distante, vacharde, dandy, brillante, érudite et secrète, toujours hilarante et jamais en retard d'un bon mot, Fran Lebowitz règne en effet sur New York depuis plus d'un quart de siècle. Qui est-elle ? Une chroniqueuse lancée dans le grand monde par Andy Warhol et son magazine Interview et qui depuis n'a jamais vraiment quitté le devant de la scène. Fine observatrice des travers de ses contemporains − qui, pour elle, ne peuvent être appelés ainsi que s'ils résident également à Big Apple... − et de leur foire aux vanités, snob et lucide à la fois, icône de la mode (nommée en 2007 par Vanity Fair parmi les femmes les mieux habillées du monde), elle a su imposer dans le pandémonium new-yorkais son personnage, qui tiendrait à la fois de Woody Allen et de Lenny Bruce, sans oublier Oscar Wilde ou Dorothy Parker. Elle fut l'amie de Charlie Mingus. Elle ne fait mystère ni de son homosexualité ni de sa pratique quotidienne de la procrastination... Et consécration suprême, son vieux complice Martin Scorsese lui a consacré une minisérie documentaire tout entière, Si c'était une ville (visible sur Netflix).
En France, Fran Lebowitz reste tout de même assez largement inconnue. Et pour cause, l'œuvre la plus aboutie de cette ordonnatrice des élégances reste sa vie. Peut-être toutefois cela viendra-t-il à changer avec la publication en un seul volume de ses deux livres emblématiques, Metropolitan Life et Social Studies (parus aux États-Unis respectivement en 1978 et 1981), réunis sous le beau titre impérieux et programmatique de Pensez avant de parler. Lisez avant de penser. C'est de fait, quelque chose comme un discours de la méthode. En quelques vastes entrées (« comportements », « sciences », « arts », « lettres », « gens », « choses », « lieux » ou « idées »), Lebowitz, tout en sarcasme et parfois en fantaisie, en liberté en tout cas, s'attaque avec un bel appétit à notre monde, à la façon dont il tourne, dont il ne tourne plus très rond. Toutefois, si le rire le plus libérateur est ici de rigueur, c'est sans doute celui de la politesse du désespoir. L'auteure, si elle s'accommode de son époque, n'en ignore aucunement l'arrière-scène où rôdent les fantômes de la solitude, le diktat de la doxa. Mieux vaut en rire en effet, mais il faut à cela, à cette frivolité assumée, pas mal de courage.