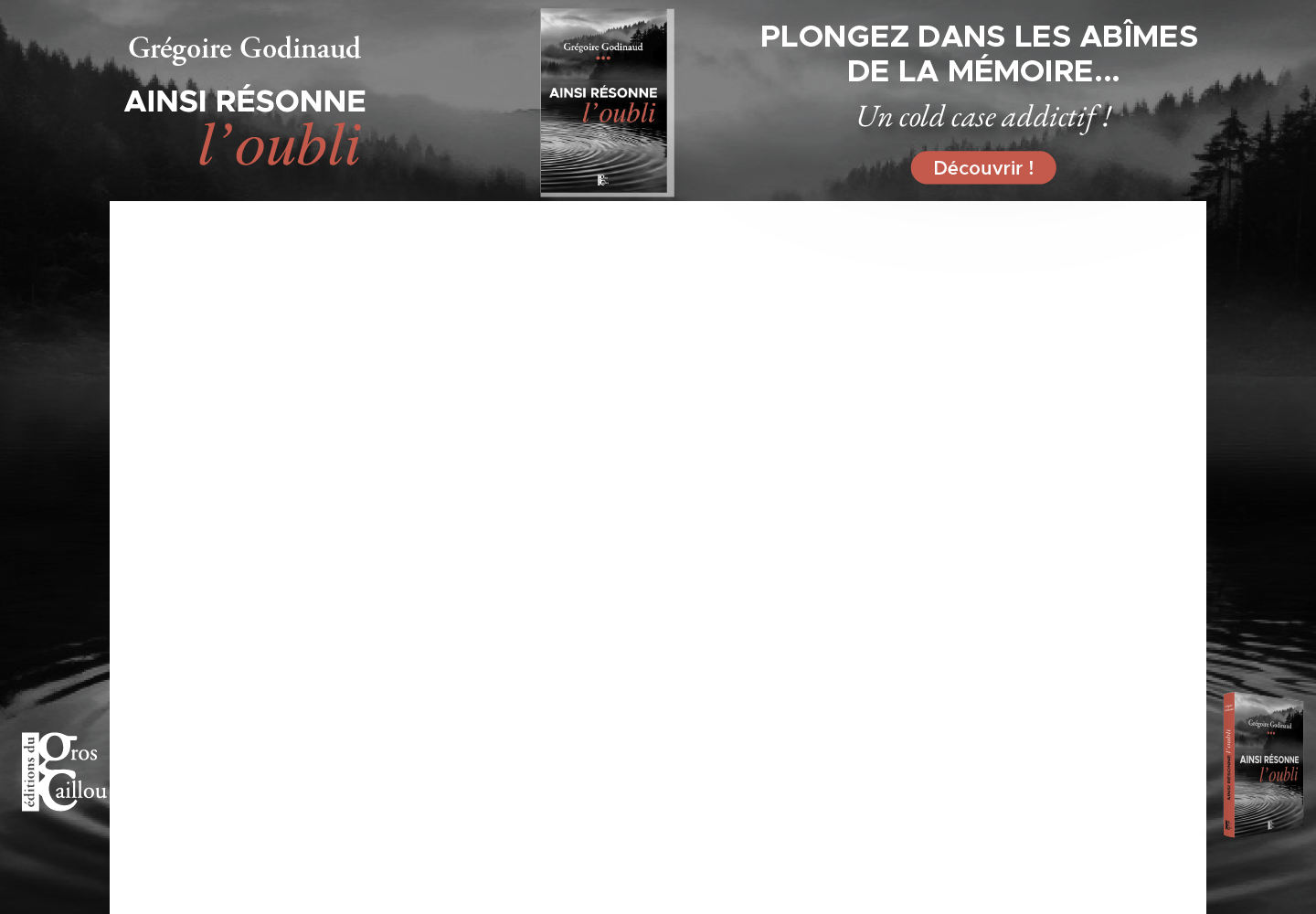Histoire
Auteur du blog

Tous ses billets
Les exaspérations qui se sont cristallisées autour de la figure de Stephen Joyce ont toutefois aussi des racines qui ne lui étaient pas directement liées. En 1991, cinquante ans après la mort de l’écrivain, son œuvre rejoignit le domaine public conformément au droit irlandais. Huit ans plus tard, revers de fortune : l’Irlande est rappelée à l’ordre et doit se mettre en conformité avec la règlementation européenne de 1995, qui porte la durée de protection d’une œuvre à soixante-dix ans après la mort de son auteur, et cela de façon quasi-rétroactive. Pour ceux, nombreux – éditeurs, chercheurs, artistes, musiciens… – qui avaient bénéficié de ces huit années de libéralités du domaine public, ce brusque retournement de situation eut des allures de douche froide. D’autant que chacun s’est rapidement aperçu que la qualité principale de la seule personne désormais habilitée à veiller sur l’héritage patrimonial et moral de l’œuvre de Joyce n’était pas la conciliation.
Myopie
Sur une photographie datant du milieu des années 1930, le petit garçon assis sur les genoux de son grand-père regarde avec perplexité les lunettes de celui-ci en esquissant un geste pour s’en emparer. On lui aurait alors donné le bon Dieu sans confession. Aujourd’hui, à l’âge de soixante-seize ans, c’est lui qui porte des lunettes sur un visage aux traits fins, à l’apparence raisonnable et posée, au regard franc, toutes choses qui donnent le sentiment de se trouver devant un homme calme et sensé. Sentiment trompeur aux yeux de ceux ayant eu affaire au personnage. Ses lunettes contribuent certes à le parer d’un air de respectabilité sérieuse, mais elles ne possèdent pas, au regret de ses détracteurs, la vertu de lui offrir une vue très large, ni très lointaine, encore moins perçante. Au point que beaucoup attendaient avec une fébrile impatience l’année 2012 qui les a libérés du terrifiant droit de regard que se réserve cette joycienne statue du commandeur sur toute chose relative à son grand-père ; car en 2012, les droits de l’œuvre sont entrées dans le domaine public ! Dès lors, l’intransigeant l’héritier ne pourra plus se prévaloir que d’un droit moral, ce qui l’a privé de quelques-unes des armes juridiques grâce auxquelles il a été si puissant.
En 1982, lorsque Lucie, la fille de Joyce décède, Stephen hérite de 50 % de la succession. Onze plus tard, à la disparition de sa belle-mère, Asta, seconde épouse de son père Giorgio, qui lui s’éteignit à Constance en 1976, Stephen contrôle 75 % de l’héritage de son grand-père, ses demi-frère et sœur, Hans Jahnke et Evelyn possédant ensemble le reste. Puis en 2000, Hans lui vend ses parts. Il était donc alors, en droit, la seule personne habilitée à veiller sur l’héritage patrimonial et moral de l’œuvre de son grand-père. Mission dont il s’acquittait avec un zèle que d’aucuns trouvaient excessif.
Les ires de l'héritier
De quelles turpitudes le petit-fils de James Joyce était-il taxé pour susciter pareille antipathie ? Sa connaissance incertaine de l’œuvre de son grand-père serait l’un des premiers griefs dont il était la cible. Personne ne lui en aurait-il voulu s’il était resté sagement dans son coin, à l’écart des débats de spécialistes. Seulement, Stephen James Joyce quittait régulièrement la retraite qu’il s’était ménagée à La Flotte, sur l’île de Ré, pour s’inviter (on l’invitait naguère… moins ensuite) aux colloques plus ou moins savants que des exégètes consacrent au grand écrivain irlandais. En général, ses tonitruantes interventions jetaient un froid bizarre sur l’assistance et faisaient souffler dans l’atmosphère feutrée qui caractérise d’habitude ce genre de symposium comme des tornades surréalistes. D’aucuns l’ont ainsi entendu s’indigner : « Je suis un Joyce, vous n’êtes que des joyciens ! C’est toute la différence ! »
Ce n’est pas la seule saillie publique décochée par le bouillant héritier. Il aurait, en 2003, suggéré à un éminent joycien de l’Université de Western Ontario, Michael Groden, dont il avait obtenu que soit interdite la publication des travaux, d’embrasser la carrière d’éboueur, celle qu’il avait jusque-là consacrée à l’écrivain étant définitivement compromise. Au terme de sept années de travail, le spécialiste souhaitait diffuser en ligne une version électronique d’Ulysse. En échange de l’autorisation, l’héritier exigeait 1,5 millions de dollars. L’universitaire n’est pas parvenu à réunir les fonds. Mais la faute de celui-ci était d’avoir fait l’éloge d’un autre joycien dont le travail sur Ulysse, également considérable, avait l’immense tort d’avoir déplu à Stephen Joyce. Michael Groden a eu sa revanche – petite revanche, selon ses moyens – quelques années plus tard en donnant une conférence à l’Université Cornell où il s’en prenait ouvertement aux méthodes de plus en plus controversées du virulent héritier.
Gardien du temple
Chaque fois qu’un séminaire était organisé autour de son aïeul, il était convié, ou se débrouillait pour l’être. Ses interventions intempestives refroidissaient souvent l’enthousiasme érudit des conférenciers. « Si mon grand-père était là, a-t-il un jour lancé, il serait mort de rire ! » En 1986, à l’occasion d’une rencontre entre éminents joyciens à Copenhague, il a soutenu que Les Gens de Dublin ou Portrait de l’artiste en jeune homme n’avaient nul besoin pour être appréciés par tout le monde de guides universitaires, de théories et d’instructions alambiquées. Même chose pour Ulysse, insistait-il, « à condition de laisser tomber toutes vos exclamations ».
Stephen James ne mâchait pas ses mots. C’est sous doute une qualité pour qui se voit assignée la mission de gardien d’un tel temple. Il aurait pu cependant y mettre davantage de mesure. Or la mesure n’était pas son fort. On a vu qu’il avait ainsi demandé 1,5 millions de dollars à Michael Groden pour le laisser diffuser sa version numérique d’Ulysse. Pour une lecture publique, le tarif était plus raisonnable : 100000 dollars ! L’effet était immédiat, les lectures publiques d’œuvres de Joyce étaient rarissimes… ou presque clandestines. La très scrupuleuse vigilance qu’il exerçait sur l’œuvre de son aïeul avait pourtant un avantage lucratif : elle lui rapportait jusqu’en 2012 près de 400000 dollars par an.
Poux et rats
La mesure ne paraissait pas non plus l’animer beaucoup lorsqu’il déversait sur les malheureux joyciens des tombereaux d’amabilités qui allaient du doucereux médiocre au plus vigoureux parasite, en passant par le nuancé profiteur ou le plus radical « ce sont des poux et des rats [qui] devraient être exterminés ». Mais à sa volonté de mettre des bâtons dans les roues de la communauté joycienne et d’empêcher la réalisation de nombres de travaux universitaires, celle-ci répondait par de rudes lazzis qui avaient fini par lui ôter le peu de crédit que son statut de petit-fils lui avait, par la seule grâce de la Fortune, concédé. Les chercheurs ont pourtant longtemps rivalisé d’efforts pour s’assurer de la bienveillance de l’incontournable trublion, d’autant qu’ils étaient obligation de solliciter son autorisation pour citer des passages conséquents ou reproduire des pages de l’œuvre de Joyce, y compris les plus connues, comme Ulysse ou Finnegans Wake, de même que les plus de trois mille lettres de sa correspondance et les dizaines de fragments des manuscrits inédits. Sans le moindre succès.
Au début, sans doute, certains savants avaient trouvé du charme aux insolences du petit-fils. En 1996, a lieu à Zurich un colloque à l’occasion de la rituelle commémoration du Bloomsday. Celui-ci, célébré pour la première fois le 16 juin 1954 et dont les festivités se sont étendues au monde entier, de Dublin, évidemment, à Venise, Paris, Copenhague, New York et San Francisco en passant par Tokyo, Trieste, Buffalo… fait référence au 16 juin 1904, cette journée à la fois incroyable et banale au sein de laquelle se déroule en près de mille pages la trame monstrueuse d’Ulysse… et qui est aussi le jour où Joyce rencontra celle qui allait devenir sa femme, Nora – la première occurrence étant évidemment une conséquence de la seconde. Au cours de cette journée, qui célèbre les errances mélancoliques, éthyliques, érotiques de Leopold Bloom à travers les rues dublinoises, de bordels en pubs, des extraits de l’œuvre sont déclamés dans les rues, sur des scènes improvisées, les participants se livrent à une gargantuesque orgie.
La disparition de Lucie
Les organisateurs du colloque zurichois transmirent à Stephen une invitation dans laquelle, avec une circonspection toute suisse, ils lui disaient en substance qu’il était le bienvenu si c’était pour échanger dans un franc débat d’idées sur le fond de leurs travaux, auquel cas, ses frais d’inscription seraient pris en charge. Stephen Joyce répondit, amer, qu’il notait une frappante différence de traitement entre les controverses dont il était, lui, à l’origine, et celles qui opposaient les savants entre eux. D’un côté, chacun évoque les dialogue, les échanges de vues, les divergences d’opinions nourrissant la discussion, de l’autre, il s’agit d’ingérences n’ayant plus rien de constructif ou d’enrichissant.
En 1988, nanti à l’époque de la moitié des droits, l’infatigable héritier s’insurge contre une biographie de Brenda Maddox consacrée à Nora, l’épouse de James Joyce. Dans Nora, la vraie vie de Molly Bloom, l’auteur décrit l’intimité familiale de l’écrivain en soulignant l’importance qu’eut sa femme en tant que source inépuisable d’inspiration. Sa muse était peu instruite et, soutient l’auteur, n’a jamais lu Ulysse ; mais, pour son mari, qui vécut dans un presque perpétuel nomadisme, elle incarnait l’Irlande, c’est-à-dire l’essence même de ses livres. Le problème que cette biographie posait à Stephen Joyce était ailleurs. Ce qui le gênait, c’est ce que l’auteur dévoilait de Lucie, la fille du couple en proie à de graves perturbations psychiatriques. Inquiète à la perspective de s’enliser dans une longue bataille juridique et de tomber sous le coup d’une interdiction, et bien que l’ouvrage fût déjà imprimé, Brenda Maddox s’entendit avec l’ayant droit pour supprimer les passages litigieux, à la condition expresse que celui-ci accepte d’ouvrir un certain nombre d’archives. Peu de temps après, prenant la parole dans un colloque qui se tenait à Venise à la faveur du Bloomsday, l’incorrigible petit-fils plastronnait en déclarant qu’il avait détruit une partie de la correspondance de sa tante Lucie, et précisait, sous l’œil incrédule du public, qu’il s’était notamment débarrassé de cartes postales et d’un télégramme que Samuel Beckett avait adressés à la jeune fille à la fin des années 1920.
Mais Stephen ne s’est par arrêté en si bon chemin.
(à suivre)
Auteur du blog

Emmanuel Pierrat
Tous ses billets- Histoire
- Domaine public
- Édition
- Littérature irlandaise
- Polémique
- Héritage littéraire
- Ayant-droits
- Stephen james joyce
- Disparition
Auteurs cités
Articles liés
Les dernières
actualités

Disparition
Décès de Michel Ollendorff, figure du secteur de la librairie
Michel Ollendorff s'est éteint le 29 mars 2025. Acteur majeur de la librairie en France, il était notamment le premier directeur de l'École de la Librairie.
Par Antoine Masset

Radio & Télévision
Dans les médias cette semaine : Marie NDiaye, Ambre Chalumeau, Marion Brunet
Cette semaine dans les médias, Marie NDiaye est l'invitée de Vincent Josse dans Le Grand atelier, Ambre Chalumeau présente son premier roman, Les Vivants (Stock) à Claire Chazal dans l'émission Au bonheur des livres et Marie Labory reçoit Marion Brunet, prix Astrid Lindgren 2025, dans Les midis de culture.
Par Louise Ageorges

Littérature générale
Toujours plus loin de La liste de mes envies, Grégoire Delacourt prolonge sa veine autofictive familiale avec un roman cru et rude. Parution 30 avril
Par Jean-Claude Perrier
Abonnez-vous à Livres Hebdo
- Accès illimité au site
- LH Meilleures Ventes, tous les indicateurs métiers
- LH le Magazine, le mensuel
- LH Spécial, le thématique
- Les bibliographies : Livres du Mois et Livres de la Semaine
Également disponibles sur notre boutique :
Numéros à l'unité, hors-séries, annuaire et planisphère.