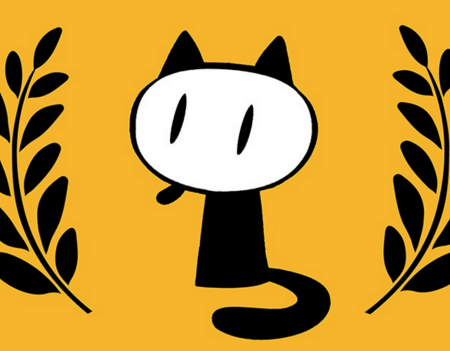Salim Bachi, né Algérien en 1971, est de ces vaillants écrivains du Maghreb qui ont choisi la France et sa langue, et n’hésitent pas, souvent au prix de leur vie, à traiter dans leurs livres de sujets qui fâchent, comme les dérives de l’islam et leur cortège de malheurs : ignorance, obscurantisme, hypocrisie, répression, terrorisme et l’on en passe. D’où des rapports houleux avec leurs compatriotes (surtout les dirigeants), et la censure dont sont victimes certains de leurs ouvrages. Le silence de Mahomet, par exemple, de Salim Bachi (Gallimard, 2008) est interdit dans tout le monde arabe.
Dans son nouveau livre, composite, comme écrit au fil de la plume et souplement chronologique, Salim Bachi évoque quelques souvenirs de son enfance. Tendres, comme ce portrait de son grand-père maternel Djeddi, dit El Gaïd, un dandy, fils d’un riche bourgeois de l’époque coloniale, gros propriétaire terrien. Tous les Arabes, sous la colonisation, n’étaient pas de misérables exploités. Déjà un tabou qui saute. On retiendra aussi ses pages très dures, au début, sur les mauvais traitements qu’il a subis de la part de ses maîtres, lesquels l’ont dégoûté à jamais de l’islam, du Coran, et même de la langue arabe. Au passage, il revient sur certains de ses livres, les explicite, comme Le chien d’Ulysse, son premier roman et le plus connu (Gallimard, 2000). Lui y était Mourad, tandis que son ami Hocine, qui a réellement existé, est mort en 2014. On aime beaucoup, enfin, dans cet ensemble riche et divers, le récit de son voyage en Syrie en 2009 - Damas, Alep, Palmyre, Bosra… Il prend bien sûr, à cause de la guerre, une résonance particulière, colère, souffrance et nostalgie mêlées. J.-C. P.