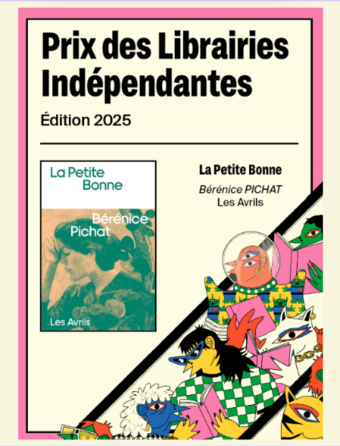On pensait avoir presque tout exploré, tout radiographié, mis en thèses et en synthèses. Eh bien non ! Sur 14-18, il reste encore des sujets originaux. En voici un. La musique est ici étudiée sous deux aspects, celui du texte et celui de la pratique. Anne Simon-Carrère est allée voir ce qui se cachait derrière Bonjour Ninette, Alphonse est dans l’Argonne ou la Poiluse. Ces titres dérisoires racontent à leur façon le front, mais surtout la manière dont il est vécu à l’arrière. C’est une autre forme de violence qui s’exprime, celle des familles détruites, des femmes écrasées par les charges quotidiennes nouvelles et des enfants privés de pères. L’historienne montre aussi que ces textes pas toujours très fins annoncent les bouleversements de la société française : l’émancipation féminine, les orphelins, les mutilés et les morts qui vont prendre une place grandissante sur les monuments comme dans les esprits.
En quatre ans, les complaintes ont changé. Partis en chantant, ceux qui reviennent n’ont que des refrains tristes. La dérision du piou-piou ou du tourlourou ne masque pas tout. Les chansons idiotes tentent de dédramatiser l’horreur des tranchées. On pousse la chansonnette pour ne plus entendre le bruit du canon. Derrière les lignes, on monte des cabarets de fortune pour distraire les soldats. Entre deux couplets, les chanteuses célèbres comme Yvette Guilbert donnent de leur temps aux œuvres et aux organisations de secours.
Sur le front aussi, la musique tente sinon d’adoucir, du moins d’occuper les mœurs. C’est le sens du beau travail d’ethnomusicologie de Claude Ribouillault publié en 1996 et qui reparaît à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre. Cet universitaire passionné, érudit et collectionneur, a recherché tous les documents photographiques, les instruments quelquefois bricolés par les poilus comme le fameux « violon-boîte-à-cigares » et bien sûr les chansons, pas celles composées à l’arrière, mais celles improvisées entre les assauts, dans l’attente d’un destin incertain, voire d’une mort proche où l’on évoque les poux et les rats. Ces détournements de ritournelles et même de Marseillaise s’imposent comme un jeu dans le massacre, comme un contrepoison à la guerre. La musique a remplacé la fleur au fusil. Elle devient un cri, de douleur, d’espoir aussi, une parenthèse entre les souffrances et la mort, un moment où se dit l’intime, lorsqu’on a le moral dans les bandes molletières. On rit, on casse du boche, on rêve d’une grande osmose nationale, de femmes fidèles et infidèles, on se promet des choses, et avant tout d’en revenir. L. L.