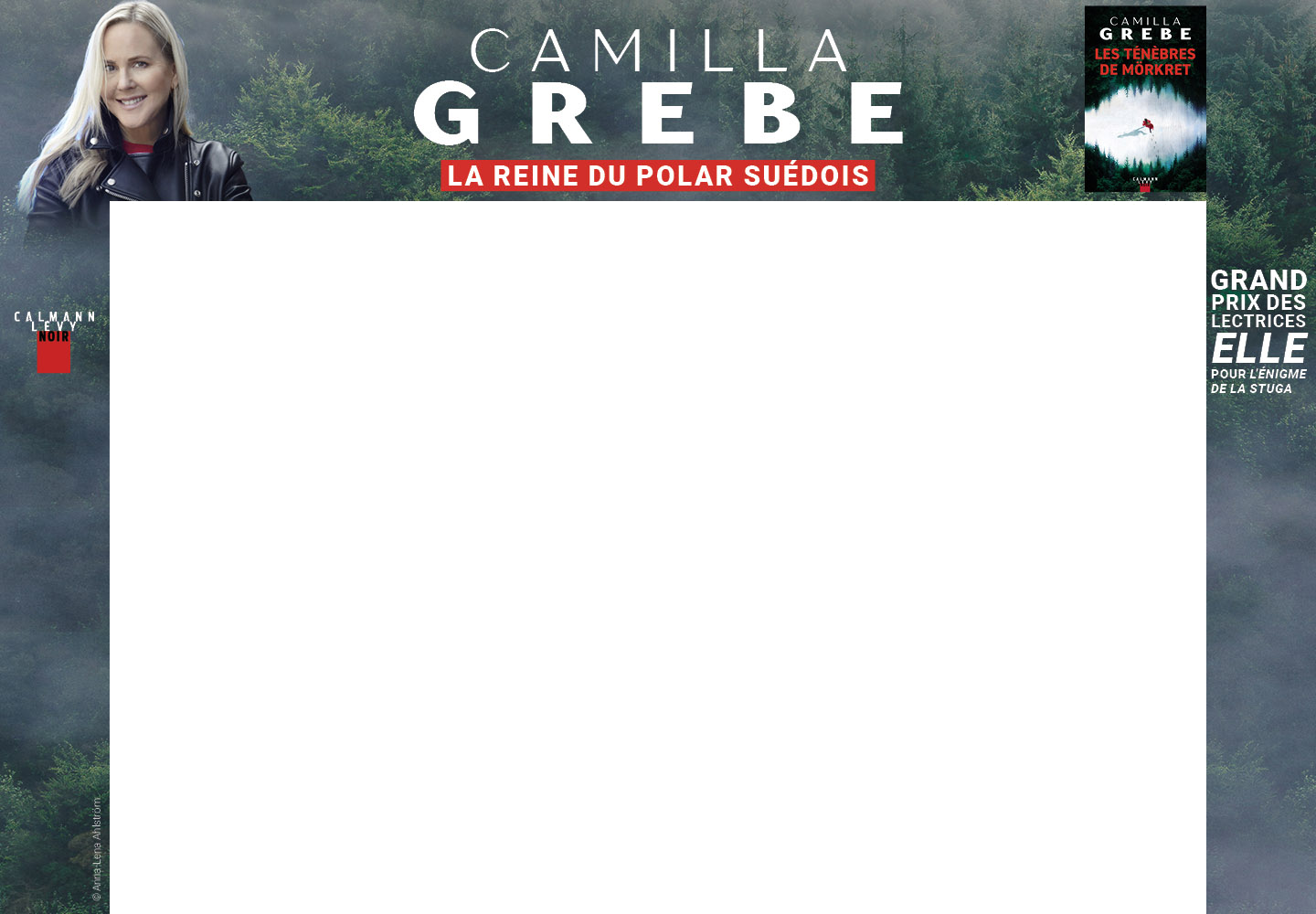Métamorphose métaphorique. L'influence de Kafka reste constante dans la littérature mondiale. Voilà que Mohsin Hamid s'empare à son tour de La métamorphose. L'auteur pakistano- britannique (L'intégriste malgré lui, Exit West), traduit en trente langues, sonde le monde et la nature humaine. À la fois intime et politique, Le dernier homme blanc va un cran plus loin. « En se réveillant un matin, Anders, un homme blanc, découvre que sa peau était devenue d'un brun profond. » Passé le choc et le déni, le protagoniste se demande dans quelle mesure cela peut modifier sa vie. Mais « il voulait croire que, d'une manière ou d'une autre, il reviendrait en arrière ». Constatant que ce n'est pas le cas, Anders est assailli par la peur et le dégoût. Cette transformation n'a rien d'anodin. Il préfère se terrer chez lui, parce qu'il « était essentiel de ne pas être vu comme une menace, car basané comme il était, c'était risqué un jour d'être exterminé », ou de ne plus être respecté par ses proches. Alors qu'Anders est tenté de disparaître chez son père vieillissant, il recontacte néanmoins sa petite amie, Oona. Cette jeune femme lumineuse vient de perdre un être cher. Face à la chair assombrie de son compagnon, elle se montre plutôt « décontenancée par sa vulnérabilité et ses blessures ».
L'amour dépasse-t-il les apparences et les préjugés ou permet-il de mieux révéler l'autre ? Tandis qu'ils se redécouvrent sous un autre jour, la société mute, peu à peu tout le monde change de couleur de peau. Des violences, meurtres, spoliations se produisent, évoquant les pires épisodes de l'Histoire. Un monde sans Blancs serait-il si terrifiant ? « Je pense que la race est une construction imaginaire qui réduit les individus. [...] Qui en bénéficie ? [...] La race est simplificatrice, souvent en termes binaires. Les gens sont trop complexes pour qu'un tel algorithme puisse faire autre chose que du mal », souligne Mohsin Hamid dans un entretien au New Yorker. Au-delà de ces thèmes, il nous offre de beaux portraits d'êtres confrontés au deuil - y compris d'une part d'eux-mêmes -, à la puissance de l'amour et de l'espoir. Philosophe, Oona « pourrait perdre sa peau comme un serpent perd la sienne, sans violence, et, ainsi libérée, recommencer à grandir ».