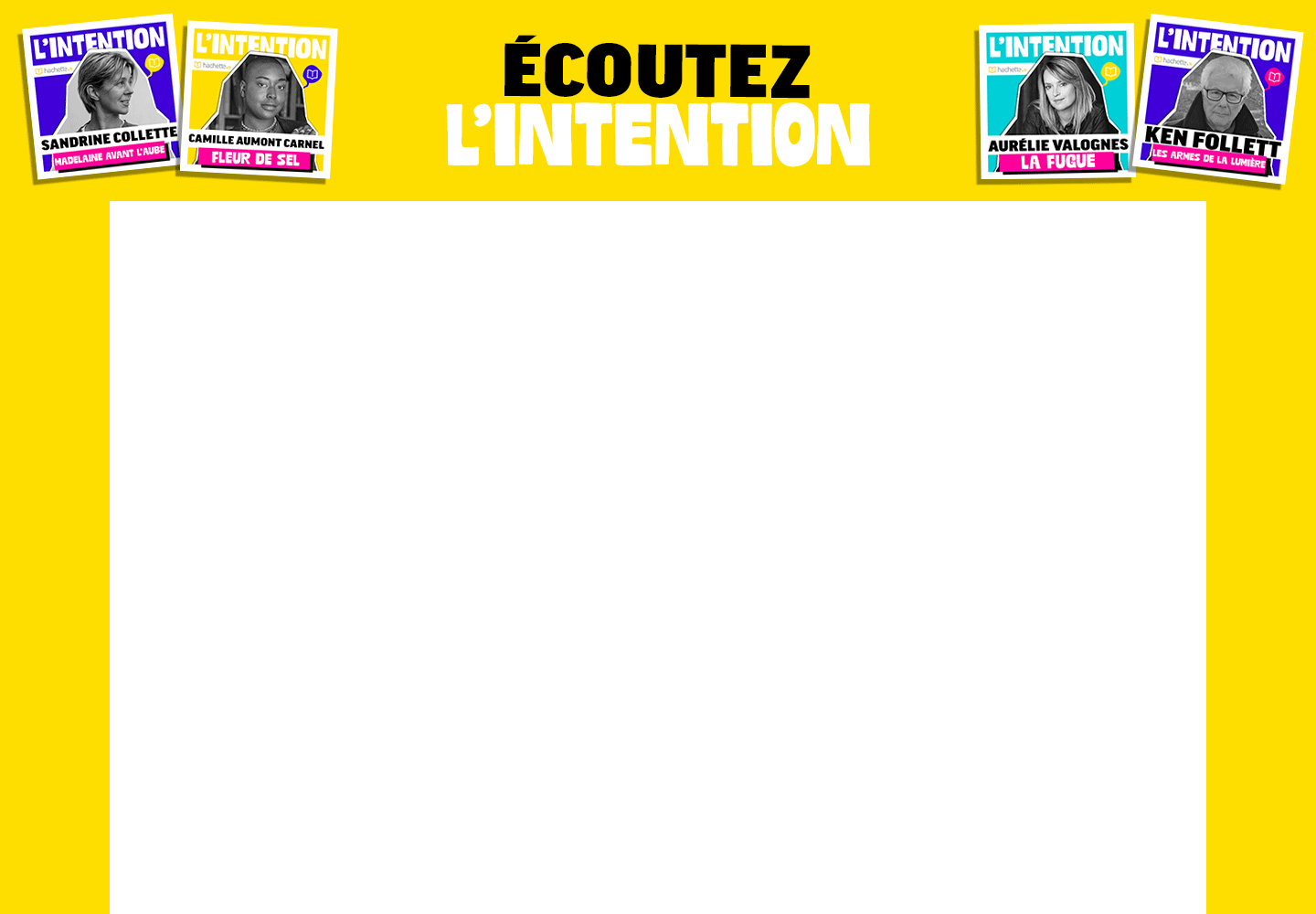Dans son nouveau roman, Délivrances, à paraître le 20 août chez Christian Bourgois, après un lancement le 21 avril aux Etats-Unis sous le titre God help the child ("Que Dieu aide l’enfant"), Toni Morrison aborde de front la question de la couleur de peau. A 85 ans, la grande écrivaine américaine, prix Nobel de littérature 1993, s’intéresse à une jeune femme rejetée par sa propre mère en raison de sa trop grande noirceur, mais qui va faire de ce "handicap" un atout en menant une brillante carrière dans l’univers de la beauté et des cosmétiques. Toni Morrison a reçu Livres Hebdo le 28 mai dans son appartement de Tribeca, à New York.
J’ai commencé à y travailler bien avant d’écrire le précédent, Home (Christian Bourgois, 2012). Je voulais faire un livre contemporain sur les fardeaux de l’enfance, comment ils peuvent nous paralyser, nous corrompre au point que l’on ne pense plus qu’à soi. Mais, vers 2007-2008, j’ai eu du mal à trouver un point de départ. Il se passait tant de choses ! Je voulais aborder le thème de la beauté, son pouvoir de séduction, quand on dépasse sa couleur de peau et que l’on se sent enfin beau. Comment la beauté peut vous protéger, vous rendre digne d’amour. Et ce qui survient quand elle échoue, comment on s’en sort quand on est rendu à sa complexité.
Il y avait autrefois des "privilèges de peau" pour les personnes métisses, à peaux plus claires, comme une hiérarchie à l’intérieur de la race. Je l’ai découvert en entrant à l’université Howard, un très bon établissement pour étudiants noirs, où j’ai soudain remarqué des particularités de langage, des préférences. J’ai trouvé cela étrange. Dans mon roman, je me suis dit que la répulsion de la mère pour sa fille serait un fardeau suffisamment lourd pour que cette dernière commette quelque chose de terrible afin de gagner sa confiance, son affection.
Pour Bride, oui, mais pas pour son fiancé, dont le traumatisme n’est pas lié à la race. Booker est un étudiant de troisième cycle, intellectuel, ouvert d’esprit. Cependant, le mensonge et leurs traumatismes les séparent jusqu’à ce que chacun fasse deux choses : dire la vérité et, surtout, s’occuper d’un autre que de lui-même. Dès lors, ils sont armés et ils peuvent faire ce que j’aime montrer dans mes livres : évoluer vers l’acquisition d’un savoir, une perception très profonde de soi et de l’autre, et même une sorte de douceur.
Je ne veux pas être dans la position de l’auteur omniscient, ni me sentir obligée de recourir aux dialogues pour rendre des manières de parler distinctes. Je préfère, de temps à autre, faire entendre directement la voix des personnages. C’est plus intime. De la petite fille, Rain, je ne savais quasiment rien au départ. Mais lorsqu’elle s’est mise à parler, elle est devenue vivante.
Oui, même si ce rapport est rendu plus dramatique par la différence de couleur. Les rapports parents-enfants ont beaucoup changé. Autrefois, les enfants jouaient dehors toute la journée, ne rentrant que pour dîner. Personne ne s’inquiétait, les voisins intervenaient en cas de problème. Maintenant ce n’est plus possible. Aux Etats-Unis, deux femmes ont été arrêtées récemment pour avoir laissé leur enfant d’une dizaine d’années se rendre seul au parc. Aujourd’hui, c’est le règne des "parents hélicoptères", qui survolent leurs enfants en permanence. C’est inquiétant et cela produit des enfants inquiets. La culture de ce pays semble très ouverte, par exemple avec les nouvelles lois sur le mariage gay, mais elle est complètement morcelée.
Elles prennent d’autres formes. Quelqu’un me rappelait récemment la différence entre mon premier roman, L’œil le plus bleu, qui date de 1970 (Christian Bourgois, 1994), où une petite fille est complètement détruite par l’idée qu’elle n’a aucune valeur, qu’elle est laide, parce que le monde l’a décrété, et le dernier. Dans Délivrances, une enfant noire est rejetée à cause de sa couleur. Mais, dans notre monde contemporain, elle parvient à utiliser cela à son avantage pour parvenir au succès. Les lois ont changé, le racisme n’est plus acceptable. Mon père, qui est mort à la fin des années 1960, a vu, petit, deux hommes noirs se faire lyncher dans sa rue. C’était sa génération. Aujourd’hui, j’observe une réelle diversité à la télévision, dans les films, les publicités. Avant, on disait : "Tiens, un Noir !" Maintenant, tout cela est acquis. Et il y a de très bonnes actrices, comme l’extraordinaire Lupita Nyong’o, qui joue dans 12 years a slave. Mais certains s’accrochent à la ségrégation parce qu’ils n’ont rien d’autre dans leur vie pour les faire se sentir mieux. Perdre leur supériorité, leurs privilèges de Blancs serait dévastateur pour eux.
Le point positif, c’est qu’on ne peut plus garder le silence sur de tels événements, qui, dans le passé, n’auraient jamais intéressé les médias. Mais ces derniers se focalisent sur les déprédations, parce qu’ils sont bien plus intéressés par la propriété privée que par les personnes. Une pierre jetée dans une vitre interpelle davantage que les violences faites à la victime. A Cleveland, un policier blanc a tiré 49 fois sur un couple de Noirs qui ne le menaçaient pas, qui n’étaient même pas armés. Il a déclaré qu’il avait eu peur. Peut-on imaginer un soldat dire cela ? "Je ne vais pas de l’autre côté de la colline parce qu’on pourrait me tirer dessus. J’ai peur, les Noirs me font peur !"
Non. Je le trouve formidable. Vraiment. Mais quand vous avez un parti d’opposition aussi extrême, capable d’agir comme il le fait, de faire sans cesse obstruction au gouvernement…
(Rires.) J’aime Hillary, je la soutiens. Cela dit, à l’époque, j’ai choisi de ne me laisser guider ni par la couleur de peau, ni par le genre, mais par le meilleur programme. Obama était contre la guerre, pas Hillary, qui soutenait les bombardements en Irak. Obama a aussi défendu d’autres idées que j’approuve. Mon choix était vraiment politique. En fin de compte, je trouve qu’il s’est montré bien supérieur à ce que l’on pouvait attendre de lui. Vous savez, ici, c’est un pays totalement capitaliste. Vous avez des prisons privées, vous, en France ?
C’est libérateur pour moi. Cela m’ouvre l’horizon, d’autant que c’est la culture que je comprends le mieux. Mon intérêt pour les Africains-Américains est très profond et embrasse beaucoup de sujets, car ils sont emblématiques de l’histoire de ce pays. Et puis il faut sortir de ce que j’appelle le "regard blanc". Certains auteurs noirs écrivent pour des lecteurs blancs. Ce n’est pas mal en soi, mais ce qu’ils font, c’est définir, expliquer, défendre… Ils ont parfois produit de grands livres, mais je me suis toujours demandé ce qui se passerait si on supprimait ce regard blanc.
Non. C’est comme l’enseignement, cela n’a rien à voir avec l’écriture. En tant qu’éditrice, j’avais beaucoup de distance, je faisais simplement en sorte que cela fonctionne pour l’auteur, quel qu’il soit.
C’est surtout qu’elle ne semble pas très attractive aux jeunes Noirs ! Lorsque j’ai été embauchée, dans les années 1970, il y avait beaucoup de personnalités qui écrivaient leur autobiographie ou d’écrivains noirs. J’ai publié Mohamed Ali, Angela Davis, et de la très bonne littérature, même si elle n’a pas aussi bien marché commercialement. J’étais très fière de mon catalogue. Mais j’étais moi-même plus intéressée par l’écriture. J’avais besoin d’un travail qui me permette de m’y consacrer, et je suis donc passée à l’enseignement, d’abord à la State University of New York, puis pendant vingt ans à Princeton.
Elle souffre de la compétition créée par Amazon, du livre numérique. Les librairies ferment, seules les plus grosses demeurent. Mais à New York, il y a quand même de très petites librairies intéressantes, comme des brins d’herbe qui survivent à la tempête, où l’on connaît les clients par leurs noms, leurs goûts. L’état des bibliothèques me préoccupe davantage. Dans les villages, on ne peut plus se procurer de livres. Et moi qui les reçois en double !
Oui, mais pas d’écrivains. Autrefois, les Noirs n’écrivaient pas, car ils avaient la musique. Puis elle n’a plus suffi, et les livres sont devenus nécessaires. Aujourd’hui, ils ont un nouveau style de musique. On m’a raconté qu’un rappeur avait intégré une citation de L’œil le plus bleu dans un morceau. Il y a également beaucoup de peintres, de danseurs, qui font des performances incroyables ici, à New York, à l’Armory. Ces jeunes qui font du flex, une danse de rue, parviennent à construire un récit formidable sans aucun mot, juste avec la danse. Alors qu’en littérature, les auteurs que je connais ont une dizaine d’années de moins que moi, ils vieillissent. La culture évolue dans une nouvelle direction pour dire le monde.
Belle comme la nuit
20 août > Roman Etats-Unis
Situé dans les Etats-Unis d’aujourd’hui, le onzième roman de Toni Morrison condense tous les thèmes qui lui sont chers : racisme et enfance abusée, culpabilité et rédemption.

Née dans les années 1990, Lula Ann Bridewell se fait désormais appeler Bride. L’héroïne du onzième roman de Toni Morrison est une spectaculaire jeune femme noire de 23 ans aux cheveux bouclés, entièrement habillée de blanc, qui conduit une Jaguar gris souris intérieur cuir, avec plaque d’immatriculation personnalisée. Mais Bride est aussi la fille unique d’une mulâtre à la peau claire, la mal-nommée Sweetness (Douceur), qui a traité cette enfant dont elle trouvait la peau trop sombre comme une étrangère. "Pire que ça : une ennemie", reconnaît la génitrice dans les confessions qui ouvrent le premier chapitre.
Bride croyait avoir pris sa revanche - elle est la directrice régionale d’une petite entreprise de cosmétiques, sur le point de lancer sa propre ligne, TOI, MA BELLE -, mais tout s’enraye quand Sofia, une ancienne institutrice blanche condamnée à tort à la suite de son faux témoignage, est libérée après quinze ans de prison, et que son compagnon, le secret Booker, la quitte subitement avec pour seule explication : "T’es pas la femme que je veux." Bride se sent redevenir la fillette en mal de mère qu’elle était, "une petite Noire effarouchée". Sa féminité d’adulte s’efface peu à peu, poils pubiens, règles et seins disparaissent, une phase régressive que Toni Morrison traite, selon son habitude, comme un phénomène fantastique inséré dans un réalisme cru. C’est le moment de la fin des mensonges et des remords tus, le moment de l’accomplissement des promesses faites à soi-même, celui qui précède les possibles rédemptions.
Dans Délivrances, si le racisme n’a pas la même forme que celui de la fin du XIXe siècle (comme dans Beloved) ou des années 1950 (Home), il sévit toujours. De même que les abus sur les enfants : le frère aîné de Booker a été assassiné par un pédophile ; Rain, une fillette dont Bride fait la connaissance, a été jetée à la rue par sa mère qui la prostituait.
Depuis Un don (2009), Toni Morrison a raccourci ses histoires, concentrant un peu plus la violence, et la violence physique en particulier, laquelle a toujours tendu ses livres. Chez la romancière afro-américaine, de même que l’asservissement naît de la couleur de la peau, la délivrance passe par le corps. Un enfantement dans la douleur mais aussi porté vers l’espérance.
Véronique Rossignol