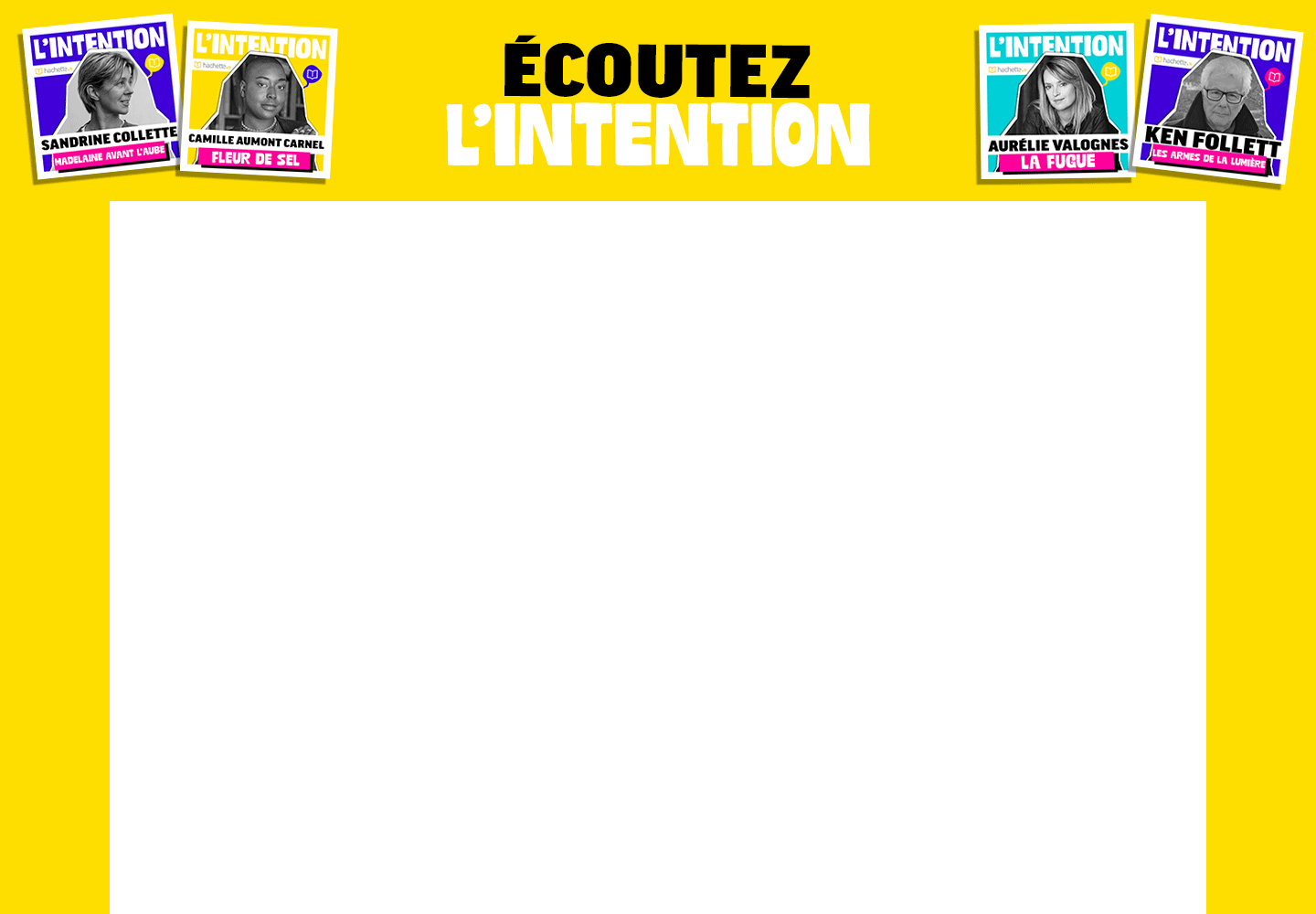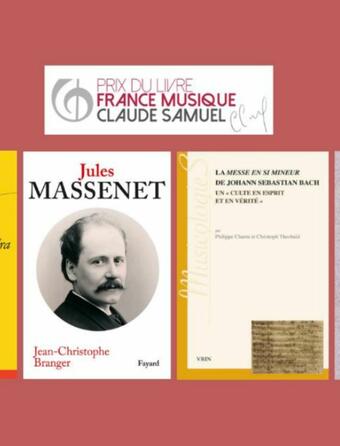Aujourd’hui, sa mère est morte. Et avec elle, sans doute, le peu qui permettait à Moïse d’échapper encore à l’intranquillité de vivre. Moïse venu de Paris pour porter sa mère en terre, mais aussi peut-être, et sans se l’avouer vraiment, pour mettre le plus de distance possible entre sa femme et son fils, et lui. Moïse dont la fatigue, la tristesse et l’absence de désir vrai participent de l’élégance, de la fascination qu’il suscite chez ceux, et surtout celles, qui croisent son chemin. Moïse qui peut-être n’aurait pas dû prendre ce dernier verre dans ce night-club d’Ashkelon, ni poser son regard sur cette fille perdue sur la piste de danse, ni laisser ce serveur lui verser un autre Campari. Elle, c’est Esther. Esther Weiss, hier encore écolière, demain prête à intégrer Tsahal, pour l’heure apprentie secrétaire, inconsciente de sa beauté, mais rêvant vaguement d’un destin qui l’aiderait à fuir ses parents, humbles poissonniers, rescapés de la Shoah. Le troisième larron, le serveur, c’est Alex. Alejandro comme on l’appelait dans son Buenos Aires natal, en rupture de ban avec son pays et son père psychanalyste. Alex, dont le mutisme apparaît comme une menace sans que l’on puisse déterminer si celle-ci s’adresse à autrui ou à lui-même… Ces trois-là, petits personnages perdus dans un rêve plus grand qu’eux, n’auraient jamais dû se rencontrer, s’il n’y avait la mer, s’il n’y avait le ciel…
Moïse, Esther et Alex, comment ils s’aimèrent, le temps d’un été en ces années 1960 qui ont tout de même une gueule de promesse, comment ils se font du bien et du mal à la fois, semblent sortir d’un roman de Duras. Ils sont les héros d’Amour sur le rivage, le deuxième roman traduit en français de Michal Govrin, après Sur le vif (Sabine Wespieser, 2008). Fille d’un des fondateurs de l’Etat d’Israël, débarquée à Paris en 1972 pour y suivre un doctorat de théâtre, très amicalement liée durant de nombreuses années à Jacques Derrida, vivant aujourd’hui à Jérusalem et enseignant à l’université de Tel Aviv, Michal Govrin est l’une des plus fortes personnalités de la scène littéraire et publique d’Israël. Or, et c’est son prodige paradoxal, ce roman prend le bruit et la fureur du monde et nous le rend en sonate, en petite fugue pour mal partis exilés au soleil… Cette musique-là est celle de la littérature. Olivier Mony