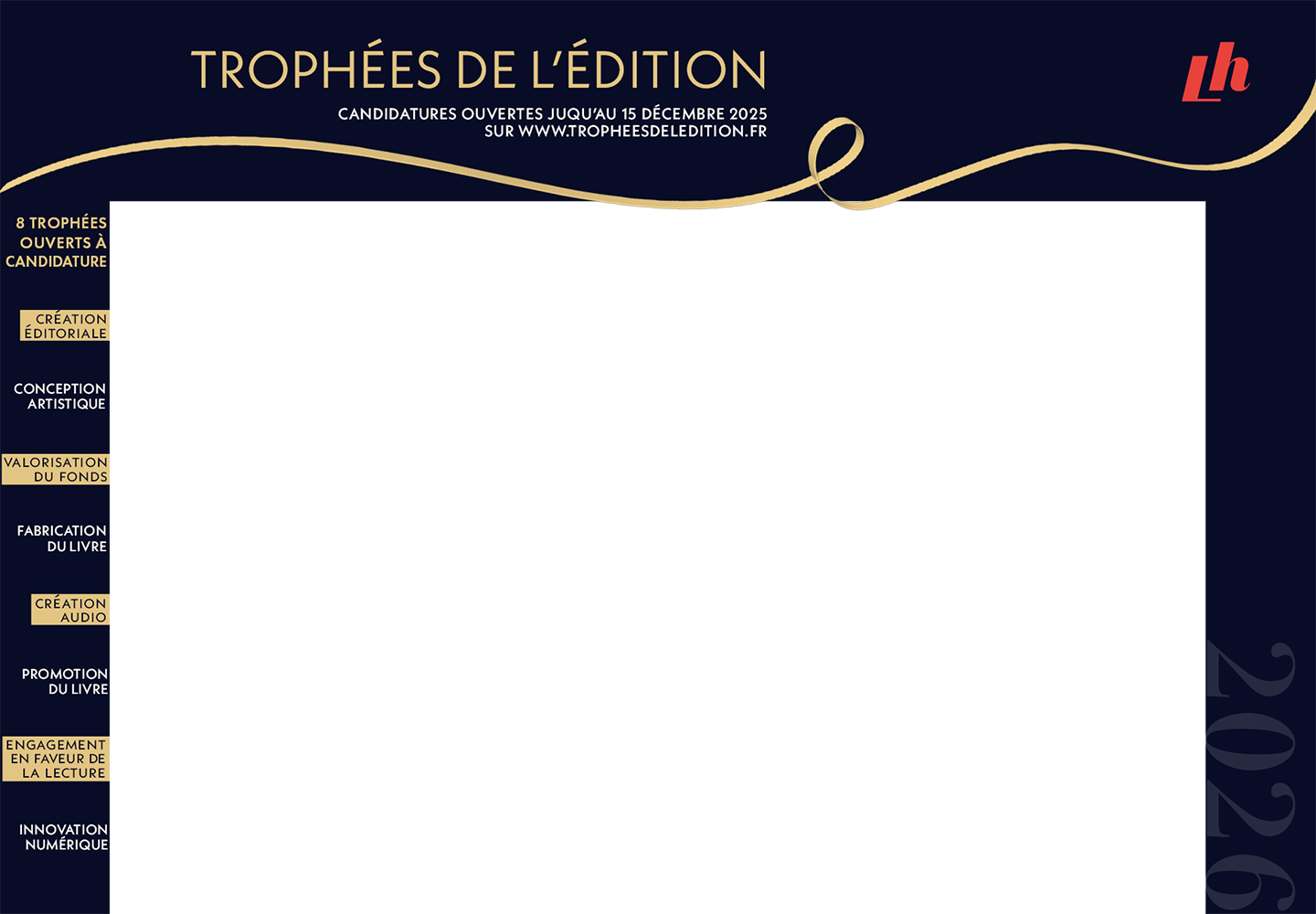Inscrite aux barreaux de Paris et du Québec, l’avocate Caroline Mécary s'est spécialisée en droit de la famille et a développé une expertise sur des sujets tels que l'adoption de l'enfant par le concubin, l'homoparentalité, la transcription des actes d'état civil des enfants nés dans le cadre de conventions de gestation pour autrui, ou encore l'exéquatur de jugements d'adoption. À ce titre, elle est l'autrice de plusieurs ouvrages qu'elle a publiés seule (La GPA. Données et plaidoyers chez Dalloz ; PMA et GPA. Des clés pour comprendre chez Que Sais-je ?) ou en collaboration avec un ou plusieurs auteurs, contribuant également à des ouvrages collectifs.
En février 2014, elle a fait la connaissance de la philosophe et psychanalyste Sabine Prokhoris dans le cadre de la préparation par cette dernière d'un livre intitulé L'insaisissable histoire de la psychanalyse. Ayant noué des relations d'amitié, elles ont alors évoqué la possibilité d'écrire ensemble un ouvrage sous la forme de dialogues entre la psychanalyste et l'avocate autour de décisions judiciaires portant sur l'homoparentalité, la filiation des enfants nés de conventions de gestation pour autrui ou encore le transsexualisme.
Le mariage
Après plusieurs mois d'échanges et d'écriture, elles ont, le 19 janvier 2018, chacune signé un contrat d'édition avec « la société française Humensis, née de la fusion des sociétés Presse Universitaires de France et Belin ». Ce contrat prévoyait la production d'une oeuvre de collaboration intitulée N'est pas Salomon qui veut ! Les juges et les nouvelles familles, consistant en une confrontation juridique et psychanalytique des décisions judiciaires en droit de la famille. Le contrat prévoyait une restitution du manuscrit pour le 10 mars 2018. Cependant, le 27 février 2018, la philosophe indiquait à l’avocate se retirer de leur projet commun et lui a annoncé son intention de publier un ouvrage sous son seul nom.
Le même jour, l’avocate en a informé la société Humensis qui a procédé à l'annulation du contrat d'édition la concernant. Entre temps, l’avocate mettait aussi en demeure la philosophe, par lettre recommandée du 6 mars 2018, de ne pas utiliser dans son livre les décisions qu'elle avait communiquées et commentées. Le 20 mai 2018, la société Humensis concluait avec la philosophe un nouveau contrat d'édition portant sur la publication d'un ouvrage intitulé Déraison des raisons, Les juges face aux nouvelles familles. Ce livre a été publié le 29 août 2018 aux Presse Universitaires de France.
Le divorce
Finalement, début janvier 2019, après vaine réclamation, l’avocate a assigné la philosophe devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture de leurs relations. Plusieurs questions juridiques se sont alors posées, notamment l’existence et la violation d’un contrat tacite de collaboration, la qualification de parasitisme économique liée à l’usage d’éléments issus du projet commun et les atteintes à la réputation.
Ainsi, l’avocate invoquait l'existence d'un contrat tacite, établi par les courriels échangés entre les parties. Ces messages auraient défini les contributions respectives et fixé des objectifs. Elle reprochait à la philosophe d’avoir rompu brutalement leur collaboration sans respecter son obligation de loyauté, ce qui aurait causé la caducité du contrat d’édition conclu avec la maison d’édition Humensis. Elle l’accusait également d’avoir utilisé son travail (commentaires juridiques et sélection de décisions) dans le livre publié sous son seul nom. De son côté, la philosophe contestait l’existence de tout contrat. Elle soutenait que les échanges n’avaient abouti qu’à des propositions, sans accord définitif ni organisation claire. Elle mettait aussi en avant des désaccords sur la répartition du travail, empêchant la concrétisation d’un véritable partenariat.
Sur cette question, la Cour rappelle (Arrêt n°23/01814 de la Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2024) qu’un contrat nécessitait un accord de volontés et constatait que les pièces produites démontraient uniquement une intention de collaboration, sans organisation formelle ni obligations réciproques clairement définies.
Alors que sur la question du parasitisme, l’autrice avocate arguait que l’autrice philosophe avait tiré indûment profit de ses apports intellectuels, notamment en exploitant les décisions de justice qu’elle lui avait communiquées. Elle soutenait également que cette appropriation avait restreint ses perspectives de notoriété et d’exploitation de son propre travail. Ce à quoi, la philosophe répondait que les décisions de justice étaient des documents publics et ne pouvaient faire l’objet d’une appropriation exclusive. Elle affirmait enfin que son ouvrage reposait sur des analyses indépendantes et que les similitudes relevées concernaient uniquement des éléments factuels. Sur cette question, la Cour répondait que le parasitisme, au sens de l'article 1240 du Code civil, supposait l’exploitation déloyale du savoir-faire ou des investissements d’autrui. En l’espèce, elle estimait qu’il n’y avait pas de captation déloyale ; les décisions de justice utilisées étant accessibles au public et ne présentant pas de valeur économique individualisée.
Enfin, la dernière question portait sur l’atteinte à la réputation que soutenait la philosophe en se plaignant des courriers de dénonciation envoyés par l’avocate à des tiers, ce qui aurait porté atteinte à sa réputation professionnelle. Ce à quoi cette dernière répondait que ses démarches étaient justifiées par la nécessité de défendre ses droits et niait toute intention diffamatoire. La Cour rejetait cette demande en estimant qu’un préjudice direct résultant des courriers en question n’était pas prouvé. Éconduisant ainsi les deux.
Peut-on résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eus tout seul ?
Au-delà de ces circonstances particulières, cette affaire rappelle l’importance de formaliser clairement les collaborations intellectuelles, notamment par un contrat écrit commun. Par ailleurs, elle rappelle le caractère public et non appropriable des décisions de justice en matière de parasitisme économique. Et, plus largement, de toute chose ayant un caractère public.