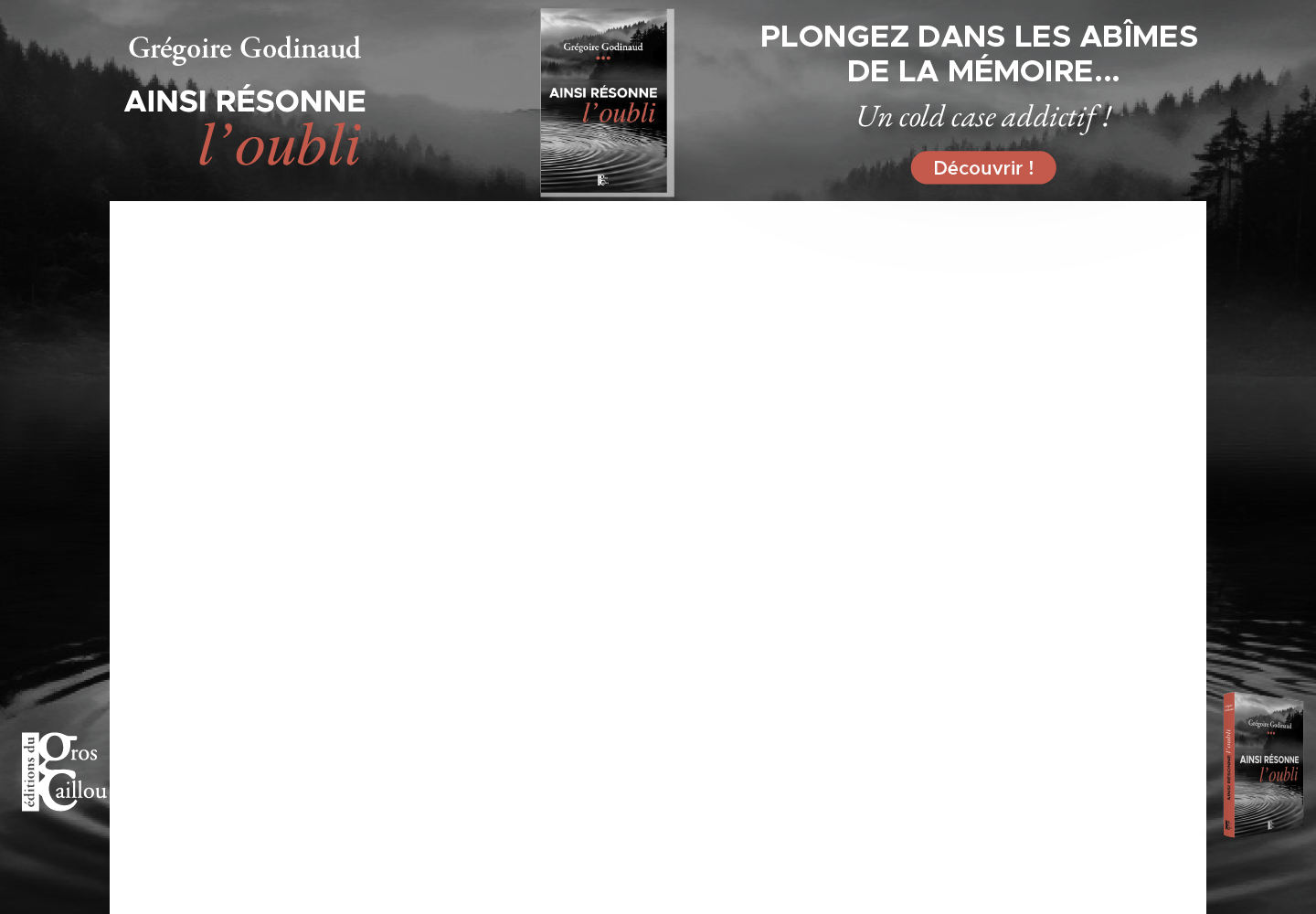La profession le savait déjà de manière empirique, et une enquête (1) publiée récemment par l’ADBU (Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires) le confirme : la part des livres imprimés dans les collections ne cesse de décroître depuis dix ans. Pourtant, entre 2002 et 2013, les dépenses documentaires des bibliothèques universitaires ont progressé, passant de 46 458 109 euros à 66 015 810 euros. Des budgets d’acquisition en hausse, donc (malgré un fléchissement à partir de 2010), mais dont la répartition entre les différents types de documents a considérablement évolué : en 2002, les livres représentaient près de 33 % des dépenses, les revues 51 %, la documentation électronique 16 %. Onze ans plus tard, les revues papier représentent à peine 20 % du total des acquisitions, et les livres 23,6 %. Les dépenses consacrées à ces derniers sont restées quasi identiques, alors que plusieurs établissements ont ouvert : 15 260 494 euros en 2002, 15 593 993 en 2013.
La faute au numérique.
Premier responsable désigné : l’explosion des dépenses pour la documentation électronique, qui atteint aujourd’hui en moyenne près de 57 % du budget d’acquisition des établissements. Certes, ces ressources se sont considérablement développées, mais les bibliothécaires dénoncent depuis plusieurs années leur coût prohibitif qui assèche les budgets. « Il faut absolument freiner ce processus. Si les prix continuent d’augmenter de 5 à 8 % par an comme actuellement, d’ici à 2018, nous ne serons plus en mesure d’acheter des livres », alerte Christophe Péralès, président de l’ADBU. C’est déjà la situation que connaît une grande bibliothèque de la région parisienne : depuis plus d’un an, elle consacre l’intégralité de son budget aux ressources électroniques et n’achète plus de livres. « Nous n’avons pas le choix, justifie son directeur. Nous disposons de 800 000 euros quand on aurait besoin de 2 millions. » Or, si pour les périodiques il y a eu un transfert massif du papier vers le numérique, il n’en est pas de même pour les livres. Une offre éditoriale encore limitée et mal adaptée aux besoins des étudiants, des contraintes technologiques dissuasives, des usages qui tardent à se mettre en place freinent la mutation d’un support vers l’autre. « On veut nous faire croire que la solution se trouve dans les ressources électroniques. Mais les ebooks ne remplacent pas les livres imprimés, souligne Albert Poirot, administrateur de la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. Ici, certains chercheurs en sciences humaines préfèrent aller à la bibliothèque universitaire de Fribourg, en Allemagne, dont les collections sont bien plus riches que les nôtres dans certaines disciplines comme les langues ou l’histoire. »Moins de livres, plus de services.
Autre facteur, plus récent : les contraintes budgétaires auxquelles font face les universités. Touchées par les plans d’austérité du précédent gouvernement (en 2013, en revanche, leurs moyens généraux ont augmenté de 2,02 %), certaines d’entre elles connaissent en plus des difficultés à gérer leur budget, en particulier leur masse salariale, depuis la mise en œuvre du processus d’autonomie. La documentation leur sert souvent de variable d’ajustement. « Les universités sont capables de mettre beaucoup d’argent dans les laboratoires de recherche, mais pas dans les bibliothèques qui sont pourtant l’équivalent du laboratoire pour les sciences humaines », déplore Albert Poirot. Un exemple parmi d’autres de ce phénomène : l’université de Mulhouse fait partie des 10 universités françaises ayant le budget par étudiant le plus élevé (13 732 euros selon une enquête récente de l’Officiel de la recherche et du supérieur, quand la moyenne nationale s’établit à 8 940 euros). Pourtant, sa bibliothèque compte parmi les moins bien dotées de l’Hexagone, même si sa directrice, Anne-Marie Schaller, affirme que son service commun de la documentation (SCD) est très soutenu par la présidence de l’université. La bibliothèque, qui a perdu 10 % de son budget d’acquisition entre 2012 et 2013, s’adapte. Elle mise sur le livre électronique, un choix pertinent pour cet établissement qui est multisite, et qui lui permet d’ajuster au plus près ses ressources aux besoins des étudiants. Quand un enseignement s’arrête, l’abonnement aux ressources correspondantes est supprimé. L’équipe tient cependant à maintenir la présence des livres imprimés, mais là encore en ciblant les fondamentaux. « Mieux vaut avoir 3 livres que les étudiants liront que 15 qui ne bougeront jamais des rayonnages », commente la directrice. L’accent est mis sur le travail de valorisation : une collaboration plus étroite avec les professeurs, des formations à la recherche documentaire pour les étudiants en prise directe avec les bibliographies des enseignements. Car pour Anne-Marie Schaller, au-delà des questions budgétaires, c’est de l’évolution des missions des bibliothèques et du métier de bibliothécaire qu’il s’agit : « Le métier change, on s’adapte. On ne gère plus des collections comme avant mais des services, dont le livre. »A la bibliothèque universitaire du Havre, qui doit anticiper une baisse de 10 % de son budget en 2014, la problématique est comparable. « Tous les autres postes budgétaires ont déjà été entamés et je ne peux pas réduire les abonnements. Ma seule variable d’ajustement réside dans les achats de livres », explique Pierre-Yves Cachard, directeur de la BU du Havre. Là aussi, les acquisitions sont resserrées sur le cœur des enseignements et le nombre d’exemplaires réduit, même si 40 % du budget d’acquisition reste affecté au livre.
Pas de fatalité.
Si les professionnels prennent acte de l’évolution de leurs établissements et de leur métier, où le livre n’est qu’un élément parmi d’autres, tous estiment qu’il existe un seuil à ne pas dépasser dans la réduction des collections de livres, si on ne veut pas mettre en danger la qualité de l’offre de la bibliothèque. « La baisse des acquisitions n’est pas dramatique si elle est limitée. Mais il ne faut pas aller trop loin car moins on aura de livres, moins les étudiants auront envie d’emprunter », indique Anne-Marie Schaller, à Mulhouse. Le déclin du livre ne serait pas une fatalité. Il suffirait d’inciter les établissements d’enseignement à développer la pédagogie active, telle qu’elle se pratique dans les pays anglo-saxons par exemple, qui donne une plus grande autonomie aux étudiants dans leur apprentissage et où le livre tient une place importante. « La balle est dans le camp des professeurs. Quand il y a prescription, les étudiants lisent. Dans les disciplines où le livre reste important, nos prêts ne baissent pas. Nous ne sommes pas face actuellement à une mutation des usages, mais à un appauvrissement de l’apprentissage », constate Pierre-Yves Cachard. <1) Enquête menée par l’ADBU auprès de 57 bibliothèques universitaires sur leurs dépenses documentaires entre 2002 et 2013.