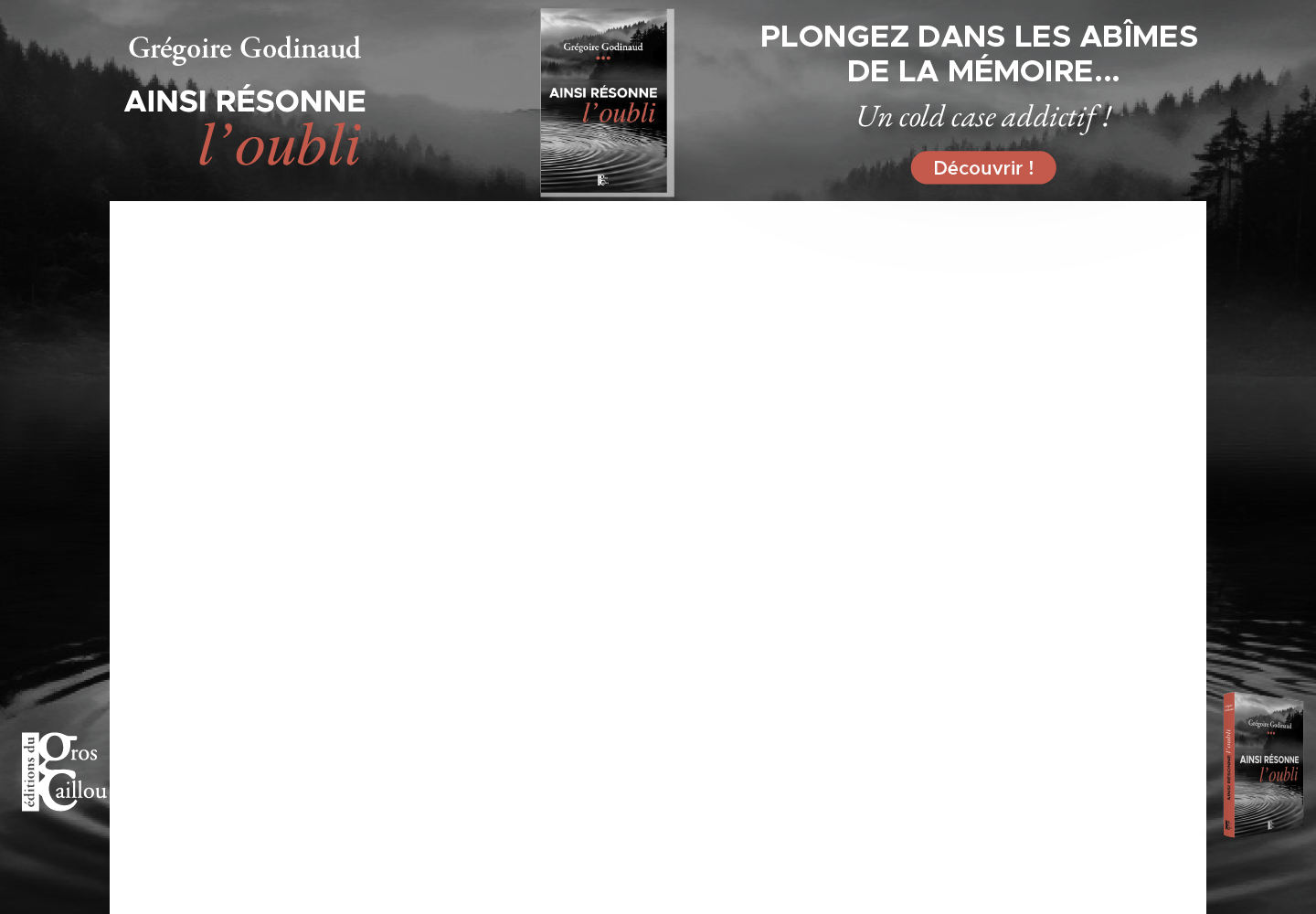Fabrice Luchini - Pour moi c’est évident. C’est quoi un acteur ? C’est quelqu’un qui se fatigue. C’est un paquet d’énergie qui ne demande qu’à donner. Or un comédien qui ne travaille pas est comme un manuscrit envoyé à un éditeur, un manuscrit qui ne trouve pas preneur.
Ce fut une demande de mon éditrice Maxime Catroux chez Flammarion. Cela faisait des années que des gens me disaient "tu devrais écrire". Je n’en voyais pas la nécessité. Vu les textes que je joue, la barre était un peu haute. D’où le titre Comédie française, et puis Ça a débuté comme ça…, les premiers mots de Voyage au bout de la nuit.
Avec le métier de comédien, avec la scène, certainement, mais le livre n’a pas l’ambition de parler de l’institution, surtout pas. Ma comédie française, ce sont des auteurs, des lectures et le parcours d’un personnage qui vient d’un milieu extrêmement modeste et qui se retrouve à parler avec Jean d’Ormesson. C’est bizarre, non ? C’est cela, une comédie française.
C’est une manière d’aller plus loin dans ce rapport un peu étrange de la part de quelqu’un qui n’est pas un universitaire, quelqu’un qui n’est pas un intellectuel, mais qui a un lien avec tout ce répertoire, avec toute cette partition. Je ne mets pas de hiérarchie, je raconte ma relation à la chose écrite.
La musicalité est essentielle. Une "symphonie littéraire". Ce sont les termes employés par Céline lorsqu’il envoie Voyage au bout de la nuit aux éditions Gallimard. "Il s’agit d’une manière de symphonie littéraire, émotive plutôt que d’un véritable roman." Et il ajoute : "L’écueil du genre c’est l’ennui. Je ne crois pas que mon machin soit ennuyeux." C’est admirable. "Je ne pense pas que mon machin soit ennuyeux." Et puis il y a la phrase de Rimbaud dans Une saison en enfer qui est elle aussi admirable. "Je devins un opéra fabuleux." Donc, oui, la littérature a à voir avec la musique, au moins un petit peu. Mon livre raconte cela, ce qui s’est passé avec ces écrivains.
Ah ! vous voulez parler du fameux concept du béret. Je lui ai imposé un trafic associatif banal. Nous sommes face à face, lui l’immense sémiologue et moi, obsédé par ce que j’avais vu dans son entrée. Un béret. Je le lui ai dit. "Il y a truc qui me fascine dans votre appartement." Il me demande quoi. "Levez-vous", lui dis-je. Je l’entraîne devant le portemanteau et je lui montre "ça", un béret, un béret très grand. Il m’a répondu, démuni et sublime : "Mais je suis basque." C’est fabuleux, non ?
Parce que je pensais qu’au milieu des sommets, parler d’Emmanuel Macron ou de François Hollande nous ramenait au réel. Donc, aux génies je mêle les gens de la réalité, comme ce carrossier qui ne savait pas du tout qui j’étais. J’ai eu cette idée d’alterner un journal de bord avec mes spectacles, des vacances en Grèce, un tournage avec Bruno Dumont dans le nord de la France, entre cette élévation dans le sublime et la vie. On ne peut pas être dans Nietzsche tout le temps !
[Dans le bar où se déroule l’entretien, un client prend congé avec esbroufe.]
C’est formidable quand les gens se disent au revoir dans les bars populaires, tristes et merveilleux, que j’adore. Il y en a toujours un qui dit "Bon allez…". C’est comme un élan vers rien, c’est du Beckett. Il y a un blanc très long, puis il y en a un qui prend congé et qui théâtralise. Ça n’intéresse personne, son départ, mais il dit "Bon allez…". Il se donne du courage, il définit l’absurdité de l’existence. Ce sont les dernières répliques de Godot. "Allons-y", dit Estragon. Et personne ne bouge. Au bar, lui aussi veut que tout le monde soit au courant de son départ. Tout le monde s’en fout, mais pendant deux secondes il a l’illusion que tout le monde le regarde.
Je suis mal placé pour commenter. Vous imaginez si je disais "c’est la beauté de mon timbre" ou "c’est mon souffle hugolien". Je dirais que c’est mon métier. Et c’est pour cela que ce livre était passionnant à écrire parce qu’il fallait restituer la note. Les gens disent qu’en entend ma voix dans le livre. Il y a un moment où j’ai trouvé un ton. Par exemple dans le passage sur le bus 80. Là, il y a un rythme.
Celui-là, sans doute, sur le 80. "Il aurait pu tourner à gauche. Il serait allé vers la Goutte-d’Or. On ne la méprise pas la Goutte-d’Or, mais on n’a pas envie d’y aller tout de suite. Pas tout de suite. Il a tourné à droite…" Pourquoi pas, oui, je me lirai. Ça va me faire du boulot…
J’ai toujours eu le fantasme d’être dans un groupe, mais mon inaptitude psychique est trop immense et, comme dirait Nietzsche : "Comme l’autre, comme le prochain est dur à digérer." Cela me fait penser à Labiche. Il avait l’œil riant, il voyait la nature humaine tellement couillonne, totalement pitoyable, totalement bête, minable, misérable, égoïste, centrée sur elle-même. Mais il la regardait avec un œil souriant. C’est la clé. Toute activité sociale doit partir du regard intérieur riant de Labiche. Sinon tu ne peux pas, sinon tu te dis c’est pas possible, sinon tu tombes dans la transcendance avec l’idée que l’homme est une créature imparfaite de Dieu qui retrouvera Dieu. Ou alors il y a Nietzsche, mais c’est un gros engagement : "Qu’est-ce qu’un homme sinon un animal malade ?"
Quand les gens me disent "tu es très gentil avec ton chien", je leur réponds que le chien est beaucoup plus réussi, je suis désolé. Il est limité, mais réussi. Alors que l’homme, c’est un boyau avec un rêve, comme disait Céline.
Mais Muray n’a pas l’œil riant. Il y a de la dureté chez lui. Il nous dit vous êtes des cons, des "mutins de Panurge", des festifs, vous êtes pris dans un politiquement correct. Sa méchanceté est très drôle. Chez Labiche, la drôlerie s’accompagne de compréhension. C’est le grand conflit Alceste-Philinte dans Le misanthrope. "Je prends tout doucement les hommes comme ils sont, dit Philinte. J’accoutume mon âme à souffrir ce qu’ils font." Quand tu n’as pas cela, tu te mets en colère. Mais qu’est-ce que vouloir rechercher la perfection chez les autres ?
Non, l’écriture est une douleur pour moi, parce que la page blanche est dénuée d’hystérie. Ce fut un travail énorme pour écrire ce livre. Mais j’ai trouvé important de le rendre ludique, pas très sérieux tout en étant très exigeant.
James Joyce, l’éternel Ulysse, Robert Musil… Mais je ne vais pas faire le malin, j’ai déjà du mal avec Proust. Je recommence tout depuis le début à chaque fois. C’est colossal.
C’est un gros problème, la poésie ! J’ai attaqué un gros morceau, celui sur lequel on a le plus écrit. Personne n’a été plus commenté que Rimbaud. Il a écrit cinq ans. Après il est parti. Il n’a plus voulu entendre parler de rien. C’est le contraire du plumitif, le contraire de celui qui vient dans la librairie pour voir si son livre est bien placé, c’est le contraire de l’écrivain bourgeois. Il a à la fois obscurci le paysage - c’est une phrase de Jean d’Ormesson - dans la mesure où, pour être un artiste, on est obligé de vivre une vie immonde comme la sienne, et en même temps on voit bien que c’est un surgissement immense. Je me contente des grands poètes classiques, Baudelaire, Hugo, Rimbaud. J’ai du boulot avec ça. J’aime bien la poésie quand elle est concrète. Alors, très bizarrement, Le bateau ivre est une obsession musicale. C’est comme une langue étrangère. Mon livre parle de l’incroyable rapport à ça, comment on fait avec ça !
Ma thèse est que la poésie est présente chez Proust, chez Céline, chez La Fontaine, chez Jules Renard, chez Guitry et chez Labiche. Qu’est-ce qu’on aime chez les grands génies, qu’est-ce qu’on aime chez Céline, si ce n’est le poète incontournable ? Il y a des grandes pages de poésie pure dans le Voyage. Et comme disait Jules Renard, "je ne sais pas si j’ai du goût, mais j’ai le dégoût très sûr".
Fabrice Luchini, Comédie française. Ça a débuté comme ça…, Flammarion. 250 p. ; 19 €. Tirage : 100 000 exemplaires. ISBN : 978-2-08-137917-6. Parution le 2 mars 2016.