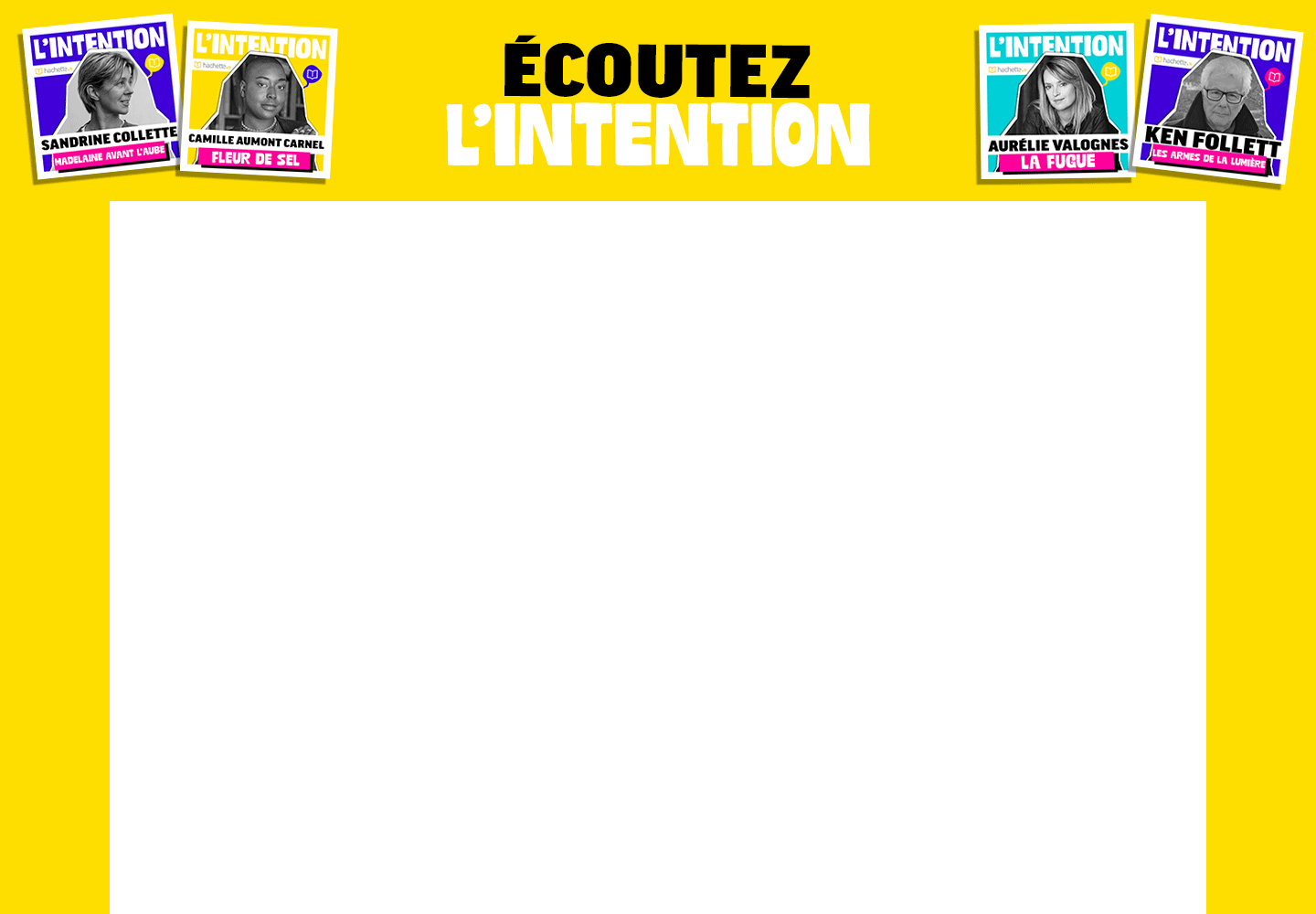Ashkénaze originaire de Pologne, née par miracle dans un camp de réfugiés, en Suisse, en 1943, Myriam Anissimov a toute sa vie vécu hantée par la Shoah, qui a décimé une partie de sa famille. Son œuvre, naturellement, que ce soient ses biographies (Primo Levi, Romain Gary, Vassili Grossman) ou ses récits autobiographiques, en porte la marque, indélébile, comme l’encre des numéros tatoués sur le poignet des déportés. Une fois encore, elle creuse, elle fouille, elle exhume, s’attachant à trois personnages fort différents, mais dont la destinée a été quelque part conditionnée par la Seconde Guerre mondiale. Pour elle, "de l’histoire immédiate".
Il y a Romain Kacew, alias Gary, alias Emile Ajar, qu’elle a rencontré vers la fin de sa vie, clown pathétique et désespéré, sur un plateau d’émission de télé. Une relation s’en est suivie, intime mais platonique, avec cet être hors norme, odieux et touchant, qui finira par se suicider.
Puis le chef d’orchestre roumain Sergiu Celibidache, qui n’était pas juif, et a même travaillé en Allemagne durant la guerre. Son pays était allié des nazis. Devenu bouddhiste, gourou mégalo, il était le maître du violoniste Emmanuel Moskowicz, l’amoureux d’alors de Myriam. Celibidache aurait voulu la soumettre, elle lui a résisté.
Enfin, surtout, il y a Samuel Frocht, ce jeune oncle maternel, musicien "porté disparu" à 17 ans, à la frontière espagnole. Grâce à sa ténacité, elle apprendra qu’il est mort, en 1942, dans le camp d’extermination de Sobibor. Le directeur, Franz Stangl, responsable de 900 000 meurtres, faisait chanter des oies pour couvrir les cris des sacrifiés. Ça ne s’invente pas. Le reste est littérature. J.-C. P.