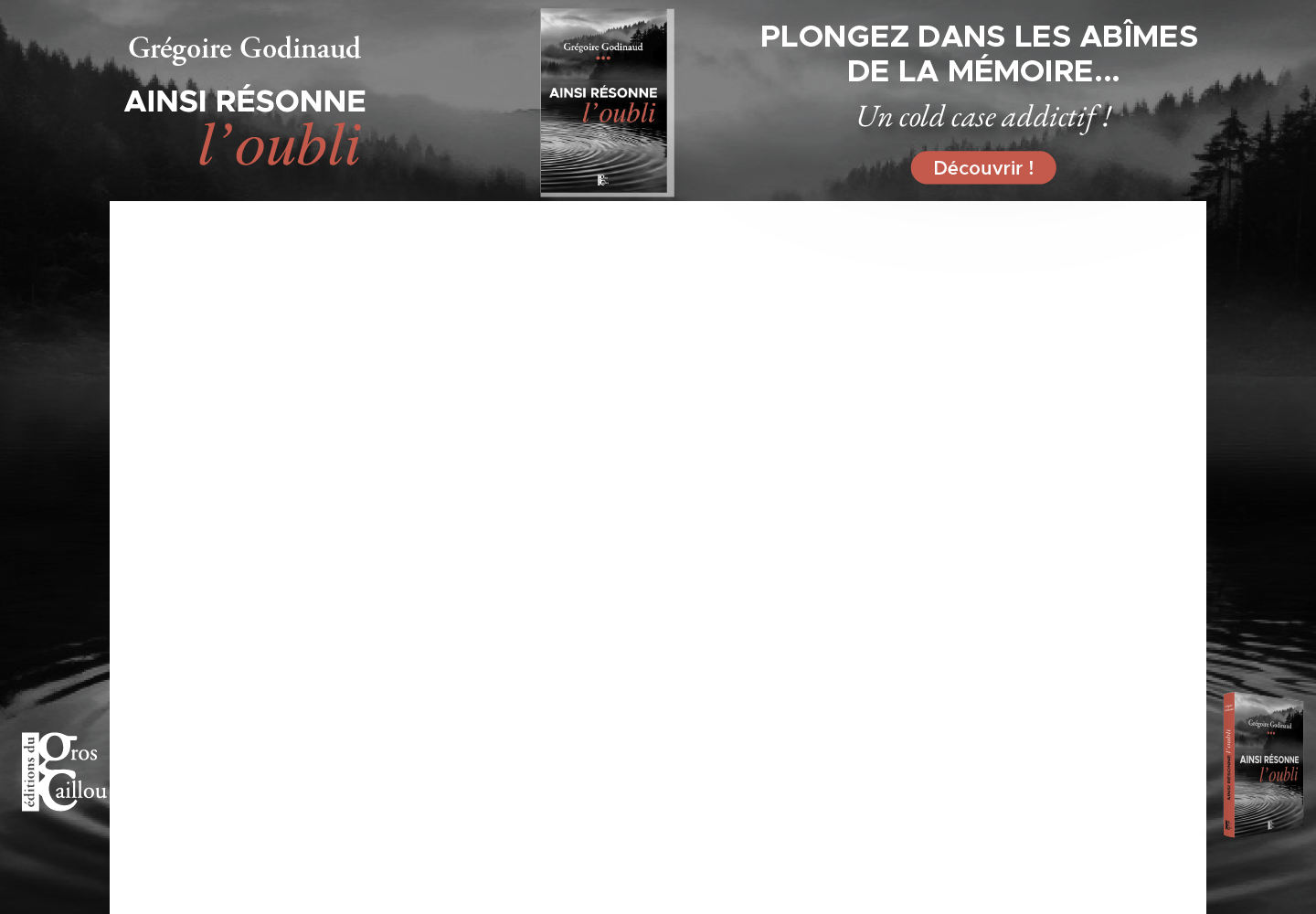Justice
Auteur du blog

Tous ses billets
Ce méli-mélo assez décousu est toutefois bien utile, car il permet de comprendre ce que recouvre la directive européenne du 8 juin 2016, transposée en droit français à l’occasion d’une loi du 30 juillet 2018 et intégrée à présent au code de commerce.
L’idée d’une protection du « secret des affaires » avait déjà émergé en janvier 2012 et abouti au vote par le Parlement français, en première lecture seulement, d’un texte aux mêmes desseins.
Le rapporteur de ce texte précurseur avait soutenu que « protéger le secret des affaires, c'est protéger des emplois, des technologies sensibles, des investissements, lutter contre la désindustrialisation et, dans certains cas, garantir nos indépendances dans les secteurs stratégiques ».
Une nouvelle tentative de loi avait été proposée aux députés français, à la fin du sinistre mois de janvier 2015, sous la forme d’un nouveau délit. Le dispositif avait été repoussé à la suite d’une mobilisation des éditeurs de presse.
Le coup est donc hélas revenu par le biais de l’Union européenne.
Le cas Challenges
Rappelons que, avant même la transposition de la directive en droit interne, le Tribunal de commerce de Paris avait rendu, le 22 janvier 2018, une ordonnance de référé condamnant le journal Challenges à retirer de son site un article du 10 janvier précédent consacré à qui Conforama et détaillait sa mise sous placement d’un mandat ad hoc.
La demanderesse arguait d’une violation de l'article L. 611-15 du Code du commerce, disposant que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». L’entreprise éditrice du journal plaidait le droit à l'information du public à propos d’un « sujet d'intérêt général ».
Le juge avait considéré que le journal n’était certes pas une entité visée à l'article L. 611-15 du code du commerce, mais qu'il convenait « de s'interroger si cette information pouvait connaître une plus large diffusion auprès du public »
Le magistrat s’appuyait sur un arrêt de la Chambre commerciale en date du 11 mars 2014 sanctionnant la diffusion d'informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises et couverte par la confidentialité.
Un spectre très large
Le spectre de la loi française de 2018 est très large, puisqu’est visée « toute information répondant aux critères suivants :
« 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
« 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
« 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
En clair, en vertu de la directive communautaire comme de la loi française, les divulgations d’informations relatives au blanchiment, à la corruption ou encore au négoce de médicaments toxiques peuvent être aisément poursuivies.
Selon tous les observateurs autorisés, la directive interdit toute mise à nu d’un scandale similaire aux « Panama Papers ». C’est pourquoi la nouvelle disposition, issue des travaux européens, particulièrement coercitive, a suscité de nombreux débats.
Plusieurs bémols
La loi de 2018 comporte donc plusieurs bémols. Elle dispose « A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :
« 1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
« 2° Pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte défini à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« 3° Pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. »
De plus, un autre article précise : « à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque :
« 1° L'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;
« 2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.
L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance. »
Le cas des lanceurs d'alerte et des journalistes
En apparence, la loi de 2018 met à l’écart les lanceurs d’alerte et les journalistes. Reste cependant très délicate la question des livres portant sur… les « affaires », la finance, les industries polluantes. Et celle, bien entendu, des lanceurs d’alertes, car ceux-ci ne bénéficient en France d’aucun statut juridique spécifique.
Durant cet automne 2019, s’est ouvert le long procès du Mediator, qui a permis d’entendre le témoignage glaçant du docteur Irène Frachon. Son livre Mediator 150 mg, Combien de morts ? (Dialogues) avait fait l’objet d’un procès en référé dès sa sortie en 2010. Le tribunal de Brest a alors estimé le sous-titre « accusatoire, grave, inexact et dénigrant ». Ce n’est qu’en janvier 2011 que la Cour d’appel de Rennes a débouté les laboratoires Servier.
Entretemps, le 24 octobre 2010, la Cour d’appel de Paris a estimé que l’interdiction de divulguer de pièces du dossier Servier, en application de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, constituait « une ingérence disproportionnée, dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, et ne répondait pas à un besoin impérieux de protection de la réputation et des droits d’autrui ou de garantie de l’autorité ou de l’impartialité du pouvoir judiciaire et doit, dès lors, au cas d’espèce être déclarée non conforme à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Bras de fer
En l’occurrence, un grand quotidien avait amplement cité les procès-verbaux d’audition d’un témoin « visant à présenter la politique de diffusion de ses produits par les Laboratoires Servier comme recourant à des méthodes mercantilistes de persuasion des médecins prescripteurs, peu soucieuses d’exactitude sur les caractéristiques et les propriétés réelles de ces produits et, en particulier du Mediator, sans contenir une claire prise de position sur la culpabilité des Laboratoire Servier. »
Or, la cour a décidé qu’« informer le public sur un sujet tel que l’affaire du Mediator, qui a trait à un problème de santé publique général (…) présente sans conteste un intérêt majeur ».
Ces décisions de justice ne doivent pas faire illusion. Rappelons que, d’une manière générale, les protagonistes des faits divers ou de scandales affairistes disposent d’une très grande palette de moyens juridiques pour empêcher aussi bien les simples comptes-rendus de leurs péripéties que les fictions.
Cette seule… « affaire » démontre que le bras de fer entre les entreprises les plus puissantes et les auteurs de livres reste bien inégal. Et la loi française de 20I8 n’a guère permis de rééquilibrer cette situation.
Auteur du blog

Emmanuel Pierrat
Tous ses billetsLivres cités
Articles liés


Pierre Dukan condamné par l'Ordre des médecins pour prescription de Mediator


Dialogues.fr autorisé à réutiliser la couverture originale de “Mediator 150 mg”


La censure par le secret des affaires

L'Europe et le secret des affaires


À la recherche d'un statut pour les lanceurs d'alerte
Les dernières
actualités

Disparition
Décès de Michel Ollendorff, figure du secteur de la librairie
Michel Ollendorff s'est éteint le 29 mars 2025. Acteur majeur de la librairie en France, il était notamment le premier directeur de l'École de la Librairie.
Par Antoine Masset

Radio & Télévision
Dans les médias cette semaine : Marie NDiaye, Ambre Chalumeau, Marion Brunet
Cette semaine dans les médias, Marie NDiaye est l'invitée de Vincent Josse dans Le Grand atelier, Ambre Chalumeau présente son premier roman, Les Vivants (Stock) à Claire Chazal dans l'émission Au bonheur des livres et Marie Labory reçoit Marion Brunet, prix Astrid Lindgren 2025, dans Les midis de culture.
Par Louise Ageorges

Littérature générale
Toujours plus loin de La liste de mes envies, Grégoire Delacourt prolonge sa veine autofictive familiale avec un roman cru et rude. Parution 30 avril
Par Jean-Claude Perrier
Abonnez-vous à Livres Hebdo
- Accès illimité au site
- LH Meilleures Ventes, tous les indicateurs métiers
- LH le Magazine, le mensuel
- LH Spécial, le thématique
- Les bibliographies : Livres du Mois et Livres de la Semaine
Également disponibles sur notre boutique :
Numéros à l'unité, hors-séries, annuaire et planisphère.