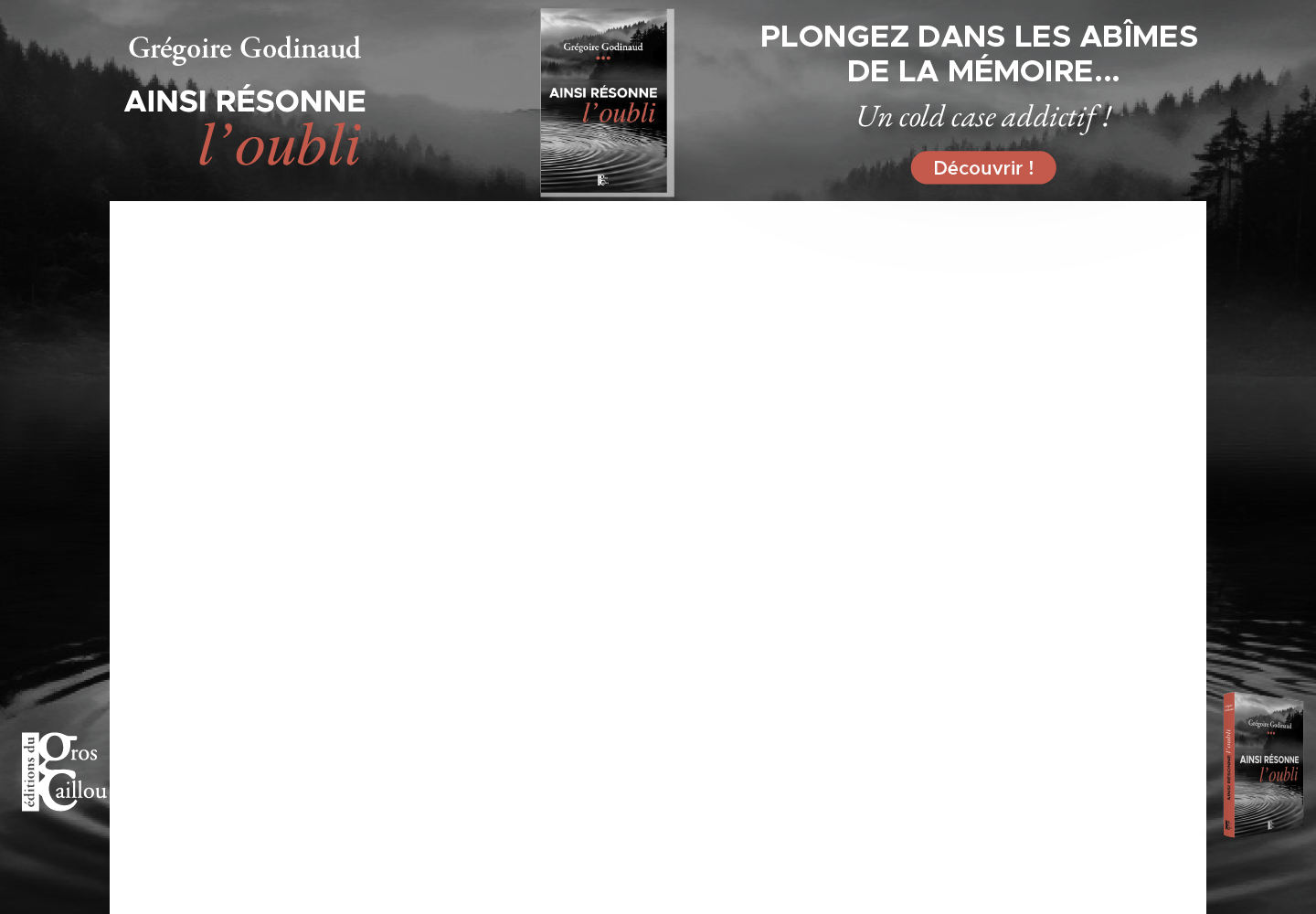La Cour de cassation vient, par deux décisions des 13 décembre 2014 et 7 janvier 2015, de rappeler les règles très précises qui encadrent les droits de propriété littéraire et artistique dont peuvent jouir les salariés et les conditions dans lesquelles ces droits sont cessibles à l’entreprise.
La première affaire, examinée par une chambre civile, mettait aux prises un directeur artistique et son employeur, une agence de publicité qui avait reproduit des visuels, des brochures et des logos sur son site internet. Les magistrats considèrent que l’employé avait participé à la création d’oeuvres collectives, dont il ne maîtrisait plus les droits d’exploitation.
En revanche, dans le second litige, jugé par la Chambre sociale et qui portait sur huit résumés rédigés à propos de la musique savante du XXe siècle, la Cour a donné raison à la salariée qui revendiquait des dommages-intérêts. Son employeur avait exploité ces textes, en s’appuyant sur l’existence d’un avenant au contrat de travail prévoyant la cession des droits… mais dont la rédaction est jugée imparfaite.
Soulignons, en premier lieu, que l’auteur est, en droit français, le titulaire initial des droits de propriété littéraire et artistique portant sur son œuvre.
Le second principe essentiel, en matière de titularité des droits, est que seule peut être auteur une personne physique. Une personne morale – société, association, etc. – ne peut apparemment avoir qualité d’auteur, même si elle peut, sous certaines réserves, se faire céder la totalité des droits patrimoniaux.
Or, selon le dernier alinéa de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), “l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit”.
La loi – hormis pour le cas spécifique des journalistes – est donc a priori très claire : quand bien même l’auteur serait lié par un contrat de travail ou un contrat d’entreprise – “contrat de louage d’ouvrage ou de service” –, il conserve la plénitude de ses droits d’auteur. Une entreprise d’agroalimentaire ne pourra, par exemple, revendiquer des droits sur le roman écrit par un des chercheurs qu’elle emploie.
La jurisprudence admet cependant une attribution des droits d’auteur à l’employeur si certaines conditions sont réunies.
La première de ces conditions consiste en l’existence, dans le contrat de travail, d’une clause mentionnant la cession automatique des droits d’auteur en faveur de l’employeur.
Il n’existe pas en ce domaine de présomption de cession ou de cession tacite en dehors d’une première exploitation clairement sous-entendue entre les parties : en l’absence de clause de cession, un éditeur de revue aura juste vocation à publier une première fois le travail d’un rédacteur mais en aucun cas le droit de le réutiliser. Il se trouve des décisions judiciaires anciennes ou isolées, et toujours contestées, qui admettent des cessions tacites. Il ne faut pas se leurrer sur la portée de ces jurisprudences erratiques : la cession des droits est en règle générale subordonnée à leur mention expresse et détaillée au sein du contrat de travail.
L’exercice se corse en raison de la “prohibition des cessions globales d’œuvres”. L’article L. 131-1 du CPI dispose en effet que “la cession globale des œuvres futures est nulle”, ce qui oblige jusqu’ici à rédiger, par artifice, des clauses aux termes desquelles “la cession a lieu au fur et à mesure de la création des œuvres”… La jurisprudence la plus autorisée n’a pas eu pour l’heure à se pencher sur la validité d’une telle formule.
Hormis cette éventuelle difficulté, les tribunaux admettent pleinement ce type de clause. La Cour de cassation a même estimé, le 3 avril 2002, à propos du contrat de la directrice du département “langue française” d’un éditeur de dictionnaires, qu’il ne pouvait être annulé pour cause de “violence”. Les juges ont précisé que “seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement”.
De plus, il est nécessaire que l’œuvre du salarié corresponde au type d’activité de l’employeur, défini généralement, pour les sociétés, par ce qu’on appelle l’objet social – décrit dans les statuts de la société. L’auteur sera bien celui qui a créé l’œuvre, mais il ne conservera sur celle-ci que des droits moraux (droit au respect du nom, droit au respect de l’œuvre, etc.), les droits patrimoniaux étant automatiquement dévolus à son employeur. Si son contrat de travail contient la clause adéquate, notre chercheur en agroalimentaire peut perdre les droits de reproduction et de représentation sur un article, décisif pour la recherche, sur la mutation des pousses de riz. Le salaire est alors également considéré comme une valable contrepartie de la cession.
L’éditeur ne doit pas oublier que nombre de salariés qui ne figurent pas à des postes demandant de véritables efforts de création n’en sont pas moins auteurs des images ou des textes qu’ils peuvent produire dans le cadre de leur activité habituelle. Ils sont donc, tout autant que les graphistes ou autres rédacteurs patentés, concernés par la cession de leurs droits de propriété littéraire et artistique.
Il ne faut pas ignorer cependant que, s’ils exigent désormais des clauses de cession des droits d’auteur dans les contrats de travail, les tribunaux rendent des décisions souvent sévères sur la portée exacte de ces clauses.
Il existe enfin une exception concernant les œuvres dites collectives, dont la titularité des droits peut originellement, et dans des cas très spécifiques, être dévolue à une personne morale telle qu’une agence de publicité ou une entreprise d’édition.