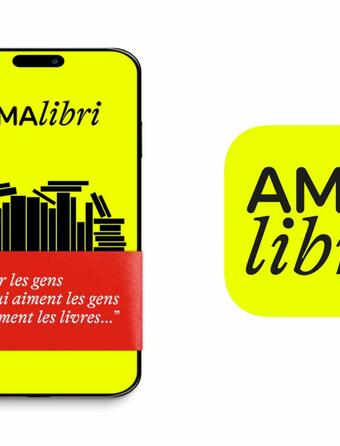Posons-le en principe, Frédéric Mitterrand est un outsider. Aux yeux de la doxa, des trissotins conformistes de la critique, il n’est rien tout à fait : pas franchement écrivain puisque pas romancier, un peu cinéaste mais pas vraiment, homme de télévision à la rigueur, c’est bien assez pour lui et c’était il y a longtemps. Pour ne rien dire de ses allers-retours erratiques entre la gauche et la droite ou de son parcours ministériel qui acheva de le brouiller avec les uns sans le réconcilier avec les autres… Bref, ce grand type à la gaieté cathodique douteuse a beau n’en avoir que pour les familles (de la sienne à celles des têtes couronnées), aucune ne l’admet vraiment en son sein.
Aucune, si ce n’est peut-être celle dans l’ordre de la nuit, des réprouvés, des anges déchus, déçus, décevants. C’est de cela, cet "état-civil parallèle", que se composent les pages, gorgées d’une lumineuse tristesse, de Mes regrets sont des remords. Perec se souvenait, Mitterrand regrette. L’un avait le souvenir bref, profus et précis, l’autre garde du regret l’indolence, comme une lancinante douleur. Mais que regrette-t-il donc ? A vrai dire, à peu près tout : les jours enfuis, les vies (la sienne, celles de ceux qui croisèrent plus ou moins longtemps son chemin) vécues de travers, les voix enfouies au fond du jardin de la mémoire.
C’est l’histoire d’un vieil enfant du 16e arrondissement qui a tout perdu, sa mère autant que le goût de donner le change ou celui de l’avenir, et qui l’écrit pour ne pas avoir à le pleurer. Ce n’est pas très gai évidemment (ce peut tout de même parfois être assez drôle tant le vieux chien triste sait encore mordre), mais c’est assez déchirant de douceur et de beauté mêlées. Passent dans cette ronde ophulsienne des regrets, les fantômes de l’Olympic, sa salle de cinéma, ceux de son refuge tunisien, les amis de sa mère, astre noir autour duquel s’organise ce récit, les amants, les femmes, exagérées comme des héroïnes durassiennes, des garçons sensibles croisés et lâchés sur les cinq continents, les bonnes, les nurses d’une enfance trop protégée, jusqu’aux bêtes, les chiens surtout, que l’on a cru aimer et que l’on a pourtant abandonnées. De temps en temps, un visage tout aussi chéri et plus connu surgit : Koltès, Viviane Romance, le Prince Eric… Les salauds ou les imbéciles ne verront là que complaisance ; les autres, les lecteurs, qui savent que l’écriture de soi est toujours un regret de l’autre, trouveront sans doute que cette fois-ci, après La mauvaise vie ou La récréation (Robert Laffont, 2005 et 2014), le doute n’est plus permis : Frédéric Mitterrand est bien l’un de nos écrivains les plus précieux. Il serait regrettable que l’écume des jours et de sa vie nous le cache plus longtemps.
Olivier Mony