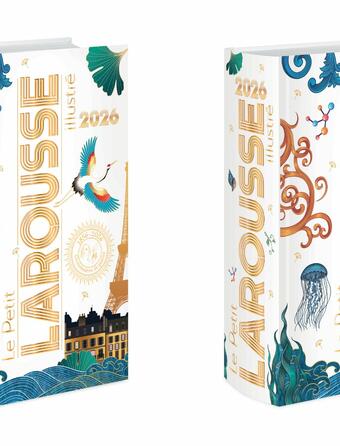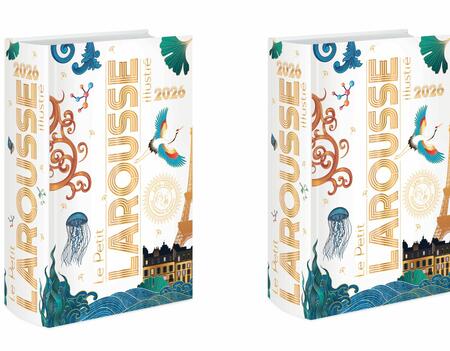Livres Hebdo : Ce livre marque une rupture avec vos précédents romans, l'aquatique Summer et le dernier, Eden, qui traduisaient des univers très oniriques. Dans La vie clandestine, tout est beaucoup plus clair, explicite...
Monica Sabolo : Il y a eu quelque chose de plus direct dans mon écriture et dans ma démarche, car je me dévoile énormément. Pour la première fois, j'ai été prête à faire un livre sans fard. La violence est présente dans tous mes livres, mais elle n'a jamais été aussi clairement exprimée ni n'a pris autant de place. De livre en livre, on approche les choses, à petits pas, puis on les regarde, et enfin on peut les formuler. Comme une pierre que l'on polit. Étonnamment, ça n'a pas été un livre difficile à écrire. C'est un aboutissement, la fin d'un long chemin. C'est aussi un livre de la réconciliation.
L'enquête que vous développez autour d'Action directe est a priori très éloignée de vous. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce groupe armé d'extrême gauche des années 1980 ?
Je suis entrée par mon obsession, par l'adolescence. À l'origine, j'avais envie de travailler sur ces deux jeunes femmes de 27 et 29 ans, qui, dans les années 1980, attendent un grand patron sur un banc et l'abattent. Ça me paraissait stupéfiant : comment on en arrive là, que cherchaient-elles ? Et puis, Action directe, on connaît sans connaître. Je trouvais qu'il y avait du mystère, que c'était une page importante de l'histoire qui n'a pas laissé beaucoup de traces, au contraire des Brigades rouges ou de la Fraction armée rouge. Or c'est dans le flou que se glissent le mystère, et la littérature. Ce sujet n'est pas si éloigné de moi... C'est un livre qui s'interroge sur la violence et sur le trouble, sur le fait de commettre l'irréparable tout en voulant le bien de l'humanité. Il s'agit de ces endroits très complexes où il est difficile de tracer une frontière nette entre le bien et le mal. Or je travaille toujours autour de ces endroits inconfortables. Ce qui est différent, c'est que je voulais écrire sur une histoire réelle. J'avais très envie de travailler la non-fiction, sur le modèle d'autrices comme Maggie Nelson... Mais j'ignorais que j'allais parler de ma famille. C'est peut-être le livre qui est le plus important pour moi, le plus proche de moi. Comme je le dis à la fin, c'est le réel dans lequel se glisse la littérature. Je me suis fait totalement rattraper, et par la vie, et par la littérature. J'écrivais des choses qui se déroulaient simultanément. J'écrivais mes doutes et j'ai aimé pouvoir le faire, montrer que j'étais une enquêtrice nulle, que je projetais mes émotions sur les événements historiques... J'ai réalisé, aussi, que le témoin impartial n'existe pas.
On ressent une ambivalence, un conflit permanent dans le texte vis-à-vis de la violence et des membres d'Action directe que vous avez rencontrés... Qu'est-ce qui vous a gênée ?
Dans la lutte armée, on ne parle pas d'individus, ils n'ont pas de noms, ce sont « les camarades », et la victime n'en a pas non plus, c'est « le capitaliste », « la brute »... Ça m'a énormément heurtée. Le collectif peut être galvanisant et faire bouger le monde, mais il est dangereux aussi. Au nom du groupe, on peut commettre l'irréparable et gommer ses responsabilités individuelles. Or pour moi, dans un assassinat, il y a quelqu'un qui tient le pistolet et quelqu'un qui meurt. Faire semblant que cela n'existe pas, ça m'a révoltée, comme le fait de ne pas demander pardon, de ne jamais avoir le moindre doute. La radicalité nécessite parfois une simplification des choses, alors que, pour ma part, je doute de tout... Quand je dis que ce livre n'a pas été difficile à écrire, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que j'ai trouvé extrêmement difficile, c'est d'être toujours à l'endroit juste. Je voulais comprendre les mécanismes, sans les justifier, sans les excuser. Je comprends et je vois de la violence de plusieurs côtés. Dans ce combat révolutionnaire, parfois, pour faire bouger les choses, on ne se permet pas la nuance. Et ça pose question.
Dans ce texte, vous mettez en présence des idées et des personnes qui a priori s'opposent. Est-ce une façon de vous confronter à elles et a fortiori à votre propre histoire ?
Peut-être que j'ai enfin été capable de confronter. Ma rencontre avec Nathalie Ménigon était une confrontation. Je voulais parler de la responsabilité et de la culpabilité, ça me semblait un devoir, une question d'honneur, presque. Rencontrer ces différentes personnes m'a permis de régler quelque chose de ma propre histoire de façon assez mystérieuse. Il y a un grand parallèle entre eux et moi, c'est le secret, le silence, ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à parler.
« Ceux qui doutent, craignent de blesser ou de trahir, ceux qui n'ont pas les mots, ceux qui ne savent pas. » C'est ainsi que vous introduisez le personnage d'Hellyette Bess, « la vecchietta » d'Action directe, qui s'est occupée de ses camarades en prison pendant des décennies...
Je ne le fais pas volontairement mais il me semble que mes héros sont des antihéros, ceux qui ont l'air fragiles, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Je suis très heurtée par ceux qui prennent toute la place. Le silence, la fragilité, la peur de trahir, sont beaucoup plus intéressants. La fiction est le lieu pour redonner voix à des femmes aussi extraordinaires qu'Hellyette Bess. Elle est résolument du côté de la vie et a une trajectoire de combat extrêmement intéressante. C'est la femme de l'ombre, qui soigne. Quand on pense à Action directe, ce sont des images très négatives qui surgissent, mais comme je le dis à un moment : « Ne vous approchez pas trop du cœur des gens, vous ne serez plus jamais sûrs de rien. »
Ce sont ces ressentis contradictoires qui génèrent la dissociation, dont il est beaucoup question dans le texte ?
Il y a la dissociation de la mémoire effacée par un traumatisme, en ce qui concerne la narratrice, mais il y a également la dissociation vis-à-vis d'émotions qui peuvent être dérangeantes pour ces combattants de la lutte armée. Il me semble qu'il faut être dissocié pour réussir à vivre pendant toutes ces années en ayant tué des gens. La dissociation est un mode de protection, mais qui peut être dangereux. Le bourreau est lui aussi dissocié, de la blessure qu'il va causer et de l'empathie vis-à-vis de l'autre. La dissociation peut aussi faire basculer dans le crime et l'impardonnable. Ce qui permet ce glissement, c'est que l'autre devient une entité, une idée. C'est quelque chose qui me semble glaçant, quand l'idée est plus importante que l'homme.
Vous écrivez vers la fin du livre, et vous insistez : « Je ne suis pas un traître. » Pourquoi ce besoin de l'exprimer ?
C'est la culpabilité des êtres abusés. On ne passe jamais complètement du côté du droit. Il y a toujours quelque chose qui reste, de l'ordre de la faute. Et puis j'ai essayé d'être d'une extrême sincérité pour respecter la parole de ceux qui m'ont parlé, mais c'est toujours sur un fil. Je ne peux pas cautionner tous leurs actes. Il y a de la beauté et il y a de l'horreur. Ça crée un sentiment de culpabilité, parce que c'est difficile. La réponse n'est pas confortable.
La vie clandestine
Gallimard
Tirage: 30 000 ex.
Prix: 21 € ; 336 p.
ISBN: 9782072900426
RESUME LIVRE Monica Sabolo
MS est décidée à écrire un livre « efficace et sérieux ». Un livre sur l'histoire d'Action directe (AD), ce groupe de lutte armée qui a sévi dans les années 1980 et qui est aujourd'hui quasiment tombé dans l'oubli. C'est ainsi que MS rencontre Hellyette Bess, ancienne membre d'AD qui la présente au milieu anarcho-communiste pour son enquête. Mais en réveillant cette histoire et en réfléchissant aux questions qu'elle soulève sur la responsabilité et la culpabilité, ce sont ses propres souvenirs d'enfance que MS fait resurgir, marqués par une ultime trahison, celle d'un inceste.