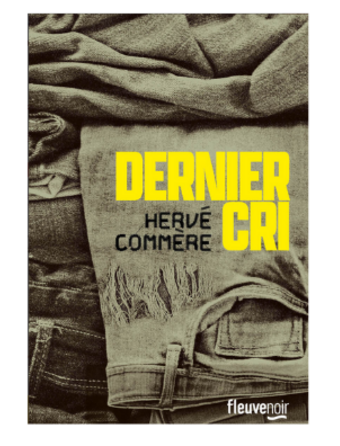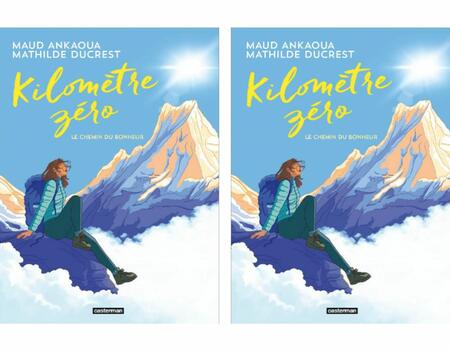La langue allemande, on peut dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ?
Tout à fait. Chez moi, c'est un atavisme ! Mon père, aujourd'hui décédé, était prof d'allemand. Ma mère, Nicole Casanova, maintenant âgée, journaliste et traductrice de l'allemand. À 6 ans, quand d'autres commencent le piano, on a commencé à m'apprendre l'allemand avec un répétiteur autrichien. J'aimais beaucoup cela. Et déjà, le problème du sens des mots se posait à moi : comment un même mot peut avoir des sens différents d'une langue à l'autre.
Vous destiniez-vous à devenir traducteur ?
Pas du tout. Je voulais être professeur de philosophie. J'ai fait une khâgne à Henri-IV, puis je suis passé en fac, et j'ai débuté à Libération. Et c'est tout ! La traduction est venue par hasard.
Quel fut votre tout premier chantier ?
En 1978, j'ai traduit un essai sur la vie et l'œuvre du peintre George Grosz, paru chez Maspero, sacré traducteur lui-même. Puis il y eut Les Bertini, de Ralph Giordano, que m'avait confié Jean-Étienne Cohen-Séat, alors patron de Calmann-Lévy. Un livre très sobre, très impressionnant, avec des images que je n'ai jamais oubliées, notamment la description du retour à la vie après un bombardement sur Hambourg.
En travaillant sur l'Allemagne, vous saviez que vous seriez confronté à l'histoire du pays, avec ses horreurs : le nazisme, la guerre, les camps, la Shoah...
Évidemment. Quand on travaille sur l'Allemagne, c'est inévitable. Je n'avais aucune prédisposi
Lire la suite
(5 060 caractères)