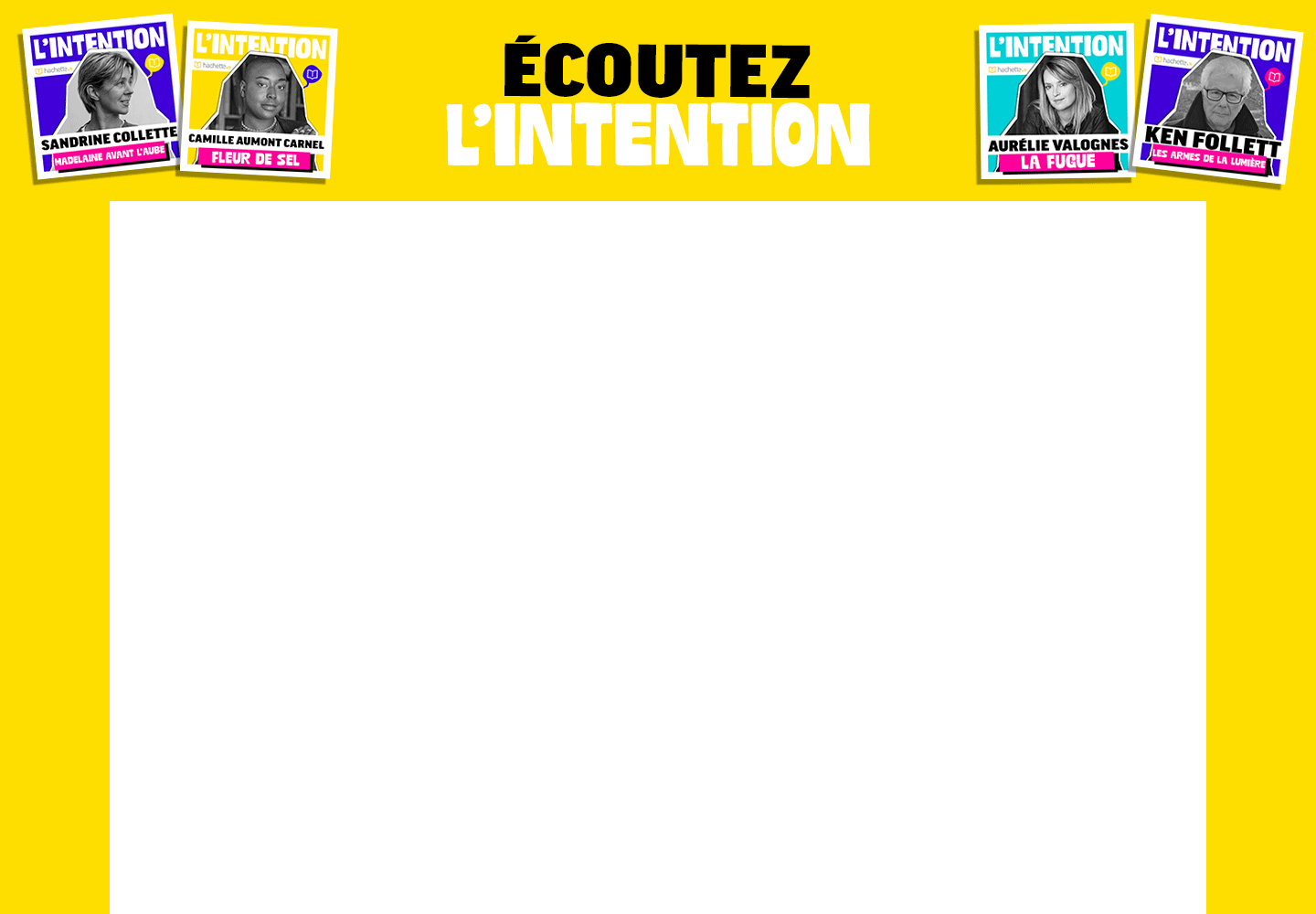Olivier Nora - L’année 2017 a été paradoxalement dynamique, dans un marché en retrait. Nous avons vendu 1,7 million d’exemplaires, soit une hausse de 20 % par rapport à 2016. Avec la progression des cessions de droits et celle des ventes de livres numériques, notre chiffre d’affaires a crû de 15 %. C’est un bilan positif dans un environnement pourtant chahuté.
Le marché est de plus en plus polarisé. En 2017, sur une production de plus de 150 nouveautés, trois ouvrages (La tresse de Laetitia Colombani, Vernon Subutex 3 de Virginie Despentes, La disparition de Josef Mengele d’Olivier Guez, prix Renaudot) ont représenté à eux seuls 43 % de notre chiffre d’affaires annuel. Illustration spectaculaire de cette "économie du sablier" dans laquelle nous sommes entrés : de moins en moins de références vendent de plus en plus, et de plus en plus de références vendent de moins en moins. Cette concentration du marché est évidemment très difficile à vivre pour les auteurs… et pour nous.
Attention, le marché n’est pas malthusien, il est darwinien : un accord général avec l’ensemble de la profession pour produire moins est illusoire, et être "vertueux" seul se traduit par une diminution de votre part de marché. Si vous ne souhaitez ni congédier vos auteurs fidèles, ni renoncer à accueillir du sang neuf, comment faites-vous ? Non, vraiment, la cure d’amaigrissement n’a de sens que si votre propre entreprise étouffe de sa production. J’ai été amené à pratiquer dans le passé cet exercice délicat, lorsque j’avais la charge de Fayard. Il suppose l’accord de l’actionnaire pour assainir structurellement une situation de surchauffe. Car pendant une période déterminée, vous essuyez des retours qui excèdent les mises en place et les réassorts, de sorte qu’il vous faut assumer transitoirement un chiffre d’affaires négatif. L’édition, comme l’aviation, oblige à "ravitailler en vol" pour ne pas atterrir en catastrophe. Il faut donc un pilotage progressif : la diminution de la production doit être proportionnelle au nombre de titres de forte vente qui maintiennent stable le chiffre d’affaires moyen au titre. Seuls des best-sellers permettent ce rééquilibrage à la même altitude. Dès lors se pose une autre question : jusqu’où est-on disposé à déplacer le curseur sans abîmer l’image d’une marque, qui est son capital le plus précieux ?
Nous avons la chance d’opérer dans un univers de confiance et d’autonomie : il n’y a pas de centralisation jacobine dans le groupe Hachette pour les maisons de littérature générale, hormis les grands dossiers stratégiques, notamment les relations avec les Gafa. Cela permet d’évoluer dans une double temporalité : des titres plébiscités immédiatement cohabitent avec des ouvrages à longue durée de vie. L’oxygène dégagé par les uns permet l’investissement dans les autres.
Il me semble que les maisons d’édition se définiront de plus en plus dans l’avenir par ce qu’elles refuseront de publier, mais aussi par ce qu’elles s’obstineront à continuer de publier. La tendance, c’est une évidence, est à la best-sellerisation. Mais céder à cette pente myope affaiblit le capital patrimonial d’un éditeur. Il faut avoir la volonté chevillée au corps pour garder le cap sur le long terme et résister aux pressions du court terme.
Au fond, il y a schématiquement deux familles d’éditeurs : les "horizontaux" pensent que la magie du métier consiste à convertir à la lecture, ici et maintenant, des personnes qui ne lisaient pas, et se donnent donc pour mission d’offrir des livres susceptibles de conquérir une population qui ne lui était pas acquise ; les "verticaux" sont obsédés par la transmission, afin que perdure un langage commun avec les générations qui suivent. Les deux conceptions ont leur dignité. Et il arrive, bien sûr, que les deux dimensions se conjuguent lorsque la grande qualité touche le grand public. Nous nous situons plutôt, chez Grasset, dans la famille des "passeurs" : nous ne transigeons pas sur la qualité des textes, et nos succès immédiats nous achètent du temps.
Ce qui m’a frappé lors de cette rentrée 2017, c’est le désir de renouvellement. En littérature, comme en politique, sévit le "dégagisme". Il y a une prime à la nouveauté, au sang neuf, à la découverte… Michel Le Bris par exemple, finaliste du Goncourt il y a neuf ans avec La beauté du monde, n’a pas même figuré à la rentrée 2017 sur la première liste du Goncourt avec son Kong si longuement ouvragé. La qualité intrinsèque de ce roman ambitieux n’est pas en cause : c’est l’époque qui a changé…
La critique littéraire est davantage entrée dans l’"ère du soupçon" : le public lui prête une trop grande proximité avec les auteurs, les éditeurs, le "milieu" littéraire, de sorte que ce maillon essentiel dans la grande chaîne de la prescription a perdu un peu de sa virginité. Le libraire l’a gardée. Il est crédité de sincérité, n’ayant aucun profit à recommander un livre plutôt qu’un autre. Le bouche-à-oreille sur des livres qui ne sont pas encore parus, circulant entre critiques, libraires, jurés de prix, éditeurs étrangers dont le plébiscite envoie un signal fort à notre marché domestique, dessine une nouvelle "géographie du désir". Nous ne sommes plus depuis longtemps régis par cette centralité germanopratine si décriée qui imprimait sa loi, par un mouvement "top-down", du sommet à la base. Nous sommes passés de la pyramide au réseau : tout circule, dans le monde réel et dans le monde virtuel (sites, blogs, réseaux sociaux…). C’est pourquoi il faut être très attentif aux "signaux faibles". La hiérarchie des titres d’une rentrée littéraire se dessine pendant l’été, où la concentration du "bruit" sur quelques ouvrages donne un indicateur fiable pour l’automne.
Non. Notre offre ne correspond plus à la demande du public au salon du livre de Paris. Les coûts augmentent et les profits diminuent. Les auteurs désirés pour leur notoriété ne sont pas désireux d’y venir parce qu’ils y signent moins de livres que d’autographes, et les auteurs désireux d’y venir n’y sont plus assez désirés. Les premiers sont sollicités pour des "selfies", et les seconds ignorés. Le fétichisme de l’image fait obstacle aux textes. Dans les deux cas, c’est une forme de violence faite aux écrivains.