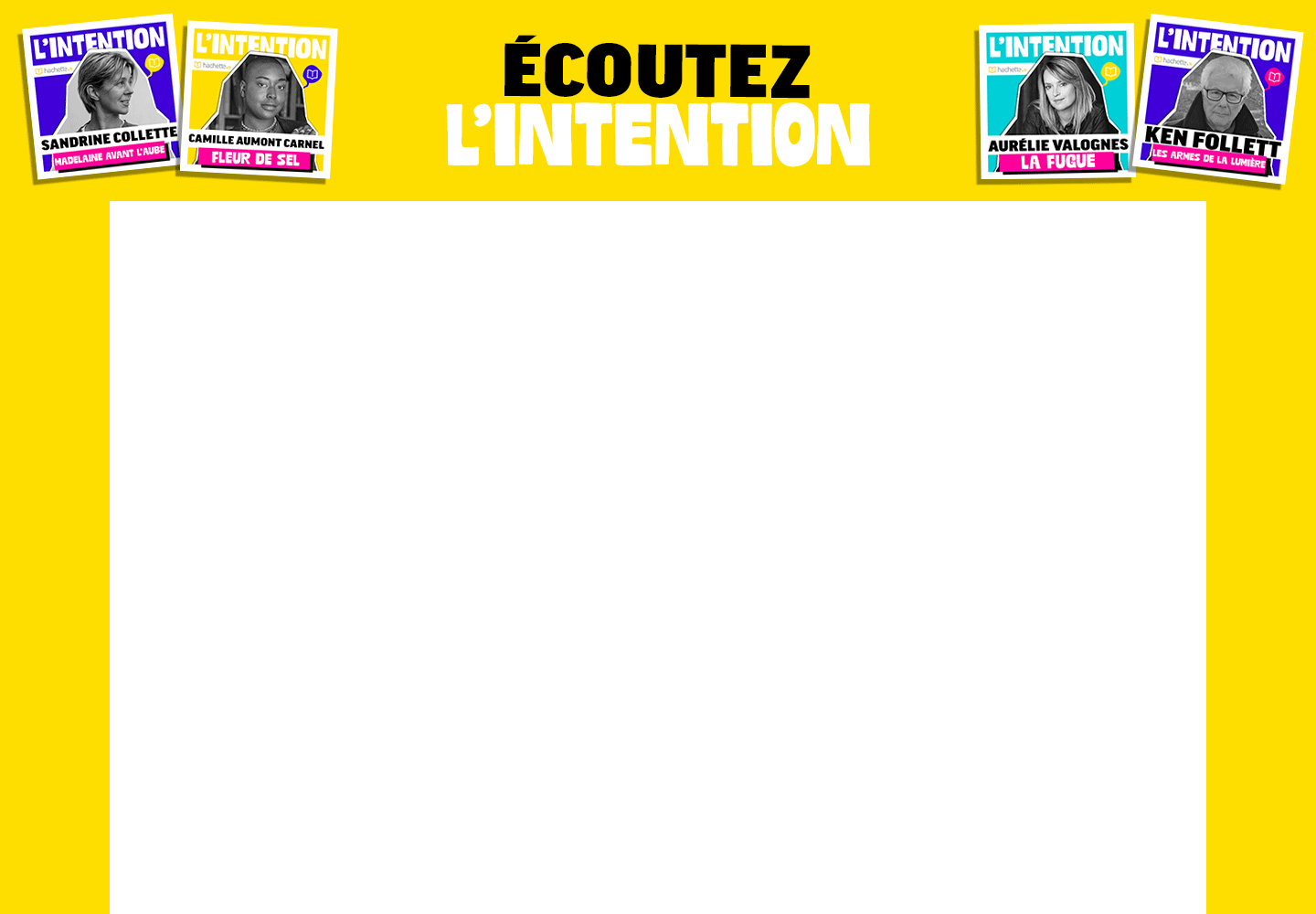Il faudrait ne jamais quitter Miami. Paul Katrakilis, en tout cas, aurait bien aimé y rester. Il a là-bas tout ce qui lui faut. Pas ou plus de femme certes, mais un vieux rafiot pour aérer son atmosphère, une Karmann Ghia de 1961 aux planchers dévorés par la rouille, un chien, Watson, corniaud qui lui est passionnément dévoué, un ami cubain qui lui rappelle de temps en temps que la vie peut être une jouissance, et surtout un travail qui serait ce qui est le plus proche chez lui d’une passion. Paul, médecin toulousain n’ayant jamais exercé, s’est réinventé en joueur de cesta punta professionnel dans un jaï alaï de Miami. Pour les non-initiés, la cesta punta est une discipline de la pelote basque qui se joue avec une grande chistera, et le jaï alaï le fronton couvert qui lui tient lieu de terrain de jeu.
Tout irait ainsi pour le mieux dans ce meilleur des mondes fait de petits plaisirs et de grandes contemplations, si un jour de décembre 1987, alors que Paul mène cette vie depuis un peu plus de quatre ans, ou se laisse mener par elle, il ne recevait l’annonce de la mort volontaire de son père à Toulouse. Le septuagénaire lui laisse, outre quelques souvenirs maussades, la clientèle de son propre cabinet s’il en veut, une vieille maison austère et froide, une Triumph Vitesse MK2 hors d’âge, ainsi qu’une fâcheuse propension familiale à mettre fin à ses jours…
Le grand-père Spyridon, venu en France pour fuir l’Union soviétique avec pour presque tout bagage une lamelle du cerveau de Staline qu’il avait autopsié, fut le premier à s’y essayer. S’ensuivirent Jules et Anna, frère et sœur, oncle et mère de Paul, horlogers consciencieux, inséparables jusque dans la mort survenue par suicide donc, à deux mois d’intervalle. Aujourd’hui Adrian, le père, tout aussi médecin et dépressif. Paul Katrakilis va devoir affronter ce à quoi il aurait voulu pouvoir échapper, la ronde grimaçante du passé, le chagrin des fantômes.
C’est quoi ce pataquès, pourrait ici s’interroger le lecteur ? Juste La succession, le vingt et unième livre de Jean-Paul Dubois, et ce n’est pas rien. Dubois s’y présente dans toute sa majesté mélancolique. Jamais peut-être, il n’a été si triste. Jamais sans doute, il n’a été si drôle. Le secret de son art se niche bien sûr dans les détails, dans la précision d’une écriture au service de l’indolence de ses personnages. Dubois n’a pas son pareil pour décrire la fidélité inquiète d’un chien, la lumière sur le Pays basque entre Rhune et Jaizkibel, l’air d’un rien d’un ami qui s’inquiète, la beauté d’une vieille bagnole oubliée, l’étrangeté du quotidien lorsqu’il cesse d’apparaître comme allant de soi. Le monde comme il va, comme il peut. Et nous dedans, si joliment perdus. Olivier Mony