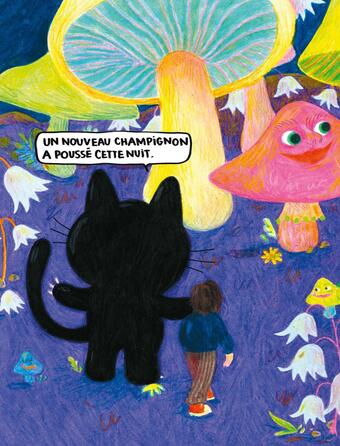LH - D'où vous est venu ce titre schizophrène "Je & Moi" ?

Philippe Forest - Je commençais à en avoir assez de l'usage inflationniste du terme "autofiction", il fallait clarifier les choses. Cela dit, il m'a aussi semblé nécessaire de décaler l'angle du propos. Ce titre introduit une distance à partir de l'idée que l'altérité est présente au sein même de la narration à la première personne. Même quand on dit je, il y a toujours au moins deux instances qui sont convoquées et qu'on peut appeler, d'un côté, le "je" et, de l'autre, le "moi".
A lire la contribution de Serge Doubrovsky, l'inventeur du terme « autofiction », le "je" serait le "je" narratif, la construction littéraire, et le "moi" la personne sociale ou psychique.

Dans mon esprit, le je est celui qui écrit et le moi est celui au sujet duquel le je écrit. C'est l'opposition entre sujet et objet. Mais rien n'est verrouillé : je n'ai pas voulu poser de cadre théorique trop précis. Et je ne crois pas qu'il y ait deux contributeurs dans le volume qui entendent ce mot "autofiction" de la même manière. Serge Doubrovsky propose une définition qui me semble assez juste : "Récit dont la matière est entièrement autobiographique, la manière entièrement fictionnelle."
Le numéro contient des interventions très variées. Quel était le cahier des charges ?

J'avais adressé une lettre aux auteurs où je les invitais à prendre l'exemple d'un grand écrivain du passé afin d'élaborer leur propre conception de l'écriture du je. J'exposais également mes idées sur la question tout en précisant que l'intervenant était libre de faire comme il souhaitait. Les écrivains, il est de toute façon difficile de les obliger à faire quoi que ce soit. J'ai finalement été le seul à m'appuyer sur un grand auteur du passé, en l'occurrence Kierkegaard.
L'autofiction braque certains esprits qui voient en elle le coup de grâce du roman.

J'ai lu récemment sous la plume d'un estimable académicien la thèse selon laquelle deux calamités se seraient abattues sur la littérature française ; l'une survenue dans les années 1950-1960, avec tout ce qu'on peut nommer l'avant-garde, c'est-à-dire le nouveau roman, Tel Quel, la nouvelle critique, etc. Et puis une seconde à partir des années 1980 : l'autofiction. Comme si l'avant-garde et l'autofiction étaient la peste et le choléra. Je serais assez d'accord avec cette idée-là, sauf qu'à la manière d'Artaud dans Le théâtre et son double, je suis plutôt partisan de la peste et du choléra. On oppose souvent avant-garde et autofiction (celle-ci étant considérée comme la fin de celle-là). Alors ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il existe entre elles une continuité, voire une connivence contre le culte de la fiction pure, du récit, l'obsession de l'intrigue.
N'y a-t-il pas dans l'autofiction plus d'invention qu'on croit ?

Claude Burgelin a raison d'affirmer que l'autofiction est une littérature de laboratoire. L'écrivain d'autofiction, s'il conduit à terme son projet, est dans l'expérimentation : c'est quelqu'un qui réfléchit sur l'acte d'écrire puisqu'il se met en scène lui-même en train d'écrire. L'autofiction s'inscrit dans une véritable filiation des écritures expérimentales qui remonte aux avant-gardes passées comme le surréalisme, le structuralisme ou le nouveau roman. C'est finalement l'autofiction qui, au lieu d'être ce néonaturalisme de l'intime qui adhère à l'idée d'authenticité, se met à réfléchir sur les rapports entre vérité et fiction et montre que c'est beaucoup plus compliqué. Cette dimension de questionnement poétique des vrais auteurs d'autofiction d'aujourd'hui fait d'eux les héritiers de Leiris, Breton, Céline, Bataille ou Barthes...
La littérature du "je" se revendique-t-elle du réalisme ?

Tout dépend de ce qu'on entend par réalisme. Dans Le roman, le réel et autres essais (1), je distingue - mais comme d'autres avant moi, notamment Lacan - le réel et la réalité. La réalité est quelque chose dont on peut faire une représentation tandis que le réel est l'impossible, ce qui échappe à toute représentation, la part de désir et de deuil à laquelle la littérature doit nous confronter. Le roman a pour objectif de nous faire toucher la vérité sous la forme du réel. Je revendiquerais donc le terme "réalisme" mais en le compliquant un peu, c'est un réalisme qui se réfléchit lui-même, montre le jeu et l'interpénétration constants entre fiction et vérité. Chacun de nous a une perception de sa propre vie comme quelque chose de fictionnel, n'est-on pas tous l'auteur d'une sorte de roman mental par lequel on se fait le créateur de sa propre existence ? C'est parce que la vie est un roman que le roman peut dire vraiment la vie.
Mais cette focalisation sur le « je » ne risque-t-elle pas d'enfermer le genre dans un égotisme stérile ?
Dans notre réflexion sur l'autofiction, la psychanalyse est mise à contribution. Catherine Millot reprend une idée lacanienne selon laquelle le je, pour advenir, doit accéder à un travail de déconstruction du moi. Contrairement au reproche que l'on fait à l'autofiction, il ne s'agit pas de se complaire dans un face-à-face narcissique avec soi-même. Loin du nombrilisme, il s'agit plutôt de se dégager de l'illusion du moi, de trouver son "moi transcendantal", pour reprendre le mot de Sollers. Lui récuse, bien sûr, le terme "autofiction" et préfère l'idée de roman métaphysique - où le moi se transcende au nom d'un je qui pense du côté de la phénoménologie avec Husserl ou Heidegger, ou encore de la grande poésie et du sacré avec Dante et la Bible.
Quel est le rapport qu'entretient l'autofiction, par essence subjective, avec la notion de vérité ?
Dans un contexte postmoderne et relativiste, l'écrivain est celui qui ne renonce pas à la vérité. Sans prétendre la détenir absolument, il doit proposer une pensée complexe de celle-ci. Christine Angot dit que le travail de l'écrivain est un travail de vérité, elle se risque même à employer l'adjectif "scientifique". Kierkegaard dit qu'il faut passer par le subjectif pour accéder à la vérité, mais la vérité à laquelle on accède n'est pas une vérité subjective, mais une vérité qui naît du rapport à l'absolu. Elle passe par la subjectivité mais ne se réduit pas à la seule expérience personnelle, c'est un rapport prospectif tourné vers un horizon de vérité. D'où la charge du philosophe danois contre les faux témoins de la vérité, ceux à qui l'expérience fait défaut - la vérité doit être gagée sur l'expérience.
Le style peut-il être la planche de salut qui évite l'écueil d'un exotisme à bon compte et celui d'un narcissisme mortifère ?
Dans ce passage de l'ego-littérature à l'autofiction, il y a un travail de l'écriture qui prend conscience de lui-même. Si le style est un élément décoratif, la fameuse "petite musique", alors je ne sais pas ce que c'est. Proust parle de point de vue, un travail sur la langue qui n'est pas lui-même sa propre fin mais s'explique par la vision. Il faut donner au mot "style" son acception la plus ambitieuse pour montrer que la forme constitue le spectacle du monde. Un dédoublement s'opère déjà dans l'autofiction. Mais cela ne suffit pas, il faut faire un pas de plus : c'est que j'appellerais l'hétérographie, ce rapport à l'impossible, au réel, où l'individu fait l'épreuve de la dissolution de sa propre subjectivité.
(1) Editions Cécile Defaut, 2007.
Derniers titres de Philippe Forest parus : Le siècle des nuages (Gallimard, 2010) ; Beaucoup de jours : d'après Ulysse de James Joyce (Cécile Defaut, 2011).