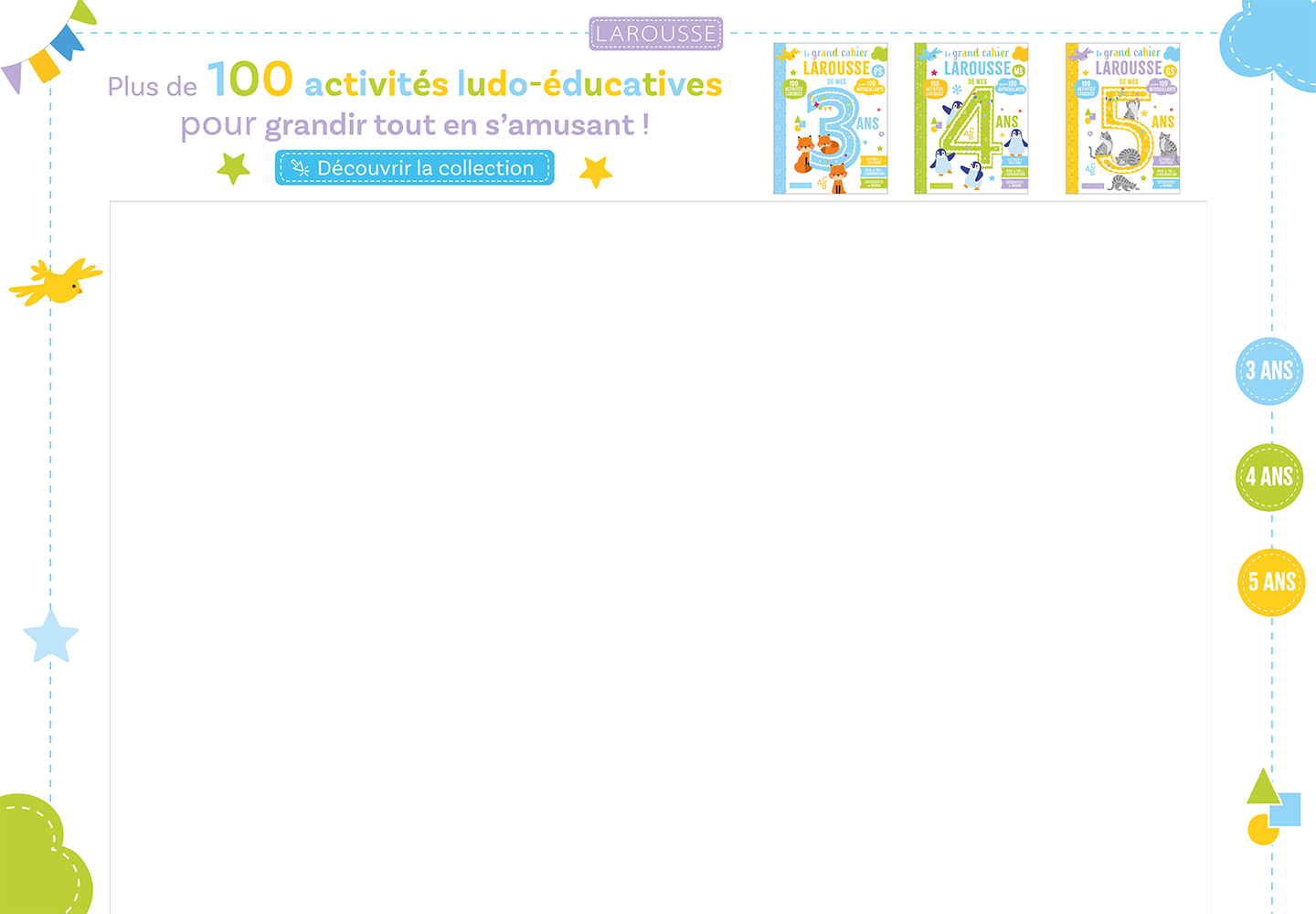C’est un genre en soi que le tombeau. Plus casse-gueule qu’il n’y paraît. Trop d’empathie, et pointe le mufle hideux du sentimentalisme ; trop de distance, et voici celui de la sécheresse. De ces écueils, Grégory Cingal, qui publie Ma nuit entre tes cils, premier livre "de littérature" de cet archiviste au fonds Jacques-Doucet, élégie à une belle disparue, n’en ignore aucun. Il écrit : "On a vu, et on verra encore, que je ne suis pas le dernier à sacrifier à ces petits rites de littérateurs, ce qui me donne l’envie furieuse de balancer tout ça au feu." Ce serait dommage, même si de fait il y a quelque chose de porté jusqu’à l’incandescence dans ce bref texte, impeccable de solitude altière et comme innervé de chagrin. Qui était-elle, cette femme toute de temps et de contretemps qui aimait danser le tango et Rafael Nadal, lire Blanchot (comment ne pas penser, à la lecture de ces pages, au "à elle, je dis éternellement : "viens", et éternellement, elle est là" qui clôt L’arrêt de mort ?) et le bonheur de ses amis ? L’auteur la suit au fil de son deuil, tout au long de ses chemins de traverse. Son corps, sa voix, mais aussi sa façon d’être au monde, comme en passant, lui sont autant de blasons. Cingal dresse, certes, le portrait d’une absence, mais tout autant, de l’absence elle-même. De cet espace de temps diffracté à l’infini, entre la disparition et l’écriture. On songe parfois, devant la violence sourde de certaines de ces pages, à celle du Mars de Fritz Zorn. C’est dire la beauté et la désolation de cet admirable champ (chant ?) de ruines. Olivier Mony