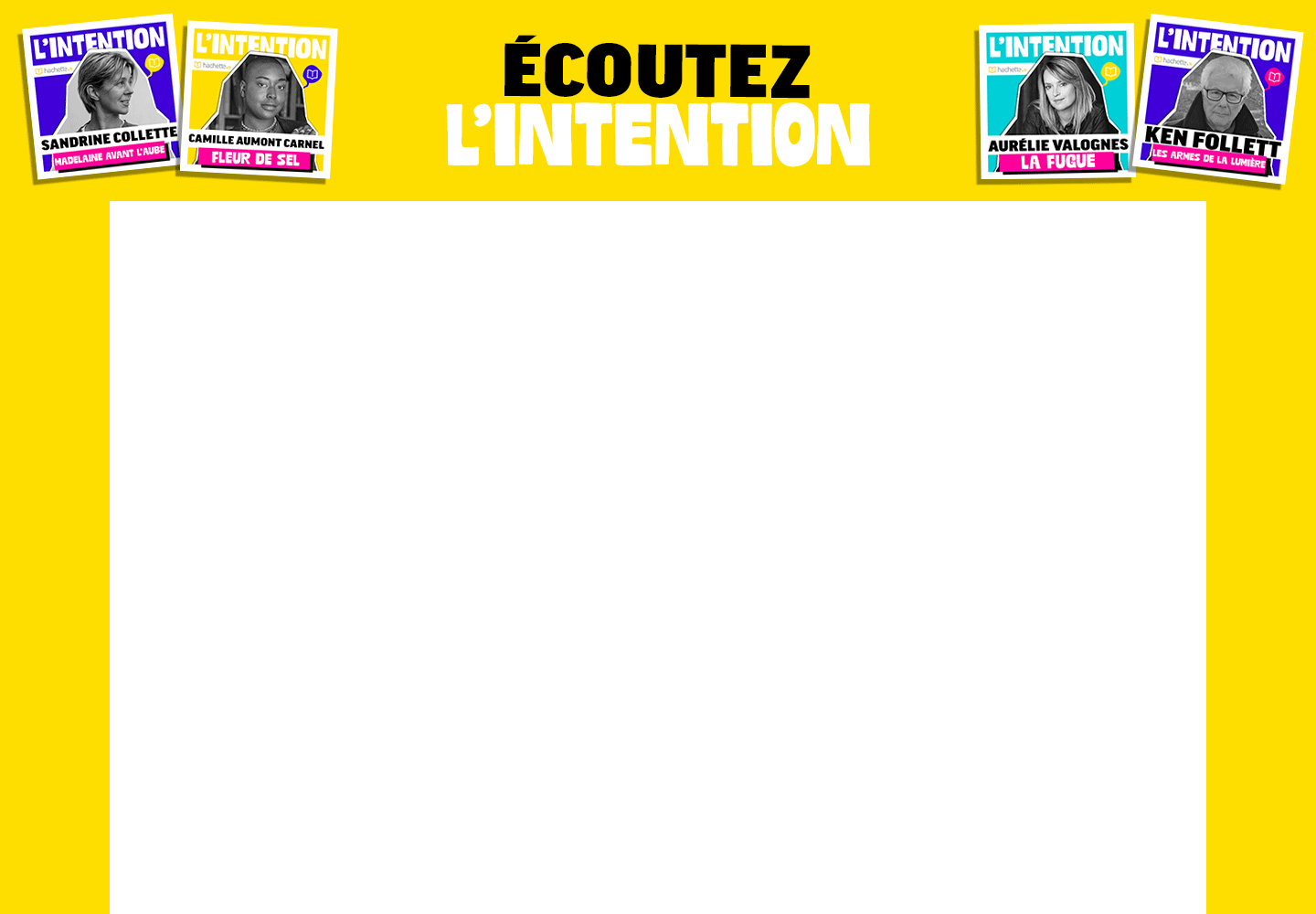Une édition trop blanche
« Dans l’ensemble des métiers liés aux livres, il y a un problème de diversité », constate Francis Geffard, éditeur de littérature étrangère chez Albin Michel, qui publie notamment Colson Whitehead. Le constat est le même pour Paola Appelius, présidente de l’Association des traducteurs littéraires en France : « Parmi tous nos adhérents, il n’y a pas beaucoup de traducteurs de couleur. Mais pour moi, la question tient plus du politique car souvent c’est le milieu dans lequel les minorités vivent qui ne leur permet pas d’accéder à des métiers littéraires. Elles pensent qu’elles ne sont pas faites pour la littérature et c’est ça qui pose problème. »
La présidente ajoute que c’est pour cette raison que l’ATLF n’a pas pris de position officielle : « Dans cette affaire, on ne parle pas de traduction, on parle de l’image du traducteur. La traduction est un prétexte pour mettre en avant un problème plus profond ».
Le métier de traducteur
Outre la question de représentativité, c’est aussi leurs profils, peu similaires à celui de la poétesse, qui sont soulignés. Victor Obiols a ainsi été informé des États Unis qu’il « n’était pas la personne adéquate » pour traduire ce type de texte. « Pour moi, cette idée va à l’encontre de la nature même de l’acte de traduction. La traduction est un acte d’humilité, où on essaye constamment de comprendre l’autre, de se mettre à sa place et qui n’a rien à voir avec les origines », explique Miyako Slocombe, traductrice japonais/français. « Certes, une excellente connaissance de la culture du pays de la langue source est indispensable mais l’origine d’un traducteur ne doit en aucun cas être un critère de sélection » poursuit-elle.
Christine Laferrière, traductrice en France de l’afro-américaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature éditée chez Bourgois, trouve « étonnant qu’on assigne d’emblée la couleur de peau, comme critère sinon de compétence, du moins de justesse du choix. La compétence n’a pourtant rien à voir avec la mélanine ! ». « On ne peut pas faire le traduire Salman Rushdie par un anglo-indien français. C’est de l’ignorance et un camouflet envers la profession de traducteur » ajoute-t-elle, s’inquiétant d’une régression intellectuelle qui fait fi de « l'influence d'une éducation, d’une culture, des contingences de la vie. »
Un bien pour un mal
En choisissant un traducteur en fonction de son origine, de son sexe ou de sa couleur de peau, l’éditeur irait à l’encontre du projet même de traduction qui tire sa raison d’être de l’altérité et de la rencontre avec l’autre. « Ce qui me dérange, c’est qu’en voulant « faire le bien », « être juste », il arrive qu’on fasse exactement ce qu’on dénonce soi-même, et il me semble que c’est le cas ici » précise Miyako Slocombe. Catherine Laferrière abonde en ce sens : « Est-ce qu’Amanda Gorman préfèrerait que son œuvre ne soit pas traduite, plutôt que d’être traduite par quelqu’un qui n’est pas noir ? ».
« Le traducteur, lecteur idéal, doit s’affranchir de son propre ressenti. S’il ne peut pas se mettre au service d’un auteur, c’est que l’on ne croit pas à la traduction, dans ce cas, tout serait intraduisible », s’inquiète aussi Pierre Morize, fondateur du festival Vo/Vf.
« C’est une mauvaise polémique pour de bonnes raisons », conclut Francis Geffard « Quand on est écrivain, on partage une vision du monde sans se soucier du sexe et de la couleur. Je comprends la souffrance provenant du manque de diversité flagrant qui existe dans les métiers du livre mais cette stratégie de cloisonnement, c’est tout le contraire de la culture. »