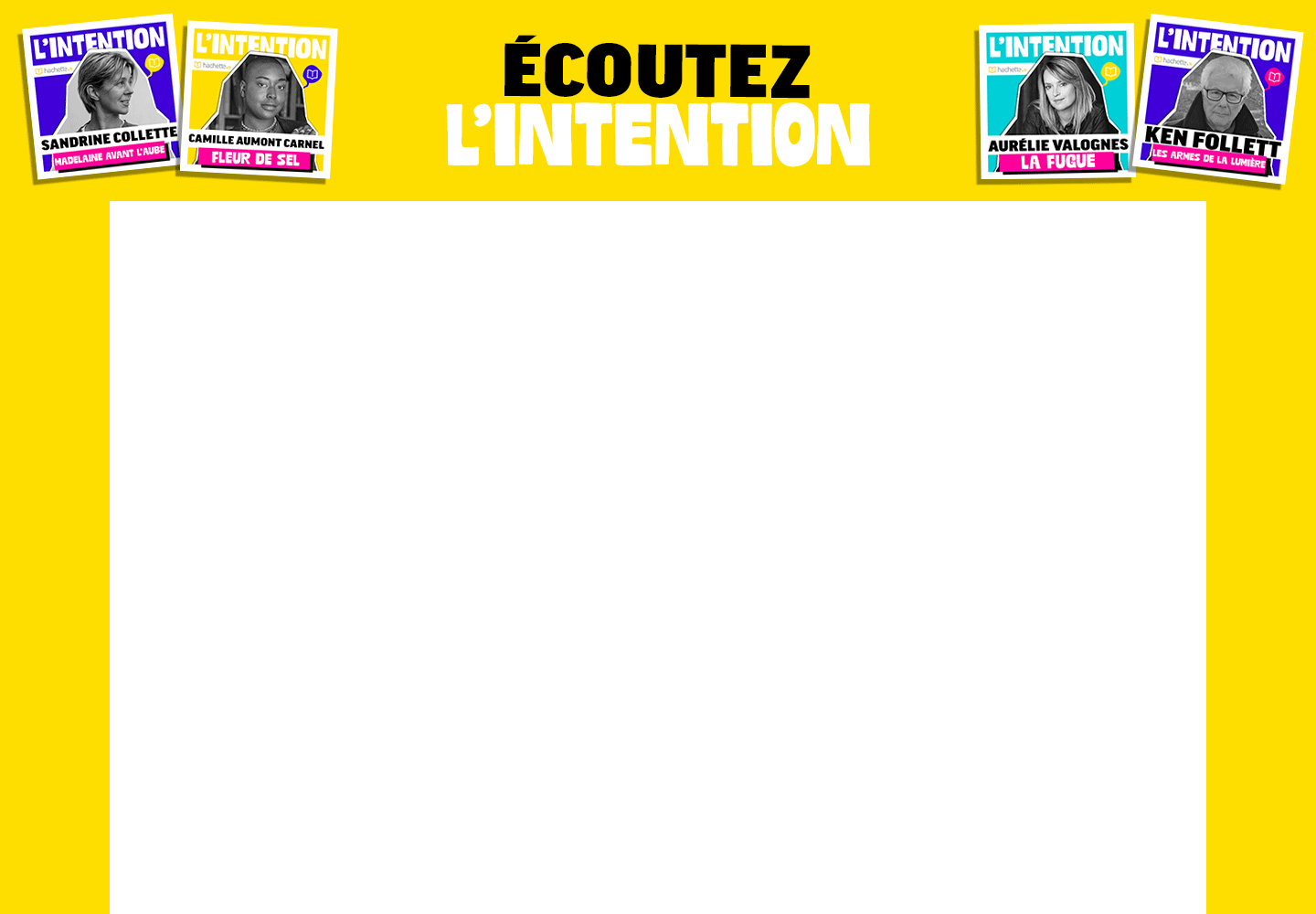Le grand William Sheller, expliquant comment lui est venue l’idée de Nicolas, l’une de ses plus belles chansons, parle d’un sentiment d’abandon, aussi puissant qu’irraisonné. On imagine bien le narrateur d’Oscar Lalo, qui tient son journal tant d’années après les faits, écoutant la chanson de Sheller, en proie à la peur, celle qui a empoisonné son enfance. Bien plus tard, lorsqu’il ira rendre visite à l’ancienne directrice du home d’enfants où il a été si malheureux, il aura encore la crainte de sa tortionnaire, pourtant mourante, laquelle lui confiera son secret : elle aussi, lorsqu’elle était jeune, a été abusée.
Dans les jeux pervers, le dominé rêve souvent de devenir le dominant. Comme le gosse, planqué dans une armoire à double fond, en compagnie de quelques-uns de ses camarades, tous condamnés au silence car la pièce était mitoyenne de la chambre d’un moniteur. L’ennemi, le maton, l’auxiliaire de la sadique et de son mari, "l’homme à la guitare", qui serre d’un peu près les garçons. Dans la "famille" directoriale, il y a aussi l’infirmière et sa "sodomie quotidienne" à coups de thermomètre, Dolly, le chien mordeur, et deux enfants, jouissant d’un statut à part. Il liera connaissance avec le garçon, qui lui donnera des cours de piano, et avec la fille, qui l’attirera dans un jeu malsain d’exhibition-voyeurisme. De même lorsqu’il s’amourachera d’une monitrice, un sentiment à sens unique vite réprimé par l’intéressée.
Pourtant, cette affaire partait de bonnes intentions. Les parents bourgeois du narrateur avaient choisi un "home chic pour familles aisées". De ses années d’enfer, le personnage d’Oscar Lalo (son double ?) ne s’est jamais remis. "Je n’ai pas de vie", écrit-il à un moment. Il a tenté la psychanalyse, et a choisi l’écriture. Jean-Claude Perrier